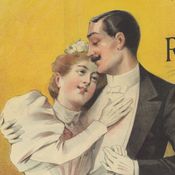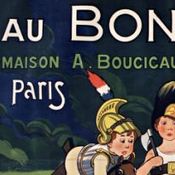• La Conquête de Plassans d’Émile Zola
L’abbé Faujas est, pour la famille Mouret, un véritable objet de curiosité. Son statut d’ecclésiastique se double du mystère qui l’entoure, dû à son apparente pauvreté et surtout à sa discrétion. Les conversations et les suppositions vont donc bon train, comme ici au chapitre III : « Au bout de la première semaine […] n’est-ce pas, Serge ? »
L’influence de l’abbé Faujas grandit de façon assez discrète. Au chapitre VIII, Marthe Mouret se lance dans une œuvre de charité qui s’organise à l’église. Mais dans cet extrait on voit combien la conscience de la sainteté du lieu diminue avec l’intérêt grandissant pour le projet en lui-même : « Marthe et le prêtre […] une idée de la façade. » Au chapitre XII l’abbé Faujas, devenu curé et progressant dans Plassans, est décrit une nouvelle fois. Il est cette fois empreint d’une sorte de dignité nouvelle : « Cependant l’abbé Faujas […] s’ouvrissent d’elles-mêmes. » Lorsqu’il est arrivé à ses fins, et a pris possession de la ville, l’attitude générale de l’abbé change. Sa douceur apparente laisse place à un caractère despotique, détaillé au chapitre XX : « Il semblait que le prêtre fut au-dessus […] au milieu de Plassans conquis. » Le caractère religieux et humble du personnage a disparu.
• Le Curé de village d’Honoré de Balzac
Le roman ayant pour héros (ou du moins personnage central) un curé, et une confession, les personnalités ecclésiastiques ainsi que les lieux de la religion sont souvent présents. Au chapitre IV on trouve une description de la pauvre église du curé Bonnet : « L’intérieur s’harmonisait […] la grande pensée catholique. » Le roman se termine par ailleurs sur la confession de Véronique, entourée de prêtres : « Tous les prêtres […] si justement frappée. »
• Un prêtre marié de Barbey d’Aurevilly
Roman d’un prêtre déchu, Un prêtre marié donne une grande place à la religion. La foi est en question, mais également la pratique religieuse et notamment celle de ceux qui se donnent à Dieu. Dans le chapitre III (I dans le volume) a lieu le récit du passage dans le milieu ecclésiastique du jeune Jean, avec les fiertés et les difficultés qui vont avec : « Le bonhomme hésita […] songe pas à contester ! » C'est dans ce même chapitre III (I dans le volume) qu'est également racontée la dégradation de la fonction de prêtre : « En 1789 […] car il était marié ! »
Plus loin, au chapitre IV (II en volume), l’ancien abbé se souvient de sa croyance, en observant les marques de la religion dans le paysage : « À travers les incertaines […] l’abbé Sombreval ? » C’est finalement la fille de l’ancien abbé qui se destine à la religion. Au chapitre XXI (XIII en volume) elle révèle son statut de religieuse, original car caché : « Oui, Néel, mes vœux […] son noviciat hors du cloître. »