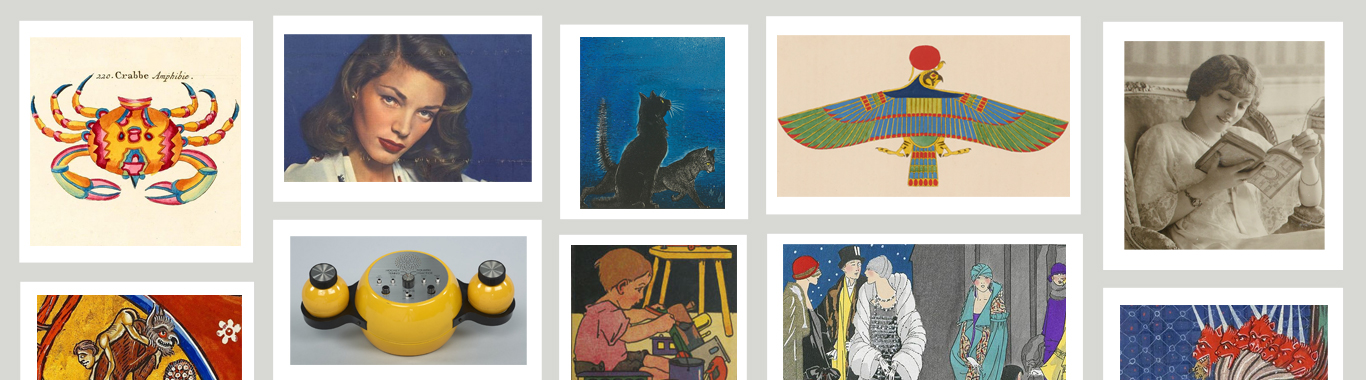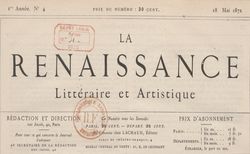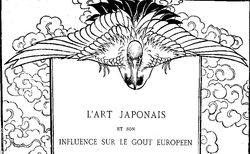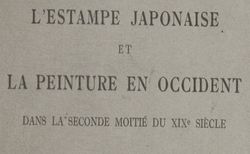D'autres vocables circulent pour en dénoncer le mauvais goût éventuel, tel
japonaiseries forgé en 1868 par un autre critique d'art,
Champfleury (portrait par Courbet), dans un article de
La vie parisienne (21/11/1868), ou même
japoniaiseries auquel
Léon de Rosny recourra encore en 1896 dans un article polémique contre
Edmond de Goncourt (portrait par Bracquemond) et son
Hokousaï.
Pierre Loti (photographie par Dornac) et quelques autres leur préféreront
japoneries, moins dépréciatif et plus sentimental... Mais quand
Ernest Chesneau étudie
Le japonisme dans les arts (
Musée universel, 2e semestre 1873), c'est déjà pour noter l'existence d'un vrai courant esthétique. Quelques années plus tard, dans
Le Japon à Paris (
Gazette des Beaux-Arts, 2e semestre 1878), il évoque même la possibilité, bien que ce soit encore sur le ton de l'humour, d'en faire l'objet d'"
un mémoire solennel sous ce titre : De l'influence des arts du Japon sur l'art et l'industrie de la France" !
Au même moment, le mot fait son entrée dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (2e supplément, 1878) de Pierre Larousse, intégrant bientôt le Dictionnaire de la langue française (supplément, 1886) d'Emile Littré. Toujours en 1878 - l'année de l'Exposition universelle ! - Adrien Dubouché, grand spécialiste de la céramique, s'insurge dans L'Art (20/10/1878) contre la même tendance : "Japonisme ! Attraction de l'époque, rage désordonnée qui a tout envahi, tout commandé, tout désorganisé dans notre art, nos modes, nos goûts, même notre raison"... Il est vrai qu'en 1872, déjà, Jules Claretie (photographie, atelier Nadar) le notait : "Le japonisme est, en effet, plus qu'une fantaisie, c'est une passion, une religion" (L'Art français en 1872).
Mais, dans son Lexique des termes d'art (1884), Jules Adeline, qui n'en a exclu ni Japonaiseries ni Japonisant, définit le mot avec moins d'emportement et beaucoup plus de justesse : "Japonisme.- Se dit des oeuvres de certains artistes contemporains, qui se sont inspirés des compositions japonaises (...)".