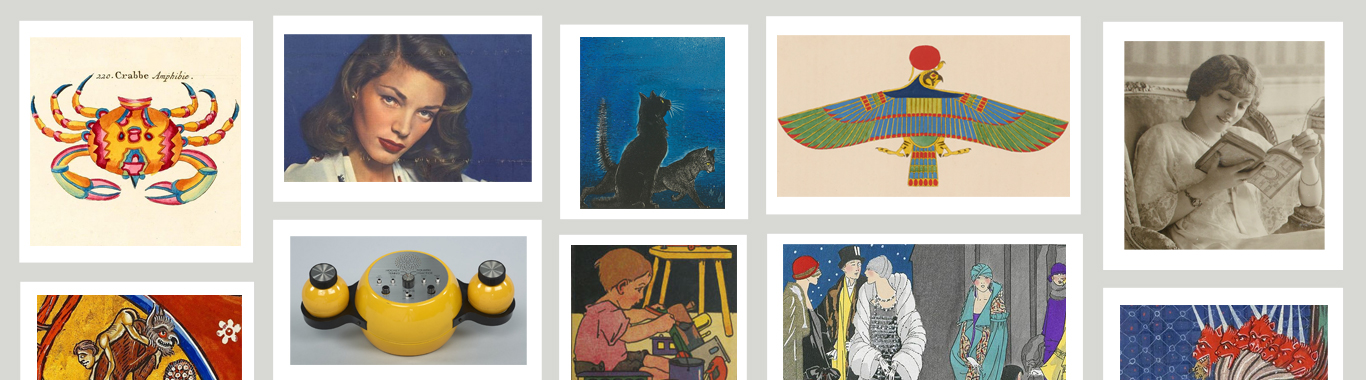Un peu plus tard encore,
Poupée japonaise (1889) de Bénédict Quinçay, n'est qu'une
fantaisie en vers destinée à être jouée dans les pensionnats... Beaucoup plus ambitieuse, la pièce de Paul Anthelme (Paul Bourde),
L'honneur japonais, adaptée du
Chûshingura (
Légende des 47 rônins), avec
Romuald Joubé dans le rôle de Yagoro (dessin de Paul Charles Delaroche), est créé le 17 avril 1912 au Théâtre de l'Odéon. Et l'année précédente, au Théâtre de l'Oeuvre, c'est Lugné-Poe qui mettait en scène
L'amour de Kesa,
drame légendaire japonais en deux tableaux de Robert d'Humières.
Du côté de l'art lyrique, Madame Chrysanthème (1893) d'André Messager, sur un livret de Georges Hartmann et Alexandre André, est une adaptation à la scène du roman culte de Pierre Loti (caricature, F. Vallotton, 1892), dont le succès fut rapidement international. Une opérette, La Geisha (1896), bientôt présentée à Paris (1898), en fut tirée par les Britanniques Sidney Jones et Owen Hall. A leur tour, les Américains John Luther Long et David Belasco s'en inspireront pour leur pièce, Madame Butterfly (1900), dont le compositeur italien Giacomo Puccini fit, en 1904, l'opéra du même titre, mis en scène à Paris (1906) par Albert Carré. Le neveu de celui-ci, Michel-Antoine Carré, dit Michel Carré fils, est l'auteur d'une pièce en un acte et en vers, Les yeux clos qui, accompagnée d'une musique de Charles Malherbe, sera représentée à l'Odéon le 1er décembre 1896.
Le "ballet japonais" eut également son heure de gloire, avec des oeuvres telles que Yedda (1879) d'Olivier Métra pour la musique et Eugène Lacoste pour les costumes, ou encore Le rêve (1890) du compositeur Léon Gastinel, avec des costumes conçus cette fois par Charles Bianchini.