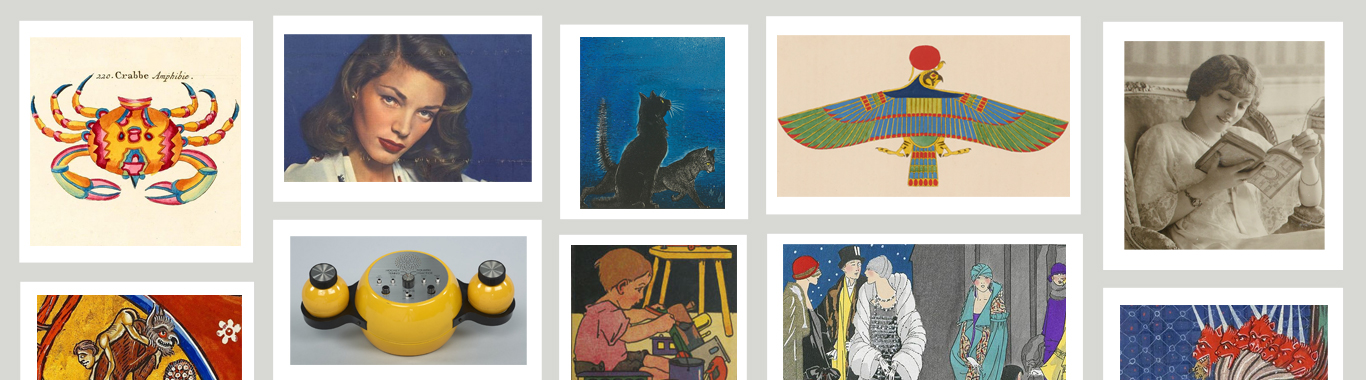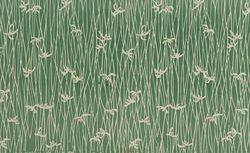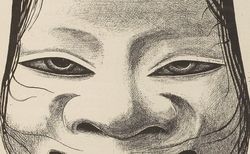Mais
boîte à médecine est le terme retenu par Edouard Garnier dans
Le Magasin pittoresque (1883) pour décrire un
inrô, ce qui est déjà beaucoup plus approprié... Et Albert Jacquemart, dans sa recension de l'Exposition de l’Union centrale consacrée à l'
Histoire du costume (
Gazette des Beaux-Arts, 1er semestre 1875), se montre très précis : "
les ceintures (...) servent à serrer les choses que l'on transporte avec soi (...), ces choses sont maintenues par des cordons au bout desquels pendent, en contre-poids ou comme ornement, ces fines breloques en ivoire, en bois ou en métal, qu'on appelle improprement boutons japonais". Cette confusion sera si tenace, pourtant, qu'à la fin du siècle, l'auteur d'un article sur l'
Histoire des boutons anciens et modernes (
Revue des arts décoratifs, 1893-94) se sent toujours tenue d'écrire : "
En réalité, les netzkés ou boutons japonais n'ont aucun rapport avec les boutons européens".
Entre-temps, dans Le Magasin pittoresque (1882) comme dans L’art pour tous (30/05/1886), le terme japonais s'était imposé... Sans doute à la faveur de cet engouement décrit par Antony Valabrègue dans sa chronique sur L’ivoire à l’Exposition de 1889 (Revue des arts décoratifs, 1889-1890) : "La mode est venue récemment d'utiliser les netzkés pour des manches de cannes, de parapluies et d'ombrelles, ou tout au moins d'y assujettir des imitations de ces curieuses petites sculptures japonaises." A la même époque, l'objet entre dans de précieuses collections, dans celle, par exemple, de Jean Dollfus (Catalogue, 1889). Et c'est précisément à un collectionneur, Harry Seymour Trower, que Bing fera appel pour les deux articles consacrés aux Netsuké et Okimono publiés dans Le Japon artistique (juillet et août 1890)...
Petites boîtes de céramique, de laque ou de bois, utilisés pour contenir l'encens utilisé lors de la cérémonie du thé, les kôgô s'apparentent aux netsuke par leur fantaisie formelle et la diversité de leur iconographie. En 1895, Clémenceau, qui les collectionna assidûment, en déposa quelques deux-mille-sept-cent au Musée Guimet (Petit guide illustré, 1904), dont Emile Deshayes était alors conservateur-adjoint. Devenu entre-temps conservateur du Musée d'Ennery (Petit guide illustré, 1908) où la collection l'avait suivi, celui-ci publia en juillet 1909 un grand article dans Art et décoration où sont reproduites quelques-unes des plus belles pièces de cet ensemble exceptionnel aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Les peignes font eux aussi partie de ces petits objets où se déploie librement toute l'invention ornementale des artistes japonais. Dans Le Japon artistique (juin 1890), Théodore Duret leur consacrera un article qui est illustré de plusieurs modèles tirés du Imayô sekkin hinagata (1823), recueil où Hokusai lui-même exerça tout son génie sur ce modeste accessoire...