Les poétesses ouvrières
Au XIXe siècle, l’alphabétisation et les journaux se développant de pair avec l’urbanisation, les jeunes classes travailleuses ont développé leur propre production écrite. Qu’en est-il de la place des femmes dans ce mouvement d’enthousiasme littéraire ?
Ouvrière peignant un rouleau au vernis. Mulhouse, 1902
« L’ouvrière, mot impie ! » Ce sont les mots qu’écrit Jules Michelet en 1860 dans le chapitre intitulé « L’Ouvrière » de son ouvrage La Femme. En effet, dans un XIXe siècle qui veut tout classer, nommer, étiqueter, au risque de lisser la complexité de situations qu’on qualifierait aujourd’hui d’ « intersectionnelles », la double condition de femme et de travailleuse ne va pas sans contradictions. Ainsi, ces dernières sont-elles écrasées entre d’une part les injonctions à la féminité, (la femme idéale étant alors conçue comme un être d’intérieur, entièrement dévouée à la famille, privée du statut d’individu autonome par le code napoléonien) et d’autre part la vision viriliste du travail, qui se développe à la faveur de l’émergence de luttes sociales qui resteront longtemps définies par et pour les hommes. Ces deux conceptions, antinomiques, ne laissent que peu d’espace à l’identité de travailleuse, pourtant bien réelle au XIXe siècle.
Mais alors, quand sa simple existence sociale pose problème, comment s’intègre-t-on à un espace littéraire déjà difficile d’accès ? Comment écrit-on, et fait-on littérature, quand on cumule une double identité, qui signifie double difficulté puisqu’elle interdit d’une part l’accès aux cercles littéraires féminins qui se constituent à l’époque, encore essentiellement bourgeois, et de l’autre à ceux des ouvriers, terriblement masculins ?
Il existe, de fait, trois voies pour ces travailleuses qui veulent écrire et se faire entendre. La première consiste à intégrer un milieu littéraire bourgeois, avec le soutien d’un parrain ou d’une marraine. La seconde, à intégrer un milieu littéraire ouvrier, à savoir une goguette, lieu par excellence de création poétique et chansonnière des ouvriers au XIXe siècle. La troisième, plus politique et moins littéraire dans ses objectifs, mais tout de même in fine productrice de textes non dépourvus d’enjeux esthétiques et créatifs, a consisté pour certaines femmes Saint-Simoniennes (Lien sélection) à créer leurs propres espaces d’expression, à travers des journaux d’ouvrières adressés à des ouvrières. Nous vous proposons une série de billets de blog pour explorer ces trois modalités dans ce qu’elles ont de spécifique.
Le passage par la première voie, celle de l’intégration d’un milieu littéraire bourgeois, n’est pas sans embûches, et place les écrivaines travailleuses dans des situations plus complexes encore que leurs plus connus homologues masculins, les poètes ouvriers. Ces derniers ont attiré l’attention des écrivains et écrivaines romantiques, par une production littéraire qui a explosé à partir de 1830, notamment à la faveur du développement de la liberté de la presse. Ainsi, George Sand ou Alphonse de Lamartine ont-ils parrainé un certain nombre de poètes et de poétesses ouvriers et ouvrières et même produit des textes théoriques sur le sujet : George Sand a par exemple publié un « Dialogue familier sur la poésie des prolétaires » dans La Revue indépendante.
Cependant, bien que leur intérêt pour cette production écrite nouvelle ait indéniablement contribué à son développement, par la publication, l’encouragement et la promotion de certains auteurs et autrices, ces relations étaient toujours empreintes de paternalisme, voire d’un certain mépris, qui a parfois limité leur production poétique en la circonscrivant à certaines thématiques (ainsi George Sand a-t-elle prié le maçon Charles Poncy d’écrire plutôt sur son métier que sur ses sentiments) ; ou l’a dévalorisée en l’associant à des processus naturels et non à un apprentissage, à l’image de Lamartine lorsqu’il qualifie la poésie de Reine Garde dans la préface de Geneviève : « C’était naïf, c’était gracieux, c’était senti, c’était la palpitation tranquille du cœur devenue harmonie dans l’oreille ; cela ressemblait à son visage modeste, pieux, tendre et doux ; vraie poésie de femme, dont l’âme cherche à tâtons, sur les cordes les plus suaves d’un instrument qu’elle ignore, l’expression de ses sentiments. »
Alors, si l’on voulait conserver une plus grande liberté, il valait peut-être mieux passer par la solidarité féminine d’autrices qui cherchaient à encourager la production littéraire des femmes en général. Ainsi Amable Tastu a-t-elle soutenu la jeune Marie Carpantier en rédigeant la préface de son recueil Préludes, où elle défend la place des femmes, et en particulier de cet « essaim chantant de jeunes filles tout à coup surgi des rangs populaires », en littérature.
Cependant, s’intégrer à de tels milieux n’est pas sans embuches, et demande l’apprentissage de nouveaux codes sociaux et littéraires, que la plupart apprennent en autodidactes, notamment grâce à la très riche culture de la chanson ouvrière entretenue dans les goguettes (billet à venir).
Pour aller plus loin
- Le Maitron (Dictionnaire du mouvement ouvrier)
- Christine Planté. Femmes poètes du XIXe siècle, une anthologie. Presses Universitaires de Lyon, 1998
- Edmond Thomas. Voix d’en bas, la poésie ouvrière au XIXe siècle. Maspero, 1979
- La Poésie populaire au XIXe siècle. Théories, Pratiques, Réception. Du Lérot, 2005
- Les poètes du peuple au XIXe siècle / textes réunis et publiés par Alphonse Viollet. Librairie française et étrangère, 1846
- Poésies sociales des ouvriers / réunies et publiées par Olinde Rodrigues. Paulin, 1841
- Sélection Poétesses travailleuses au XIXe siècle
- Les trois billets de la série Écrivaines travailleuses
- Femmes de lettres à la BnF


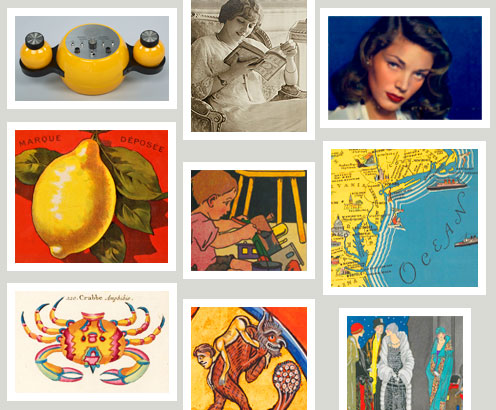






Commentaires
Fascinant !
Un sujet que je n'avais jamais vu évoqué ! Très intéressant...
Ajouter un commentaire