Les faits divers de Gallica, affaire Brierre épisode 4 : la peine capitale en débat
Ultime rebondissement dans l’Affaire Brierre le 22 juillet 1910, quatre mois après la mort du condamné au bagne en Guyane, « un vagabond exerçant le métier de chiffonnier[1] » reconnaît les faits et s’accuse du quintruple meutre (Le Petit Parisien).
"Un chemineau s'accuse du crime pour lequel Brièrre est mort au bagne", Le Petit Parisien, 22 juillet 1910
Aveu puis rétractation
L’émotion est à son comble : le suspect « est-il sincère ? est-il fou ? veut-il mystifier la justice ? » ou n’est-ce qu’un étrange canular venant raviver la douleur d’une famille éplorée qui ne peut que regretter que « ça arrive […] trop tard » ? Après quelques jours d’interrogatoires, le suspect se rétracte et nie les faits (Le Petit Parisien). Accusé d’être un « fumiste », son état mental est examiné. Ironie du sort, il s’appelle Joseph Bourreau !

Porte d'Asnières, Cité Valmy, 1913, Chiffonniers, photographiés par Eugène Atget
Mais – c’est ce que différents journaux mettent en avant – « il se pourrait que demain Brierre apparût aux yeux de tous comme la victime de l’erreur judiciaire la plus effroyable » (Le Petit Parisien). Cette question centrale qui reste à jamais non élucidée dans cette affaire, met en lumière deux débats ayant eu cours pendant et après le procès de Brierre : celui de la grâce présidentielle et celui de la peine de mort.
La peine de mort et la grâce présidentielle
Au lendemain du quintuple meurtre, en avril 1901, et jusqu’à la mort de Brierre, en mars 1910, l’opinion publique est régulièrement relayée par voie de presse entre les Brierrards (La Lanterne, L’Aurore, Le Petit parisien…) et les anti-Brierrards (Le Gaulois, L’Intransigeant…). Cette lutte se cristallise autour de deux débats : la peine de mort et la grâce présidentielle.

Le Président de la République Emile Loubet et M. Waldeck-Rousseau en 1918, (Atelier Nadar)
Alors que pour les uns Brierre est un « monstre » sanguinaire (L’intransigeant), un « vampire » (L’intransigeant) qui ne mérite que l’échafaud ; pour les autres, le suspect a le droit de vivre tant que sa culpabilité n’est pas avérée, que le « doute étrei[nt l]es consciences et que ce doute dev[ien]t une véritable angoisse » (Le Rappel). Cette possibilité de se défendre et de se racheter, la grâce présidentielle le permet tout en éloignant définitivement la menace de la guillotine « vestige des temps barbares, de saleté rouge ». Le Gaulois, bien qu’anti-Brierrard, souligne cependant avec justesse que « transporter un homme au bagne calédonien, alors que l’on n’est pas certain qu’il a commis le crime pour lequel il [es]t condamné, […] paraît être la plus monstrueuse des solutions. Si elle n’offense pas la justice, elle outrage l’humanité ». Il faudrait dans ce cas selon le journal « accorder une grâce entière [à Brierre] et le renvoyer chez lui avec des excuses et une notable indemnité ». C’est sans compter sur le fait que la majeure partie de l’opinion publique croit à la culpabilité de Brierre. Car, au-delà du débat sur la légitimité de la peine de mort et de la grâce présidentielle, le crime de Corancez attise les haines et ravive une ancienne affaire ayant profondément déchiré la France : l’Affaire Dreyfus.

"Les adieux de Brièrre", dans L'Echo de Paris du 8 février 1902
Brierre : nouveau Dreyfus ?
En effet, dès le 1er janvier 1902, des rapprochements entre Alfred Dreyfus et Edouard Brierre sont faits avec la célèbre Une du Gaulois : « De Dreyfus en Brierre » où Maurice Talmeyr fustige la clémence que l’on accorde « au traître » et maintenant à « l’assassin ». Mais c’est L’Intransigeant qui va laisser filtrer avec le plus rage son antisémitisme. Selon le journal, ces deux hommes qui ont « assassiné, l’un la France qui est sa mère, l’autre ces cinq enfants », bien que diamétralement opposés, présentent des similitudes. Tous deux ont été graciés par le Président Emile Loubet et ont commués leur peine au bagne en Guyane (L’Intransigeant), ce qui fait du gouvernement un « destructeur de la famille […] à la solde du parti juif ». A ces deux points communs s’ajoute l’attitude en apparence froide et détachée des deux hommes lors de leur procès respectif. Aux yeux de leurs détracteurs, c’est la preuve incontestée de leur manque de compassion et de tout remords vis-à-vis de leurs crimes. En écho à l’affaire Dreyfus, les journaux droitiers accusent le gouvernement d’accorder sa « protection [aux] scélérats » où « il en coûte aujourd’hui moins cher pour égorger sa progéniture […] que d’appeler dans une réunion […] M. Loubet "cornichon" ». Surtout, Brierre est associé au « syndicat juif » car le quintuple meurtre de ses enfants serait en réalité un rite sacrificiel propre « à la tradition [juive] qui enjoint [ses fidèles] de tremper dans le sang d’enfants aussi jeunes que possible le pain de la pâque » (L’Intransigeant) !

Exécution de Jean-Baptiste Troppmann, gravure sur bois en couleurs, 30x40 cm, 1870
Même s’il n’est pas de confession juive et qu’il n’est pas franc-maçon, il n’empêche qu’il bénéficie « de la coalition juive qui s’est formée en vue de [le] soustraire à l’échafaud, [lui] le vampire de Corancez ». Le parallèle entre les deux affaires est d’autant plus choquant qu’il n’est en vérité qu’un prétexte « pour occuper l’opinion publique, afin de permettre au gouvernement de travailler […] pendant ce temps-là, au bonheur du peuple » comme le souligne fort justement Le Journal : « il n’y avait qu’à combiner l’affaire Troppmann[2] et l’affaire Dreyfus, et le peuple le plus spirituel du monde serait bien sage, tout à la lecture des comptes rendus de l’assassinat et du procès » et non sans malice d’ajouter : « "De qui est le bordereau ?" criait-on autrefois. "A qui est le coutre" demande-t-on aujourd’hui ? ».
En somme, l’affaire Brierre comme l’affaire Dreyfus procède d’un instantané de la vie politique française et de ses tensions socio-politiques à une époque où le fait divers fait la Une des journaux et contribue à l’âge d’or de la presse.
[1] Un chiffonnier est une personne dont le métier consiste à passer dans les villes et villages pour racheter des choses usagées et les revendre à des entreprises de transformation. Ce métier a été exercé en France jusque dans les années 1960 et continue à l'être dans de nombreuses régions du monde.
[2] Affaire Troppman : Jean-Baptiste Troppmann, né à Brunstatt (Haut-Rhin) le 5 octobre 1849 et guillotiné à Paris, le 19 janvier 1870, est un ouvrier mécanicien, jugé coupable du meurtre des huit membres d’une même famille, la famille Kinck, crime également connu sous le nom de « massacre de Pantin ».
Ce billet s'appuie principalement sur : Alain Denizet, L’affaire Brierre. Un crime insensé à la Belle Époque, Paris, Les éditions de la Bisquine, 2015, 317 p., préface d’Alain Corbin.


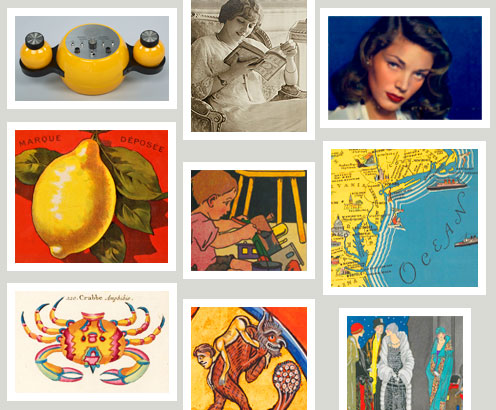

Ajouter un commentaire