Ellen Terry, la Dame du théâtre anglais
Surnommée la « Sarah Bernhardt anglaise », Ellen Terry fut une figure majeure du théâtre anglais de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Si elle fut quelque peu éclipsée par les nombreuses figures masculines de son entourage, sa carrière fut immense et son talent reconnu par ses pairs. Gallica vous propose de redécouvrir son histoire.
« Miss Ellen Terry est une sorte d’institution nationale et chacun s’accorde à la trouver, quoiqu’elle fasse, délicieuse, avec un sourire attendri[1]. »
Née le 27 février 1847 à Coventry, Ellen Alice Terry est issue d’une véritable dynastie d’acteurs de théâtre d’origine irlandaise : fille, sœur, mère et tante de comédiens et comédiennes, elle fait ses débuts sur les planches à neuf ans dans le rôle de Mamilius du Conte d’hiver de Shakespeare au Princess’s Theatre de Londres en 1856. Au cours des années suivantes, elle joue dans des pièces classiques et modernes, tragédies et comédies, avec ou sans sa sœur Kate, dans toute l’Angleterre.

Connue pour ses rôles shakespeariens, en particulier Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, Portia dans Le Marchand de Venise et Lady Macbeth dans Macbeth, Ellen Terry contribue à revivifier la tradition du Barde d’Avon dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle s’illustre tout particulièrement aux côtés de l’acteur Henry Irving qui, en 1878, l’engage pour 24 ans au Lyceum, avec un généreux salaire.


Desdemone, maquettes par E. W. Godwin (?), 1880 pour une représentation au Lyceum (MAQ-11855 et MAQ-11858)
Quand les rôles de jeune première ne peuvent plus lui convenir, elle en adopte d’autres, comme celui de la nurse dans Roméo et Juliette.
C’est ainsi qu’elle participe plus généralement au renouveau du drame dans l’Angleterre victorienne. Henry Irving et Ellen Terry ont joué un rôle clé dans la transformation de l’art de jouer à la fin du XIXe siècle. Fortes personnalités à la ville comme à la scène, ils contribuent à instaurer un jeu plus naturel, plus centrée sur la personnalité des acteurs que sur l’incarnation des personnages.
« Elle ne dit pas le texte tel que je l’ai écrit, elle dit le texte comme je voudrais l’avoir écrit » (Bernard Shaw)
Adulée par ceux que l’on n’appelait pas encore des fans, parmi lesquels Oscar Wilde qui lui dédia un sonnet après l’avoir vue dans Le Marchand de Venise en 1875, elle joue de son image. Peinte à de nombreuses reprises par son premier mari, Watts, puis par Sargent en Lady Macbeth dans un portrait resté célèbre et photographiée par Julia Margaret Cameron, ses photographies font aussi l’objet d’un véritable marketing de l’image.
C’est qu’au tournant du XIXe siècle, le théâtre devient l’un des passe-temps préférés de la classe moyenne. Se développent ainsi des figures de véritables stars du théâtre. Irving a été le premier acteur à être anobli par la reine en 1895 et Ellen Terry a obtenu en 1922 un diplôme honoris causa de la prestigieuse université Saint Andrew à Édimbourg et devint Dame Ellen Terry en 1925.

Après avoir célébré en grande pompe son jubilée (cinquante ans de carrière théâtrale) à Drury Lane en 1906, elle décide de se retirer de la scène en 1920, non sans avoir fait une incursion dans le monde du film, dans Her Greatest Performance (1916), Victory and Peace (1918), Pillars of Society (1920) et The Bohemian Girl (1922). Retirée dans son cottage du Kent, elle meurt le 21 juillet 1928.
Durant sa carrière, elle a atteint le statut de mythe dans le monde anglo-saxon et son aura y demeure intacte aujourd’hui. Commenté, décrit et décortiqué par les spectateurs et acteurs de son temps, son jeu est resté synonyme d’une époque et son évocation amène dans son sillage celui de l’Angleterre de son temps. Effacée aujourd’hui des mémoires plus continentales de nos contemporains, elle suscita durant sa vie un véritable engouement chez le public français. La « Sarah Bernhardt anglaise », comme la surnommaient les journaux, était dans tous les esprits, à l’égal de l’italienne Eleonora Duse, « l’une des plus authentiques reines du théâtre moderne », entourée de « ce halo lumineux que les Anglais appellent glamour[5] ».
« Au dessus de son réel talent d’actrice, elle possédait la fascination d’une personnalité accomplie résumant, voix gestes, attitudes, physionomies, l’idéal féminin d’une époque. […] Elle était la personnification même de l’héroïne, telle que ce monde anglo-saxon le concevait, à une heure où ce monde imposait aux autres peuples, par le prestige d’une grande civilisation arrivée à l’apogée, son type de perfection, son modèle humain aux autres nations. […] Dans l’impression qu’elle produisait sur les spectateurs, une confusion complète s’établissait entre l’attrait surgi du personnage fictif qu’elle incarnait et la séduction de sa personnalité qui ne devait presque rien au rôle brillant dont elle était l’interprète[6]. »
Pour aller plus loin
Ellen Terry, The collected letters of Ellen Terry
Ellen Terry, Ellen Terry’s Memoirs, Londres : Gollancs, 1933
Ellen Terry, More reminiscences
Moira Shearer, Ellen Terry, Stroud : Sutton, 1998
Katharine Cockin, Ellen Terry : spheres of influence, Brookfield/London : Pickering & Chatto, 2011


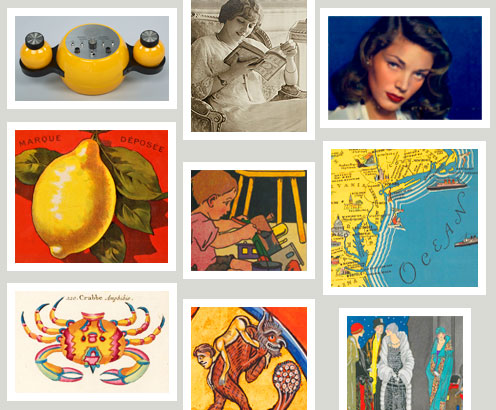





Commentaires
Ellen Terry
Bonjour
Je voudrais signaler une erreur : Watts était un peintre préraphaélite et non un "prince"; et une omission : Ellen Terry était la grand tante de John Gielgud , célèbre acteur shakespearien décédé au début de notre siècle.
Ellen Terry
Bonjour,
Merci pour votre commentaire. La correction est bien faite.
Bien cordialement,
Ajouter un commentaire