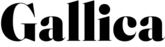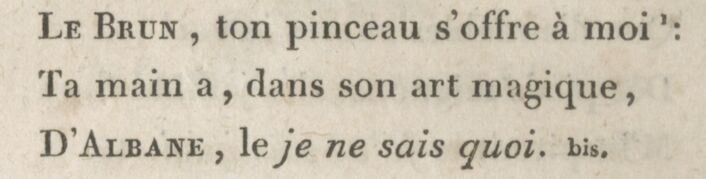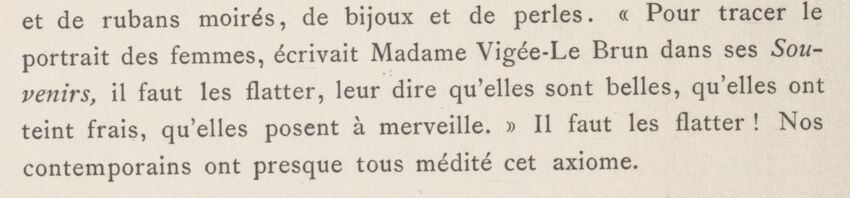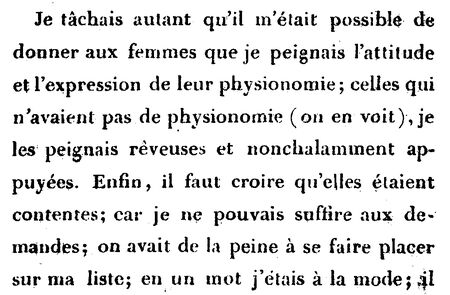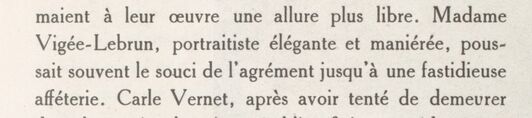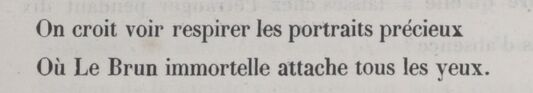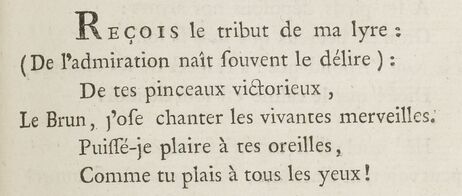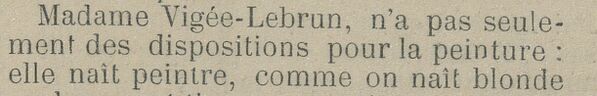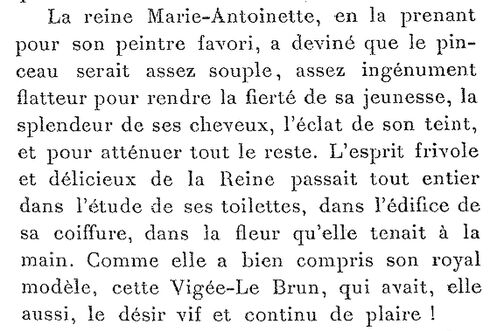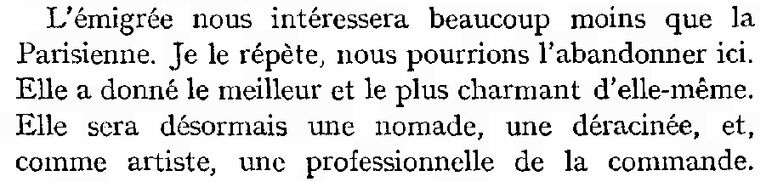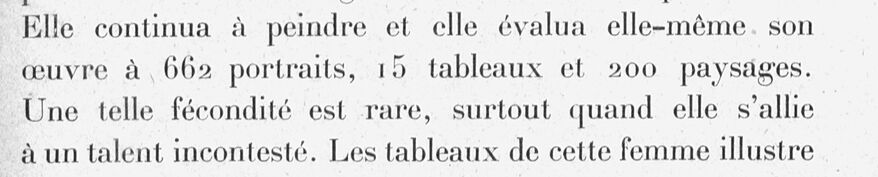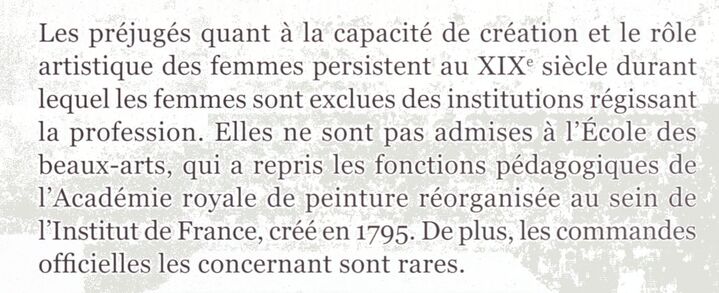Le style d’Elisabeth Vigée Lebrun, peintre de la reine (2)
Le style d’Elisabeth Vigée Lebrun fait d’« un je ne sais quoi » plaît aux grands de ce monde, séduit la reine et la cour. De la gloire à l’exil, la quinzième et dernière académicienne, seule à traverser l’histoire, vient clore notre série de billets de blog Gallica sur Les femmes artistes à l’Académie.

Ce portrait qui représente la souveraine vêtue d’une simple robe blanche (gaulle) fit scandale au salon de 1783, aussitôt remplacé par Marie-Antoinette à la rose, plus conforme à l’image de la majesté royale (voir infra). Dans cette représentation audacieuse faisant fi des robes à paniers, perruques et autres corsets, la reine ainsi reléguée au rang d’une simple domestique « en chemise » choque une opinion publique attachée aux pompes de la cour et déjà beaucoup moins bienveillante à son égard. La légèreté de la tournure mise au point par Elisabeth Vigée Lebrun, approuvée dans le cercle protocolaire de la royauté, illustre un des aspects singuliers de son style.
Le style d’Elisabeth Vigée Le Brun : « un je ne sais quoi» qui plaît
Nous l’avons vu, Elisabeth Vigée Lebrun a acquis une culture picturale approfondie retranscrite de façon sensible dans un certain nombre de tableaux. Mais cela ne suffit pas à expliquer l’incroyable succès que rencontrent ses portraits auprès d’une clientèle de nobles, de bourgeois et d’artistes. Ces tableaux se vendent cher. La lecture de ses Conseils pour la peinture des portraits permet de comprendre certains procédés mis en œuvre par l’artiste qui vont bien au-delà de la seule capacité à saisir la ressemblance. « Avant de commencer, causez avec votre modèle ; essayez plusieurs attitudes… » pour des séances de poses courtes afin de ne pas ennuyer le modèle, préconise entre autres l’artiste. Le portrait de la Duchesse de Chartres croisée dans le jardin du Palais-Royal lance sa carrière de peintre auprès de l’aristocratie et plus particulièrement auprès des femmes. L’observation bienveillante de la nature humaine aspirant à se faire représenter sous son meilleur jour, conjuguée à la tradition bien française du portrait flatteur, lui insuffle une réponse parfaite pour les satisfaire :
Elisabeth Vigée Lebrun en possession de solides bases techniques met en place un certain nombre de recettes propices à pallier les défauts de physionomie et donner plus d’attrait à sa peinture de portraits que Diderot appelle « une caricature en beau » :
Le portrait de la baronne de Crussol atteste du « niveau de maîtrise et de raffinement où elle est parvenue. Sa gamme de gris n’a guère d’équivalent à part chez Goya ». Le visage laissé dans la pénombre en devient plus mystérieux et donne à la baronne un air rêveur, illustrant un des principes de travail de la portraitiste :