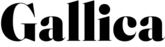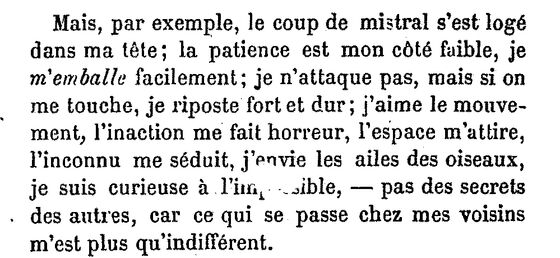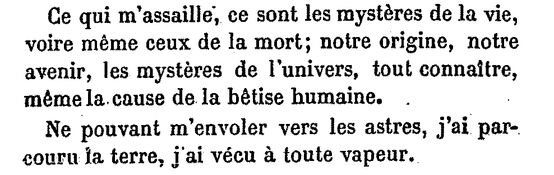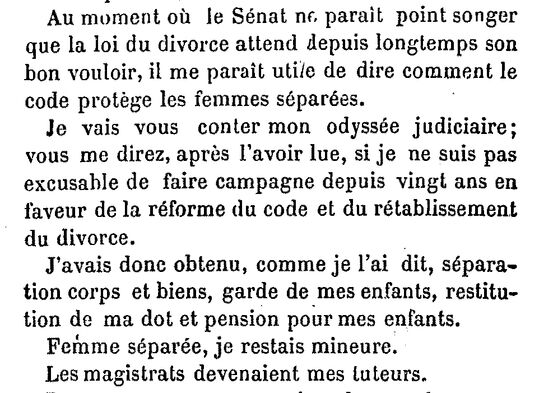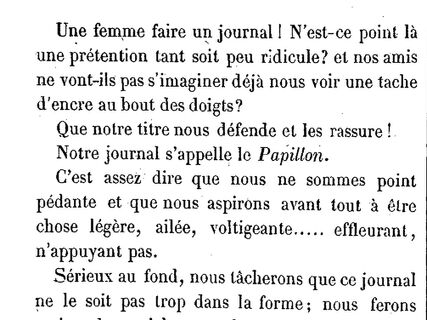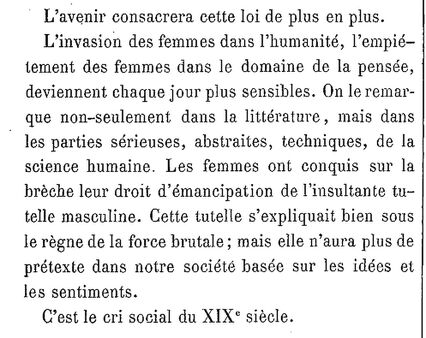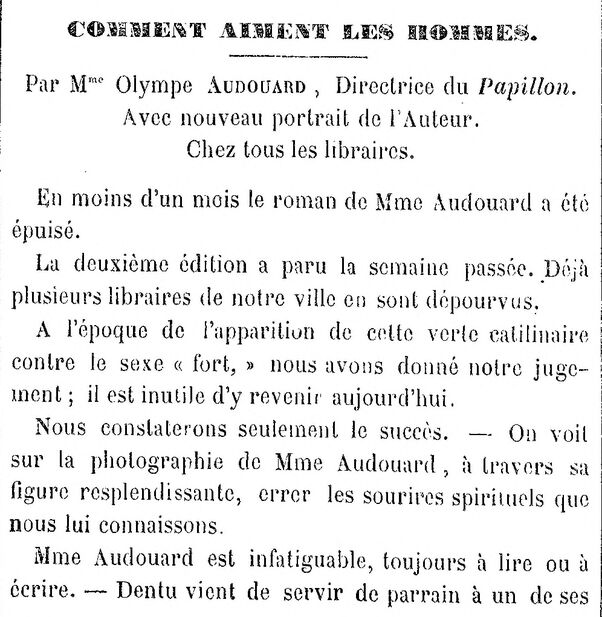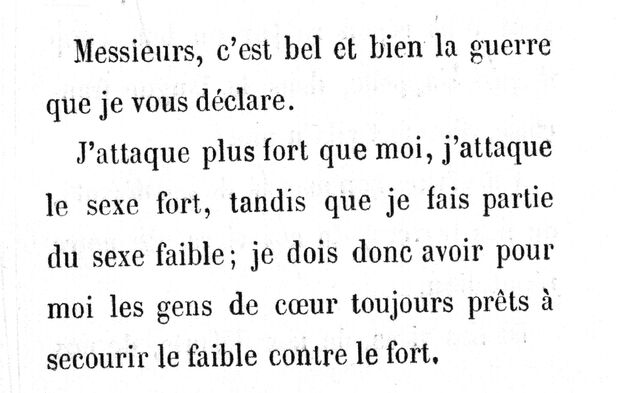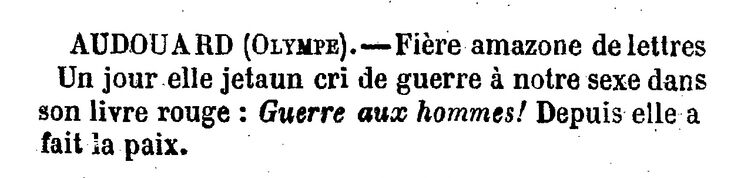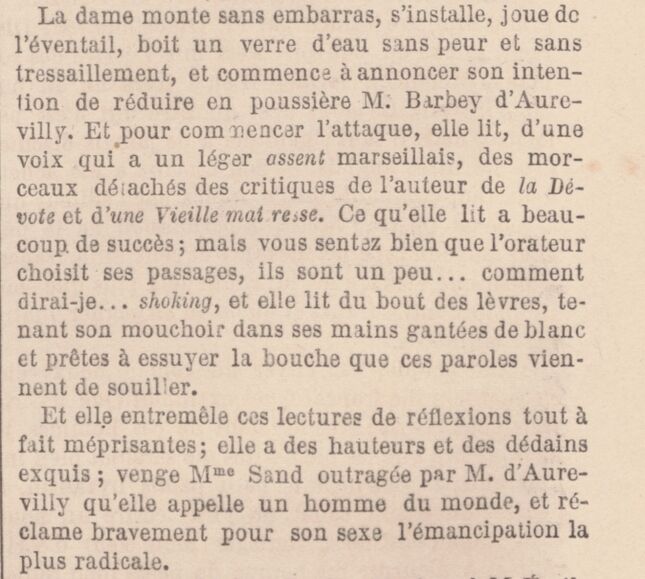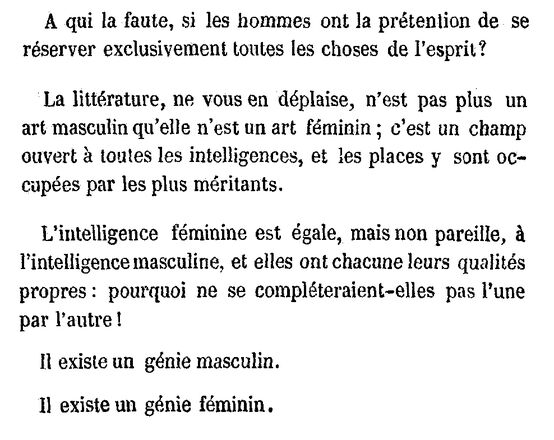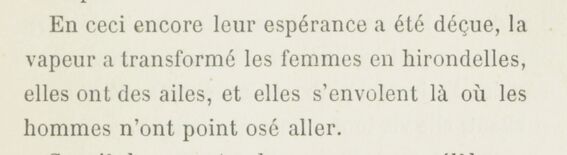Olympe Audouard et la cause des femmes
Elle raconte dans son autobiographie, Voyage à travers mes souvenirs : ceux que j'ai connus ce que j'ai vu (1884) qu’elle est « née du mistral » à Marseille, le 11 mars 1832.
Grâce à lui, écrit-elle, « j’ai bravé avec énergie et sans scrupules le préjugé qui veut qu’une femme ne soit ni auteur ni conférencière, qu’elle ne se lance pas dans des voyages périlleux et que la politique soit lettre morte pour elle ».
Mais son père, malheureusement, suit la coutume pour ce qui est de choisir pour elle un mari. À 18 ans, en 1850, elle épouse un cousin germain, Alexis Audouard, très jeune aussi, 21 ans, qui deviendra notaire. Il est volage et violent, selon Émile Blavet. Elle lui donne deux fils, Louis-Marie et Camille, qui tous deux mourront assez jeunes. Mais en 1858, elle le quitte, part pour Paris et demande la séparation de corps.
Le Code civil de Napoléon alors en vigueur ravale la femme au rang de mineure et le divorce lui est interdit. Elle doit donc lutter pour obtenir la garde de ses deux petits garçons, et se dégager du droit de regard de son mari, pourtant parti refaire sa vie en Algérie, sur ses dépenses et ses activités. Elle reste toutefois sous tutelle judiciaire : Dans La femme dans le mariage, la séparation et le divorce, une conférence donnée le 28 février 1870, elle précise : « Une femme doit aimer son mari, ou tout au moins, subir son amour ! On appelle cela les devoirs de l’épouse […]. Il est brutal, cruel pour elle, il l’abreuve d’humiliations… N’importe, elle doit se soumettre à sa tendresse bestiale d’un moment ! Il est viveur, débauché, il ne lui inspire qu’une insurmontable répulsion… N’importe, elle doit remplir ses devoirs d’épouse ! » (p. 22) […] « La femme obtient-elle la séparation, sa vie n’en est pas moins brisée : la voilà lancée seule dans le monde ; vivrait-elle en recluse et serait-elle une sainte, le monde malveillant la critiquera, elle restera une femme déplacée. […] Elle est en tutelle, mais cette tutelle n’est jamais protectrice… elle la gêne souvent pour gagner sa vie, elle ne l’empêche jamais de mourir de faim. » (p. 27).
Olympe Audouard n’obtiendra le divorce qu’en 1885, à 53 ans, lorsque la Loi Naquet l’aura enfin autorisé en 1884. Un entrefilet de L’Intransigeant, le 26 octobre 1885 précise qu’elle n'est autorisée à conserver son nom de plume que parce qu'il est aussi le nom de jeune fille de sa mère.
Le cri social du XIXe siècle
Olympe Audouard s’introduit assez vite dans les cercles littéraires parisiens, et profite de l’essor de la presse pour se lancer, pour gagner sa vie, dans une carrière de journaliste.Elle brave ainsi la réaction de son mari, qui fait défense à sa femme, par ministère d'huissier, « de prostituer son nom en l'imprimant dans les journaux ! » (nom que la loi l’oblige à conserver), mais aussi l’opinion générale, qu’elle évoque dans son premier éditorial, le 10 janvier 1861 :
Comment aiment les hommes
Elle publie aussi en 1862 un premier roman au titre provocateur Comment aiment les hommes, un roman sentimental épistolaire qui aboutit à une longue conclusion manifeste où on lit par exemple :Ce roman rencontre un grand succès, dont témoigne cet article du Fantaisiste, où Olympe écrit parfois, le 15 juin 1862 :
Guerre aux hommes
Quelques années plus tard Olympe récidive avec un essai crânement intitulé Guerre aux hommes (1866), qui commence ainsi :Après ce préalable, elle élabore tout un bestiaire masculin et s’amuse à décrire « quelques vilains types d’hommes » qu’elle assimile à des animaux : l'homme-crapaud, l’homme alouette, l’homme caméléon, ou l'homme moustique, par exemple. Elle évoque aussi les hommes qui se vendent, plus méprisables de le faire par ambition et non par nécessité.
Ce livre lui vaut d’être ainsi définie dans Le Petit Vapereau, annuaire satirique (1870) :
Une conférencière pleine d'humour
Pour voyager, Olympe a abandonné le Papillon en 1863. En 1867, lorsqu’elle tente de créer un autre journal, La Revue Cosmopolite, cela lui est refusé par le ministre de l’Intérieur … au prétexte qu’elle est femme ! Elle prend alors sa plume pour une Lettre aux députés. « Les droits de la femme. la situation que lui fait la législation française ». Elle leur écrit : « La lettre impériale du 19 janvier semblait nous promettre des horizons nouveaux : tout Français se trouvait libre de fonder un journal politique. Je crus comprendre que ce mot Français voulait dire tout être intelligent des deux sexes » et conclut très ironiquement : « en réclamant pour la Française la jouissance de ses droits civils et politiques, que pouvez-vous craindre ? Qu'elle soit électrice et éligible ? Quel préjudice cela porterait-il à la grandeur de la France et à la sécurité du pays ? Craindriez-vous, par hasard, messieurs les Députés, que votre dignité et celle de la Chambre fussent compromises si des femmes venaient y siéger à côté de vous ? […] Craindriez-vous qu'avec l'élément féminin la Chambre ne perdît de son sérieux et de sa gravité ? Mais, si j'ai bonne mémoire, l'an passé vous y avez parlé crinoline, vous y avez fait quelques spirituelles allusions à la famille Benoiton, voire même au fameux sapeur, trois graves questions peut-être, mais qui n'ont rien de commun avec la discussion du budget, la paix ou la guerre. Et pourtant vous n'étiez qu'entre hommes ! ».Elle donne aussi de multiples conférences, en France et à l'étranger, qui sont de véritables spectacles : elle se montre très convaincante, mais aussi volontiers drôle, souvent actrice. En témoignent divers compte-rendus, par exemple celui de Charles Yriate dans Le Monde illustré (16 avril 1870) :
ou celui a posteriori de Julien Oschsé, intitulé « La première conférence féministe (1870) » (Gil Blas, 26 janvier 1912) :
L’une de ces conférences, Monsieur Barbey-d'Aurévilly, réponse à ses réquisitoires contre les bas-bleus, le 11 avril 1870, évoque plus précisément le sort des femmes de lettres.
Jules Barbey d’Aurevilly ne cesse alors de publier des articles pour stigmatiser les écrivaines de son temps, notamment Olympe Audouard : « car madame Audouard veut penser ! […] papillon qui voudrait bien avoir un aiguillon comme une abeille, mais qui ne l’a point, qui ne l’aura jamais ». Il a 23 ans de plus qu’elle, qui n’en a alors que 36, mais il affirme « Mme Olympe Audouard est jeune encore et jolie. Du moins, elle l'était […] Devenir laide, c'est, du reste, un commencement d'homme ! ». Elle n'est qu' « un Bas-Bleu fait penser à tous les Bas-Bleus. Il y a entre eux la solidarité du ridicule d’écrire… pour écrire et pour endoctrinailler le genre humain. »
La façon dont il décrit George Sand est aussi édifiante : « C’est une pagode chinoise ou japonaise, aux gros yeux hébétés d’une rêverie sans bout, aux grosses lèvres de négresse jaunies par le cigare, ne disant mot, n’écoutant pas, fumant toujours, comme un vapeur à l’ancre, et perdu dans un engourdissement profond comme le vide. [...] Elle était dans son salon, quand un homme d’esprit y parlait, comme une vache au bout d’un pré, regardant par la brèche d’une haie une locomotive qui passe [...] Tout cela faisait un ensemble à la fois Bohémien et juif ». Et d'affirmer que « ce n’est qu’une plume un peu plus robuste que les autres, parmi ces plumes de perroquet ou de perruche que les femmes agitent ».
Habile à mettre les rieurs de son côté, Olympe contre-attaque et rend la pareille à Barbey d'Aurevilly en l’attaquant sur son physique efféminé et ses vêtements de dandy passé de mode : « Il porte des cheveux d’un beau noir, des dents d’une blancheur éclatante ; il use de la céruse, du carmin et du khôl. Dédaigneux des modes du jour, il se promène dans Paris avec jabot et manchettes de dentelles ; une bande de satin rose tendre ou de satin vert pomme orne la couture de son pantalon ; sa redingote, faite selon la coupe de 1830, serre une taille emprisonnée dans un corset ; son chapeau à larges bords est unique dans Paris et peut-être dans le monde entier. »
Elle poursuit par une analyse au scalpel de son style et de ses idées : « le bas-bleu le fait bondir, la haine qu'il lui porte est irréconciliable, c'est un sujet qui le grise, qui lui monte à la tête et lui fait perdre toute mesure. Dans cette ivresse, les phrases viennent comme elles peuvent, souvent grossières, quelquefois contradictoires, et elles manquent leur effet par leur exagération même. […] Mais il n'y a pas que les bas-bleus qu'il déteste ses antipathies s'étendent plus loin […] La philosophie moderne, les idées libérales sont pour lui des inspirations de l'enfer, elles poussent la société vers sa ruine, et la précipitent dans un abîme. […] Le mot de manant papillonne sur les lèvres de notre ennemi, celui de citoyen le met hors de lui, et je suis sûre qu'un des grands chagrins de sa vie est de n'avoir pas inventé la phrase célèbre de vile multitude. »
Elle se venge de l’allusion à sa jeunesse perdue en puisant ses exemples dans un lointain passé : « franchement rétrograde, il tient au moyen âge par ses idées politiques et religieuses ; je regrette seulement qu'il n'ait pas envers les femmes l'aimable courtoisie qui caractérisait les hommes de cette époque. » Elle défend ensuite George Sand des attaques « aussi injustes que peu courtoises » de son adversaire, puis élève le débat en affirmant l’existence d’un génie féminin, qui pourra s’exprimer lorsque la société donnera aux femmes une éducation suffisante :
Mais « On ne naît pas homme de génie, on ne naît pas savant, on naît seulement apte à le devenir ; l'intelligence humaine a besoin de culture, il faut jeter la semence pour qu'elle produise. / Pour s'instruire […] l'homme n'a qu'à se laisser aller […] tout le pousse à se débarrasser de son ignorance. […] Mais pour la femme, il n'en est certes pas ainsi, tout conspire contre elle : la maintenir dans l'ignorance est le système d'éducation le plus répandu. »
Emportée à cinquante-neuf ans, en 1890, par une mauvaise grippe, Olympe Audouard n’aura pas vu la progression des idées féministes à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Mais à sa manière très personnelle, elle a fait partie de celles qui dans un XIXe siècle particulièrement misogyne leur ont ouvert la voie en offrant aux femmes de nouveaux horizons :
Pour aller plus loin
- Liesel Schiffer. Olympe. Être femme et féministe au temps de Napoléon III. Vendémiaire, 2021
- Olympe Audouard. Guerre aux hommes. Espaces & signes, 2020
- Isabelle Ernot. « Olympe Audouard dans l’univers de la presse (France, 1860-1890) », Genre & Histoire, printemps 2014
- Christine Genin. « Olympe Audouard, des duels et des ailes ». Fières de lettres. Libération, 3 juin 2021
- Roger Musnik. « Olympe Audouard (1832-1890). Romancière populaire du XIXe siècle ». Blog Gallica, 9 juin 2021
- Bénédicte Monicat. « Écritures du voyage et féminismes », French Review, octobre 1995
- Femmes de lettres à la BnF