Titre : La Fronde / directrice Marguerite Durand
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1898-07-21
Contributeur : Durand, Marguerite (1864-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327788531
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 21 juillet 1898 21 juillet 1898
Description : 1898/07/21 (A2,N225). 1898/07/21 (A2,N225).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k67033441
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, GR FOL-LC2-5702
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/01/2016
ricmcnta, l'expression de mes sentiments les
* («lus dtstintaaM. LABORI,
1 Avocat à la Cour d'appel.
Une lettre de Bjornson
Emile Zola a reçu de Bjornstjerne-Bjorn-
ton, la lettre suivante :
A JfOttttCM!* Emite Zola
Paris
Cher MaUre,
Je suis on ee momea" kMaaicà. Une des célé-
brités de cette ville, bien connue à Paris, a eu
l'occasion, ces jours-ci, de s'entretenir avec le
chancelier de l empire aUsqMsrd, le prince de
lIobcnlohc. Sur sa demande, le prince lui a
assuré, sans hésitation, qu'Alfred Dreyfus
n'a jamais eu aucuns rapports avec l'Alle-
magne et qu'il est, sur ce point, tout à fait
innocent. Le prince-a nommé 1* vtai coupable.
• Mais faites attention, a-t it ajoute, les Fran-
çais ne permettront Jamais la révision du pro-
cès. Dreyfus mourra comme la juif de .Naza-
reth qui a dû porter les péchés des autres. • _
Je Us dans le journal de l'Etat-Major franca!e.
Y Echo de Paris. qu'Alfred Dreyfns a aussi livré
les secrets de la France à l'Italie. Cela est bien
Incroyable, après la déclaration formelle du
ministre de la guerre italien, disant à la
Chambre qu'Alfred Drey/us n'a jamais eu af-
faire avec n'importe quelle agence italienne.
J'ai passé mon hiver à Rome, où l'on suppo-
Bail généralement que cette déclaration, dédai-
gnée par l'Etat-Major français, provenait du roi
même. Je sais (lue le martyr de rite du Diable,
a toute la sympathie de la cour royale. Elle dé-
sire chaudement la révision, comme, du reste,
toute !'tta!ic. ,
En tlehorj de cela, je sais qu'à 1 „ occasion de
la première interpellation sur Tanairc Dreyfus,
au Palais-Bourbon, au temps où il n'était pas
encore question d'Esterha/.y, un professeur de
Florence apprit par un ofilcicr de l'état-major
italien qu'Alfred Dreyfus n'était pas le coupa-
ble, mais que c'était un autre officier plus âgé
et d'un grade pins élevé. a
Puur tout ce que j'ai dit dans cette lettre je j
peux donner les noms de mes garants. Ils sont i
tous prêts à témoigner. ,, .
Croyez, cher ami, à ma sympathie do,;vouéa.
BJORNSTJERNK BJORNSON.
LA GUERRE
Le général Shafter va avoir à lutter con-
tre des rebelles, attendu que te général
Blanco encourage de toutes ses forces les
résistances; c'est ainsi qu'on nous a signalé
une action devant Manitanillo dans laquelle
une chaloupe canonnière, et trois steamers
cûtiers ont été coulés. Or, par ordre du gé-
neral Shaftor les troupes espagnoles ont
reçu avis que si elles ne consentaient pas
à rendre leurs armes, elles ne pourraient
pas être rapatrices plus tard et qu'elles se-
raient traitées en prisonnières de guerre.
D'autres difficultés surgissent da côté de
Cuba. Les bandes insurrectionnelles espé-
raient mettre Santiago au pillage. Des or-
dres précis du cabinet de Washington ont
empèchú que le triomphe des armes amé-
ricaines ne fut le prélude d'un massacre.
Les instructions du président Mac-Kinley
au général Shafter ont exprimé l'absolue
volonté de l'investir d'une entière respon-
sabilité et d'établir l'ordre, la justice, la
paix biens dans l'intérêt de tous. La sécurité des
iens et des personnes est pleinement as-
surée. La proclamation du général shafter
contient comme chef principal celte phrase
significative : IC Les Américains ne sont pas
venus pour faire la guerre aux habitants
de Cuba ou à aucun des partis qui divisent
l'ile, mais pour les protéger dans leurs
biens, dans leurs intérêts et dans leurs
droits religieux,il y aura aussi peu de sévé-
rité que possible.
Malgré celte réconfortante »... parole , la , dé-,.
pêche qui nous parvient de Santiago laisse
pressentir que l'apaisement est loin de se
faire. " Les officiers et les soldats améri-
cains » nous écrit-on, sont très imprcs-
s)o:tu''s par la tension toujours croissante
do leurs relations avec les insurgés. Cet
état de choses est si accentué que toute
communication entre les deux armées a
virtuellement cessé ; leurs rapports sem-
b'ent plutôt ceux d'ennemis que d 'auiés.
« Ouaiul le général Shafter a annoncé sa
décision de ne pas permettre à la junte in-
d'cnlrer dans la ville, des murmures
ont éclaté parmi les hommes de Garcia qui
espéraient piller Santiago comme ilsavaient
déjà saccagé Baïquiri et Siboney.
.. Castillo, frère du général Demetrius
Caslilln, s'est reudu vendredi dernier au
(lu:1 ri ¡tor général et a demandé au général
Sha:tt'r pourquoi Santiago devait rester
entre les mains de leurs ennemis.
t' Le général Shafler lui répondit:
« Les Espagnols ne sont pas nos ennemis;
nous luttons contre les soldats de l 'Lspagiie
mais nous ne voulons pas voler ses conci-
toyens. Aucun Cubain ne sera autorise à
entrer dans la ville. Je crois probable qu a-
pr» s le départ de l'armée américaine 1 ad-
m iuislralioD de la ville sera transférée entre
vos mains, mais pas avant ».
« Castillo, n'a pas dissimule son mecoo-
ement.i- Garcia a reftisé l'invitation tlii générât
Shaner d'assister à la cérémonie du déliloie-
ment du drapeau américain sur cannage.
Depuis lors, les insurgés restent dans leur
camp; ils acceptent néanmoins les vivres
américains.
.. Le général Shafler a télégraphié la liste
des prisonniers de Santiago qui lui a été
remise hier par le général Toral. Le total
de celte liste est de 22,780 hommes, c est à
dire que le nombre des prisonniers est plus
élevé que celui de l'armée de Shafter. »
On le voit, d'après cette relation câblée
aux sources américaines, les négociations
pacifiques seront longues à débattre, les
conclusions auront quelque peine £ en
sortir, à dégrever la situation faile. De la
révolution préconisée par les Etats-Unis
doit naître une législatlon-de aqncorde et
de progrès, une sécuritéjtaatfBfwbitraire,
une évaluation de toutis Ilo teces pour
cette société qui com»»W Il faut que
ceux qui-ent souffert, en Montant les éche-
lona saaértaurs s'effappent d'étouffer en
eus toaros aspiration le représailles. Les
C8llai:ù la eoàaprendrsat difficilement. Ils
forment pourtant un peuple neuf qui va de-
voir son existence et 88 immunités so-
ciales à la grande République de Washing-
ton, laquelle n'a consenti à la guerre his-
nano-améftaaine qae ponrmargaBr une des
taupes de la civilisation, e'eat-à-dire remet-
tre en l'état les droite ce*taetife et les droits,
individuels des peuples trop longtemps
écrasés dans les ornières de la féodalité
espagnole.
IBO.
LES FEMMES
employées de banque
LES FEMMES ET LA BANQUE. — CONDITIONS
DU TRAVAIL ET SALAIRES. — MUTUALITÉ
ET PRÉVOYANCE.— LES CAISSES DE RE-
TRAITE. — L'ORPHELINAT DES EMPLOYÉS
DE BANQUE.
Les minutieuses occupations fdo bu-
reau, la comptabilité, la banque offrent
aux femmes un travail dont elles s'ac-
quittent à merveille. Il ne faut pour
cela que de l'intelligence, de l'assiduité,
de la patience et de la bonne volonté, or
ce sont là justement par excellence des
qualités féminines.
Que deviendraient les jeunes fiUes ins-
truites, mais pauvres, sans ces occupa-
tions qui leur permettent d'utiliser leurs
connaissances. La carrière d'institutrice
est aujourd'hui si encombrée. les grands
magasins ne peuvcntsatisfaireàtouteslcs
demandes d'emploi qui ieur arrivent, il
faudrait bien que celles-ci se rabattissent
sur la couture — ce travail à domicile si
mal rétribué — ou sur l'atelier et l'usine.
Elles sont nombreuses celles qui s'es-
timeraient — à tort ou à raison — dé-
classées dans une profession ouvrière.
La Banque justement leur offre un mi-
lieu qui leur-semble plus élevé, où leur
éducation, leur sensibilité ne sont pas
froissées par des contacts souvent péni-
bles.
Elles sont bien réellement les privilé-
giées du travail, elles ignorent ces tran-
ses douloureuses de l'ouvrière, assurée
aujourd'hui d'avoir un salaire, mais qui
ne sait pas s'il en sera de môme le lende-
main. C'est une quiétude pour la mère,
pour la jeune fille, que la stabilité du tra-
vail, avec la certitude du salaire mensuel
permettant de fixer par avance, dans tous
les détails le modeste budget des dé-
penses.
A la Banque de France
C'est la Banque de France qui.la prc-
mière, donna l'exemple de l'emploi des
femmes dans ses divers services. Les
plus importantes maisons de Paris et de
province l'ont ensuite imitée.
L'emploi des femmes à la Banque de
France remonte à 1852,lors de la création
du service des Dépôts. Nous empruntons
ces détails à une intéressante communi-
cation, de M. Gerbeaud à la Société pour
l'amélioration de la femme et la revendi-
cation de ses droits.
Au début, le service des Dépôts em-
ployait quatre ouvrières. Il y en avait
quatre autres à l'impnmerie et à la comp-
Labilité des billets. Leurs salaires va-
riaient de 2 fr. à 3 francs par jour, sans
qu'il y eût aucune règle fixe pour l'aug-
mentation.
Le nombre des employées augmenta
rapidement ; ainsi en 1872 elles étaient
au nombre de 108. En 1875 il fut élevé à
312 ; on chargea les femmes de la vérifi-
cation et de l'annulation des billets de 5,
20 et 25 francs. Puis,ce travail acbcvé,on
en licencia un certain nombre, elles n'é-
taient plus que HX) en 1882 ; aujourd'hui
elles sont plus de 300.
Les salaires se sont beaucoup amélio-
rés. Depuis i885 les employées débutent
à 3 fr. 30 par jour soit Ofr. 55 par heure
ou 1.023 fr. de traitement annuel, l'année
étant comptée de 310 jours de travail.
Après 3 ans elles ont 3 fr. 85 par jour;
après G ans, 4 fr. 40; après 9 ans, 4 fr. 95;
après 12 ans, 5 fr. 50; après 20 ans,
6 fr. 05..
La journée réglementaire est de 0 heu-
i J'CS avec un repos de 1 heure pour le
déjeuner. Les heures supplémentaires
sont comptées il part. Avec les heures
supplémentaires le salaire s'élève.
Pour les ouvrières à 3 fr. 30 à 1,200 fr.
— 3 fr. 85 à 1,400
— 4 fr. 40. a 1,600
— -4 fr. 95 à 1,800
— 5 fr. 50 à 2,000
— 6 fr. 05 à 2,200
Les Caisses de retraite
D est peu de corporations où l'on ob-
serve un tel développement des insttta»
tions de prévoyance et de mutualité. s0-
ci été de secours mutuels, caisses de pré-
voyance, caisses de retraites,tout cela est
admirablement organisé ; on. vient mème-
de fonder on orphelinat des employés da
baffle.
LE caisse de retraite de la Benne cie-
Fiance, fondée en 1813,eSt alimenta» par
lesre venus d%ne somme de500^)00 francs
avancée par la Banqae à cet effet, et un
prélèvement de 1 010 sur les salaires fé-
minins. Les ouvrières sont ainsi assurées
d'une pension qui s'élève. :
après :',0 ans de service à 600 fr.
à 55 ans, après 25ans de service à @QQL» -,
à 00 ans, après 20 ans de service à400*
Les employés de banque qui n'appar-
tiennent pu à la Banque de France, .
également fondé une caisse de retraite.
Après une longue discussion on a voté
par Ii voix contre 28, l'admission des
femmes employées.
M. Sam&m a fort judicieusement fait
remarquer qu'on ne pouvait exclure les
femmes, parce qu'elles entrent pour la
moitié, quelquefois pour les deux tiers
dans la composition du personnel de cer-
taines banques. Il ajoutait que les chefs
de maisons n'accepteraient jamais cette
distinction entre les membres de leur
personnel et refuseraient leurs sympa-
thies et môme leurs souscriptions à la
caisse de retraite.
La caisse de retraite des employés de
banque compte aujourd'hui une ving-
taine de membres titulaires dames.
Caisses de prévoyance
Une « Association mutuelle des em-
ployées de la Banque de France » a été
fondée en 1874. Les membres paient une
cotisation de 1 fr. par mois à laquelle
s'ajoute une subvention annuelle de la
Banque de France.
Cette Société a pour but de suppléer
au salaire en ca3 de maladie. Les em-
ployées reçoivent 3 fr. par jour ; le mé-
decin et les médicaments sont gratuits.
En dehors de la Banque de France, il
existe également une Association ami-
cale des employés, mais cette société n'ad-
met pas les femmes. Elle donne comme
raison, que les risques de maladie sont
beaucoup plus considérables pour ce
sexe que pour le sexe fort. Mais le jour
viendra sans doute, où les employées
fonderont elles-mêmes une Société de
secours mutuels.
Orphelinat des employés de
banque
La solidarité des employés de banque
est très vive. Quelle meilleure preuve
de leur bienfaisante activité que la créa-
tion d'une œuvre aussi inléressante,a.ussi
1 désintéressée, aussi féconde en heureux
résultats qu'un orphelinat 1
Il est fondé depuis un mois à peine et
il compte déjà un grand nombre de
membres titulaires. On vient de recevoir |
les deux premières dames « C'est déjà
un commencement » m'écrit le sympa- j
thique président, M. Ovadia, qui a bien
voulu m'initier au fonctionnement de
toutes ces œuvres.
L'Orphelinat a pour but do protéger
l'enfance, de recueillir les orphelins des
membres titulaires, quel que soit leur j
âge, de subvenir à leurs premiers be-
soins, de veiller à leur éducation, de
leur assurer l'instruction, l'apprentissage
d'une profession en rapport avec leurs
aptitudes et de leur faciliter plus tard,
dans les limites de ses ressources, les
débats de leur carrière. Il ne faitpoint
de distinctions entre les enfants légitimes
et les illégitimes.
Lorsqu'ils peuvent se suffire à eux-
mêmes, il leur continue ses conseils et
son appui moral.
Mais il faut pour une œuvre de ce
genre, beaucoup d'argent. Les modiques
ressources des membres titulaires ne
pourraient y subvenir, si les membres
honoraires et les dames patronnesses, ne
leur venaient en aide. Ces dernières sont
déjà nombreuses, il est à souhaiter que
leur nombre augmente encore. Quel
meilleur emploi de la richesse que celui
qui consiste à protéger l'enfant, à élever
l'orphelin, à lui donner,avec une instruc-
tion solide, une éducation parfaite, la
profession qui en fera plus tard un
i homme utile à la société.
CLOTILDE DISSARD.
DES AFFAIRES!
Xa de nos confrères du Tonkin, dans un
article récent, établit une statistique fort
suggestive sur les affaires commerciales
(lui pourraient être faites par la Métropole
et ses colonies.
« On est frappé, dit-il, de la masse énorme
de denrées provenant des pays tropicaux
fournies à la France par l'Etranger. »
Examinant lie nroduitrdont l'importa-
tion chez nom est Je plus considérable,
notre confrère a consisté !M proportions
suivantes :
Sur 65,183,586 kilos de aJ1 qui entrent
dans ou ports, 785,525 seulement provien-
«ealde ms colonies, soit 1,883,673 francs
sur 115 millions 1
Hais l'on sait que nos colonies commen-
cent seulement à produire du café, et que,
sauf les anciennes plantations de la Marti-
nkaae, de la Réanion et de quelques autres
peins de nos possessions, es sont surtout
lie colonies étrangères qui, jusqu'à pré-
..... étaient seules en mesure d'alimenter
notre consommation : Bourbon, Libéria,
Java, Zanzibar, etc.
Le public sait peut-être que des essais
ont été courageusement entrepris par nos
colons en Nouvelle-Calédonie, au Dahomey,
et surtout à Madagascar, dont les produits
nous soat tnnonoés comme prochains et
excellents. ,
La proportion indiquée est donc appelée
à sa tout en laveur de nos pos-1
sessions.
Les clous de girofle, la -vanille, la ea-
nelle et le poivre ne comptent pas tout à
fait pour moitié dans les importations. Il
en est de même pour les arachides.
Mais les différences s'accentuent d'une
manière bien plus défavorable lorsque 1'011
prend : le coton,dont l'étranger nous four-
nit pour près de ICI millions alors que
nous en achetons pour 20,080 francs à nos
colonies 1
On ignore sans doute chez nous que le
coton d'Egypte, dont on a fait des essais do
culture en Algérie et qui a donné des pro-
duits magnifiques, n'a pu trouver d'indus-
triels se chargeant de le décortiquer sur
place. Nous en avons vu des échantillons,
déclarés par les spécialistes les plus beaux
du monde, comme grosseur et blancheur :
il aurait fallu les envoyer dans !e Nord pour
les faire tisser. Devant ceLLe perspective, les
agriculteurs ont renoncé a une culture
qu'ils prévoyaient exceptionnellement ré-
munératrice, A la condition d'avoir sur place
ou à proximité des usines de décorti-
quage.
Mais ce n'est pas tout : les laines de nos
colonies, Algérie et Tunisie comprises, en
trent en France pour 6 millions et demi,
tandis qu'il en vient de l'étranger pour 393
millions de francs.
Nous devons noter, pour cet article, les
espérances qui nous ont été apportées par
les explorateurs au sujet des nombreuses
régions récemment acquises à notre do-
maine colonial dans l'Afrique occidentale et
li Madagascar notamment.
Nous ne parlerons pas des730 mille francs
de bois d'ébénislerie envoyés par nos colo-
nies à côté des cinq millions de francs payés
pour les mômes matières à l'étranger.
Lorsqu'on se plaintde cela aux négociants,
ils vous répondent que les stocks en réserve
au Havre et à Bordeaux demanderont do
longues années pour s'épuiser l Cependant
l'étranger continue à fournir les plus gros-
ses quantités de bois, sans doute pour
donner aux nôtres lo temps ile sécher...
Nous passons sur les bois de Leinture, un
million de nos colonies contre dix-sept du
l'étranger, les noix de coco, lo cacao et au-
tres denrées que nos colonies produisent
en quantités largement suffisantes pour
notre consommation et leur bien-ètre, car
il faudrait tout passer en revue.
Et puis cela nous conduirait à parler de
l'ivoire que nos indigènes du Congo et du
Dahomey vendent aux Anglais à qui nous
le rachetons bravement, à Anvers ou Li-
verpool ; de la nacre, que nos possessions
de l'Océanie sont obligées d'expédier à
Aucklanll, à Sidney et en Angleterre faute
de marché établi en France ; des bois, dont
nous parlons plus haut, achetés pour être
manufacturés en Allemagne ou en Autriche;
des fruits tropicaux qu'on se procure à
Londres à peu près au mémo prix qu'à Mus-
tapha, et tutti quanti !
Notre confrère qui a emprunté à un rap-
port de l'honorable M. Pauliat, les chiffres
3ue nous venons de rappeler, ajoute à ces
données, qu'il aurait pu faire suivre des
considérations que nous avons cru devoir
émettre, des indications d'un autre ordre,
mais tout aussi pratiques.
Il fait remarquer, avec juste raison, que
nos colonies auraient bien d'autres débou-
chés que la mère-patrie, si elles étaient en-
couragées à produire.
C'est ainsi que le riz de Cochinchine se
vendrait, sans limite de production, dans
toute la mer des Indes ; l'opium, dont la
culture a été tentée dans le Haut-Laos, fe-
rait dans cette région, une concurrence re-
doutable aux Indes anglaises, etc.
Il nous semble qu il ne faut guère se
mettre martel en tête pour remédier à cet
état de choses : combler ces lacunes dans
nos rapports avec nos possessions, déveiop-
per leurs cultures et favoriser leurs expor-
tations. Un peu d'initiative et de bonne vo-
lonté do la part de notre haut commerce,
des encouragements méthodiques et rai-
sonnés, un appui effectif au profit de nos
colons, jeunos ou vieux, expérimentés ou
non, et l'on arriverait fatalement, dans un
laps de temps plus court peut-être qu'on
no croit, à bénéficier largement des ri-
chesses encore trop peu connues de nos co-
lonies.
On parle souvent dans les discours oni-„
! ciels, de l'initiative privèe, de l'exode des
capitaux et des énergies : c'est à notre haut
commerce à donner l'exemple, il montrer,
lui qui peut attendre, ce que l'on peut obte-
I nir dans nos colonies avec de l'initiative, de
l'énererie... et de l'argent 1
ABDA.
Les Concours
DU CONSERVATOIRE
Aa.tIsWtoI un peu plus ..aoaIn'euse
qu8ax deux précédents coneon».
Sur les 26 concurrentes qui se sont
fait entendre ma cours de cette séance, il
y en au moins six qu'on aérait pu se dis-
penser de laisser concourir, et qui ont
lait preuve d'une notoire fIlfêlÙl'iW.
Heureusement, nous avons en quel-
ques bonnes surprises à l'audition de
quatre jeunes filles vraiment très remar-
quables.
Pour procéder par ordre, disons tout-
d'abord que le jury était composé de
MM. Théodore Dubois, président ; Le-
nepveu, G. Fauré. V. Joncières, P. Gail-
hard, Delmas, Dubulle et Escalats. Ces
messieurs se sont montrés fort géné-
reux. Dix des concurrentes ont obtenu
des récompenses.
Je mets à part Mlle Crépin, qui a par-
tagé le 181' prix avec Mlles Menjaud et
Truck. C'est une véritable artiste, qui
n'a plus rien à apprendre. Elle possède
une fort belle voix, très étendue, une
diction claire et nette, elle chante avec
beaucoup d'intelligence et de chaleur. Je
ne crois pas qu'elle se destine au théâtre,
mais si elle tient ses promesses, elle est
appelée au plus brillant avenir. C'est
dans l'air d'nérodiade qu'elle a concouru
et s'est imposée au public.
Mlle Menjaud, nommée la seconde est
aussi un soprano dramatique. Dans l'air
de Freyschutz qu'elle nous a chanté,elle a
fait prouve d'une grande intelligence de
diction; la voix est un peu inégale, mais
la cantatrice y remédie par de nombreu-
ses ficelles. Elle chevrote légèrement,
néanmoins, elle ajustement mérité le 2,1
premier prix qu'on lui a décerné.
Mlle Truck qui a obtenu le 3* premier
prix nous a dit avec un beau sentiment
dramatique et un style très correct l'air
du Songe d'Iphigénie en Tauride. La
voix est veloutée et très timbrée. Je si-
gnale la parfaite tenue de MUes Crépin et
Truck, qui ont été les soules à ne pas
tordre leurs bras dans tous les sens en
exécutant leur morceau de concours.
Toutes les autres concurrentes nous ont
donné le spectacle pou gracieux de leur
voir contourner les bras.en X, en Z, etc.,
ce qui est fort choquant.
Mlle Crépin est de la classe de M. Bus-
sine; Mlle Meujaud, do celle de M. Wa- '
rot; Mlle Truck est élève de M. Masson.
Deux seconds prix ont été accordés à
Mlle Riotont (classede M. Duvcrnoy) et
Mlle Hatto, (classe de M. Warot) ; Mlle
llioton est la seule de tout le concours
qui possède une voix claire et juste; elle
ne tire pas ses sons du fond de la gorge.
Elle nous a dit l'air si difficile de Jules
César d'une façon claire et nette, ave -
une excellente prononciation et un style
très correct. Elloa largement mérité cette
récompense. Mlle Hatto est une fort jo-
lie personne, dix-neuf ans à peine, qui
nous a chanté l'air de Fidelio, avec une
crânerie et une correction qui ont pro-
duit un grand effet. La voix est encore
un peu stridente et la chanteuse froide,
mais, avec un an d'études en plus. je
suis convaincue que Mlle Hit tu arrivera
à être excellente.
Mlle Torrès (classe de M. Vergnet) a
partagé le premier accessit avec Mlle
Gottrand (classe Bussine).
La première a chanté l'air de la folie
iXHamlet avec bien de la gentillesse et
de jolies recherches dans les nuances ;
la voix n'est pas très timbrée, mais, la
chanteuse est intelligente et parait douée
d'un sens artistique très développé.
Mile Gottrand a concouru dans l'air
(ÏAlceste, Où sfliçje, elle l'a dit avec une
jolie voix, de l'intelligence, mais un peu
de mièvrerie,
Enfin, trois 2"5 accessits ont été pour
Mlles Minssart (classe de M. Crosti),
Soyer (classe de M. Duprez), et Telmat
(classe de M. Vergnet).
Mlle Minssart nous a dit l'air de Judas
Macchabée avec une petite voix un peu
voilée, mais un goût exquis; elle chante
avec une adresse infinie, une grande
correction et bien de l'intelligence. Elle
méritait sûrement mieux qu'un 2e acces-
sit. Peut-êtreses notes de l'année y sont-
elles pour quelque chose.
Mlle Soyer chante aussi avec intelli-
gence, mais la voix est gutturale et la
prononciation très défectueuse. Quant à
Mlle Telmat, elle nous a chanté l'air de
Galatké't avec un peu de mièvrerie, mais
non sans grâce.
On s'est fort étonné de ne pas voir
Mlle Charles sur la liste des récompen-
ses, elle a concouru dans l'air d'Obéron,
où elle a fait preuve d'un beau sentiment
dramatique et chaleureux. La voix est
forte; ces qualités auraient dû, a mon
sens, la signaler à la bienveillance du
~ jury.
Je termine en disant que, beaucoup de
ces aerâiiii" sent remarquablement
jolies ; malheureusement, pour ce qui
est de la YOÀ:9,,il est à CQMtâtec presque
généralement que, presque toutes chan-
tent en dedans, lourdement, et avec une
difficulté ,qai devient pénible à l'auditeur
lui-même.
La prononciation est pâteuse et molle,
l'accentuation colle.
Pourquoi, aussi, ces demoiselles se
sotyt-elles toutes ornées de colliex» do
perles semblables? On aurait cru facile-
ment que c'était ua uniforme pour les
faire reconnaître. -
A vendredi, pour le concours d'Opéra*
Comique.
GABRIELLE FERRARI.
LE CRIME DE LA RUE SAINT-DENIS
Hier matin a eu lieu ainsi que nous t'a*
vions annoncé, la confrontation de l'anas-
sin Schneider, avec le corps de Mme Le-
priuce, la fleuriste de la rue St-Denis, sa
victime.
Trois inspecteurs de la Sûreté était aUé
chercher l'assassin à la prison de la Santé
où il est actuellement détenu et l'avait con-
duit dans le fiacre 10017 à la Morgue où se
trouvaient déjà MM. Feuilloley, procureur
de la République ; Ruhland, juge d'instruc-
tion; M0 Henri Robert, le défenseur de
Schneider et son secrétaire, le Dr Socquet,
et M. Cochefert, chef de la Sûreté.
Le corps de Mme Le prince qui était con-
servé dans l'appareil frigorifique en avatt
été retiré à sept heures et placé sur l'une
des dalles de l'amphithéâtre où on l'avait
recouvert d'un drap blanc.
Après avoir répondu à plusieurs ques-
tions qui lui sont posées à son arrivée, par
M. Rulhand, Schneider est introduit dans
cette pièce malgré ses supplications de ne
pas subir cette épreuve.
En eftet Schneider qui, pendant le trajet
de la prison de la Santé à la Morgue avait
été très loquace, s'était assombri subite-
ment en voyant la voiture qui le conduisait
s'arrêter devant la Morgue.
Au moment de pénétrer dans l'amphi-
théâtre ses jambes fiageollèrent sous lui et
instinctivement, il chercha à fuir; mais on.
le poussa et brusquement M. Gocheferl leva
le drap qui oachait la victime.
Schneider recula.puis tomba à genoux en
s'écriant : « Pardon, Madame « ! il fut pria
aussitôt de tremblements convulsifs ; il
ferma les yeux et perdit connaissance.
On le fit asseoir. Le docteur Socquet en-
voya chercher de l'eau de mélisse et du vi-
naigre et pendant plus d'une demi-heure
on chercha à. faire revenir à lui l'assassin
qui était dans un état cataleptique complet.
Quand enfin, il revint à lui M. Ilulhantl
voulut lui poser quelques questions, mais
il refusa énergiquement de répondre :
— Non ! pas ici, s'écria-t-il, pas ici, j'ai
peur !
EL il fut pris & nouveau de tremblements,
sos jambes fléchirent et pour la scco ndo
fois, on crut qu'il allait perdre con nais-
sance.
On l'entraîna rapidement dans la salle
liell magistrats où il fiL le récit do son
crime.
« Le 2 juin, dit-il, après avoir quitté mon.
patron à la gare, j'ai fait les courses dont il
m'avait chargé. Je m'étais attardé, car en
route, j'avais rencontré des camarades avec
lesquels j'avais pris plusieurs verres. Quand
je suis arrivé à l'atelier, j'étais très surex-
cité et je répondis très vertement aux ob-
servations que la patronne m'adressait.
Je terminais de retirer les courroies do
cuir des boîtes île fleurs que j'avais appor-
tées, quand elle mo dit quelque chose qui
me mit hors de moi.
Je tenais la courroie à la main, je la lui
jetai autour du cou, sans me rendre compte
de l'action que je commettais et je tirai.
Elle tomba. Alors seulement je compris co
que je venais de faire ; je pris la fuite.
Dans l'escalier, je me ravisai, je son-
geai qu'il me fallait gagner la fron-
tière au plus vite. Je remontai à l'ate-
ticr; avec une paire de ciseaux, je forçai
l'armoire 0\'1 j'avais vu serrer l'argent ;
je pris 600 francs et sans m'arrêter, je cou-
rus à la gare, je pris mon billet pour Noisy
oa j'attendis le premier tmin se dirigeant
sur Strasbourg.
Avant d'arriver à la frontière, je descen-
dis et gagnai par les champs et les vignes-
Mulhouse où j'ai été arrêté. »
Schneider fit tout ce récit d'une voix mo-
notone. Il s'interrompait par moment et
dt's sanglots s'échappaient. Le docteur Soc-
quet dut lui faire prendre à plusieurs re-
prises des cuillerées d'eau de mélisse car
on craignait à chaque instant une nouvelle
syncope.
Le docteur Socquet lui demanda, son ré-
cit terminé, s'il n'avait pas frappé Mme
Lo prince car on a relevé sur le cadavre de
cette malheureuse des traces assez nom-
breuses d'ecchymoses.
— Non ! non f a répondu Schneider, je n'ai
pas touché la patronne avec mes mains. Je
ne puis pas 1 je ne puis pas 1
Les magistrats jugèrent inutiles de pro-
longer cette scène pénible et à 11 heures,
Schneider était reconduit à la prison de la
Sauté.
Le docLeur Socquet a procédé dans la
soirée à l'autopsie du cadavre de Mme Le-
prince pour déterminer les causes des
ecchymoses trouvées sur son corps.
L'inhumation aura lieu vendredi matin
et la victime sera transporté aujourd'hui à
. son domicile.
TRIBUNE DE LA FRONDE
DU 21 JUILLET 1898
LA TRIBUNE
A TRAVERS L'EDUCATION
LES VACANCES
II
Nécessité des vacances pour
les externes
(2)
Cette rubrique forme - feuilleton votant
dont te sujet change tous les trois JOWM.
Mettons en regard, ai-je dit :
t- Les dispositions naturelles des en-
fants et des adolescents ;
2* Les exigences de leur développe-
ment ;
se Notre plan d'études que nous n'arri-
vons pas à simplifieir.
4" Notre système disciplinaire.
Si ces quatre numéros s'harmomsent ;
si les écoles de tout ordre comptent avec
les penchants des écoliers ; si l'hygiène
du corps et celle de l'intelligence sont
sauvegardées ; ai rien n'antfaveyédoston
et le libre essor des forces, nous serons
les externes comme une institution de
luxe, sinon...
Nul n'ignore que. sauf exceptions,
étudier dans les livres est antipathique à
l'enfance, parce que le livre est une
abstraction ; aussi est-on tenté de s'api-
tover sur le « petit » que l'on rencontre
le "sac au des, se rendant à récole. Hélas!
pourquoi le nombre de ceux qui succom-
bent à cette tentation généreuse est-il de
jour en jour plus-rest rein11
Pourquoi ceux qui ont assez aimé et
respecté les enfants pour les étudier et
apprendre à lire en eux sont-ils si timi-
des ? Pourquoi ne crient-ils pas de toute
la force de leurs poumons qu'il faut re-
mettre les choses au point? Pourquoi ne
s'efforcent-ils pas de faire comprendre
aux parents et aux maîtres que, si les
débuts sont à la fois si pénibles et si
désespérément fastidieux,c est que notre
plan pêche par la base ?
Nous devons à l'enfant, que nous vou-
lons instruire, de répondre graduelle-
ment aux sollicitations de son intelli-
gence qui l'attire d'abord vers le monde
extérieur, c'est-à-dire que nous devons
l'initier aux sciences naturelles ; nous
lui devons les moyens de communiquer
avec ses semblables par le langage - et
l'audition est, au début, le seul procédé
qui puisse être employé — nous lui de-
vons de développer son merveilleux pen-
chant à l'observation, et de la lui rendre
sensible parle dessin, et nous lui ensei-
gnons d'abord à Kre,& écrire,à orthogra-
phier toire, ! Et nous lui enseignons aussi Fliis-
rire, alors qu'il ne Dent comprendre ni
les hommes ni les faits 1 Il en résulte pour
lui, sinon une fatigue aignë, du moins
une réelle lassitude qui atrophie les
meilleures facultés de son être.
Ceete lassitude est aggmvée par une
discipline étroite cft méticuleuse dont
noos ne j!MvOMM ans à news débar-
rasser, malgré la campagne méritoire
menée par quelques individualités de-
vant. lesquelles tout le monde s'incline,
et malgré toute la bonne volonté d'un
certain nombre d'éducateurs do mé-
rite.
Dès l'école maternelle, alors qu'il fau-
drait au « petit » une liberté complète
pour assurer ses pas titubants et déve-
veloppcr son initiative, il marche accro-
ché a la robe de son potit camarade du
même âge; puis, assis, il croise les
mains sur sa poitrine ou sur son dos. A
quoi bon cette coutume que je finis par
croire indéracinable?
— Elle a pour but d'empêcher l'enfant
de tomber, de mettre les doigts dans sa
bouche, de griffer son voisin. C'est, en
somme, le début de cette discipline pré-
ventive que nons traînons comme une
chaîne pesante et qui est le contraire de
l'éducation. Bientôt, il sera défendu à
l'élevé de parler « dans les rangs », un
mouvement maladroit qui fera tomber sa
règle lui vaudra un mauvais point...
11 a fallu dix séances orageuses delà
« commission consultative de l'enseigne-
ment public » et un rapport éloquent au
conseil supérieur pour que les « pota-
ches » eussent la permission de causer
au réfectoire!
Certes, il est des moments où î élevé
doit rester tranquille et silencieux et
avoir, au moins, les apparences de l'at-
tention. n les doit au maître qui se dé-
pense, et aux camarades qui désirent
écouter. Mais entre deux leçons, pour-
quoi tant d'entraves ? pourquoi 1 immobi-
lité et le silence sont-ils considères com-
me la seule preuve du respect que roa
doit aux quatre murs de la classe?
Tiarig la rue, au logi&,les enfants se dé-
dommagent. J'en eoPAfÍl dont l'exubé-
rance comprimée au lycée se déchaîne le
toir. JleuNu ceux dont les parenta
comprennent au lieu de taper dessus 1 Il
y a quelques soirs j'entendais, chez des
amis de vrais rugissements de fauve.
« C'est Popaul qui se détend » répondit
le père à mon regard interrogateur.
Cette discipline étroite et qui rappelle
celle de la caserne, si pénible aux cita-
dins est d'autant plus insupportable aux
campagnards que les matières du pro-
gramme lui sont encore plus étrangères,
et lui paraissent moins utiles. Et puis,
comme aggravation l'école, le lycée, le
collège dévorent la journée entière. On
s'est levé pour revoir ses leçons ; on ne
se couchera qu'après avoir terminé ses
devoirs. Il n'y a pas à dire, l'écolier est
constamment sous pression, à moins
qu'il ne soit en contravention.
Et c'est pour cela que les vacances
s'imposent pour les externes comme
pour les internes. Quant aux professeurs
il ne saurait être question de les en pri-
ver, le métier, pour qui le fait en cons-
cience, étant, de tous, le plus épuisant.
« Les vacances pour tous » telle est
donc notre formule.
Mais entre le principe et l'exécution,
les difficultés fourmillent; aussi pour
qui n'écrit pas comme dans les livres ou
ne parle pas du haut de sa tête des cho-
ses de réduction — qu'il ignore—et des
inégalités sociales — qu'il aime à oublier
— il importe de s'identifier avec la réa-
lité des faits et d'énumérer les diffé-
rentes catégories d'enfants qui fréquen-
tentent les écoles de tout ordre.
Il y a 1° ceux qne l'on est convenu d'ap-
peler les « fils (ou les filles) de famille. »
C'est-à-dire les privilégiés de la fortune,
pour lesquels tout marche comme sur
ces roulettes. Us suivent pendant les va-
oanoes leurs parents dans leurs terres
o
1 tton&aines, beaucoup plas- nombreux aue.
les premiers, dont le père a des vacances
régulières. En famille, on voyage ou
bien l'on s'installe chez des parents ou
bien encore dans une location à la campa-
gne. De ceux-là, nous n'avons point à
nous préoccuper.
C'est avec la troisième catégorie — les
enfants des petits commerçants, atta-
chés à leur comptoir du ter janvier au
31 décembre — que les difficultés com-
mencent; elles s'accentuent avec la qua-
trième catégorie — les enfants d ou-
vriers — et deviennent si graves avec la
cinquième — les enfants d'indigents —
qu'on les a crues pendant longtemps
inextricables, U tombe cependant sous le
sens que les vacances sont d'autant plus
nécessaires que les enfants souffrent da-
vantage du manque de bien-être.
Aussi est-ce des plus malheureux que
l'on s'est occupé d'abord. Quelques indi-
vidus de bon cœur et de bonne volonté
agissante, ont inventé les colonies de va-
cances et les voyages scolaires ; un cer-
tain nombre de particuliers — nombre
encore trop restreint— ont ouvert leurs
bourses, les Caisses des Ecoles se sont
montrées généreuses, la cause est en-
tendue — nous le prouverons de-
main; — mais il y a toute une classe
d'enfants pour lesquels rien ne parait en-
core ébauché et qu'il ne faudrait pour-
tant pas punir de ce que leurs parents ne
sont pas les forçats du prolétariat. Je
veux parlerdes enfants de la& catégorie,
fils de petits commerçants et de modas-
tes employés attachés sans merci à leur
chaîne. Les mornes six semaines qu'ils
passent chez leurs parents 1
Ceux-ci connaissant les périls de
l'abandon dans les rues et daca les jar-
dins publies, les casament à la maison,
où ils ne tardent pas à regretter les ca-
i marades et la bone elle-méme. Or, leii-
[ Demi n'est sas 88 itoo runsfiltor; 1m
petits manquements deviennent chaque
jour plus nombreux, les gamineries plus
graves ; par malheur le pèra et la mère,
occupés et préocupés sont peu endu-
rants...
Il ne reste aux petites victimes qu'un
seul refuge : bâcler tes devoirs de va-
cances!
J'ai dit au chapitre précédent ce que
je pense de l'internat — oh ! pas tout
encore 1 — et des parents qui se désinté-
ressent de l'éducation de leurs enfants
— qui s'en débarrassent si vous préfé-
rez. Je ne serai donc pas accusée do
vouloir désorganiser les familles si je
m'étonne de notre apathie à l'égard de
cette classe si nombreuse d'enfants qui
sont privés des avantages de la richesse
et des dédommagements que la bienfai-
sance apporte à la réelle pauvreté.
Les parents qui usent si largement de
l'internat, alors que la demi-pension ou
externat surveillé, sauvegarderait à la
fois leurs affaires et tes relations étroites
de la famille, ne peuvent avoir aucun
scrupule, aucune inquiétude à les
confier pendant les vacances à des per-
sonnes d'une moralité incontestée qui
conduiraient de petites troupes d'excur-
sionnistes à la montaigne, à la mer,ou plus
modestement encore dans une propriété
buée pour la saison. Ce serait une imi-
tation à peu de frais des inoubliables
Voyages en Zig-Zay, dont Topfer a
charmé notre jeunesse.
L'association produirait des merveilles.
Voua une nouvelle occasion de se Il-:
gnaler.. - --s
PAULINE KERGOMAR.
(A swmrt
* («lus dtstintaaM. LABORI,
1 Avocat à la Cour d'appel.
Une lettre de Bjornson
Emile Zola a reçu de Bjornstjerne-Bjorn-
ton, la lettre suivante :
A JfOttttCM!* Emite Zola
Paris
Cher MaUre,
Je suis on ee momea" kMaaicà. Une des célé-
brités de cette ville, bien connue à Paris, a eu
l'occasion, ces jours-ci, de s'entretenir avec le
chancelier de l empire aUsqMsrd, le prince de
lIobcnlohc. Sur sa demande, le prince lui a
assuré, sans hésitation, qu'Alfred Dreyfus
n'a jamais eu aucuns rapports avec l'Alle-
magne et qu'il est, sur ce point, tout à fait
innocent. Le prince-a nommé 1* vtai coupable.
• Mais faites attention, a-t it ajoute, les Fran-
çais ne permettront Jamais la révision du pro-
cès. Dreyfus mourra comme la juif de .Naza-
reth qui a dû porter les péchés des autres. • _
Je Us dans le journal de l'Etat-Major franca!e.
Y Echo de Paris. qu'Alfred Dreyfns a aussi livré
les secrets de la France à l'Italie. Cela est bien
Incroyable, après la déclaration formelle du
ministre de la guerre italien, disant à la
Chambre qu'Alfred Drey/us n'a jamais eu af-
faire avec n'importe quelle agence italienne.
J'ai passé mon hiver à Rome, où l'on suppo-
Bail généralement que cette déclaration, dédai-
gnée par l'Etat-Major français, provenait du roi
même. Je sais (lue le martyr de rite du Diable,
a toute la sympathie de la cour royale. Elle dé-
sire chaudement la révision, comme, du reste,
toute !'tta!ic. ,
En tlehorj de cela, je sais qu'à 1 „ occasion de
la première interpellation sur Tanairc Dreyfus,
au Palais-Bourbon, au temps où il n'était pas
encore question d'Esterha/.y, un professeur de
Florence apprit par un ofilcicr de l'état-major
italien qu'Alfred Dreyfus n'était pas le coupa-
ble, mais que c'était un autre officier plus âgé
et d'un grade pins élevé. a
Puur tout ce que j'ai dit dans cette lettre je j
peux donner les noms de mes garants. Ils sont i
tous prêts à témoigner. ,, .
Croyez, cher ami, à ma sympathie do,;vouéa.
BJORNSTJERNK BJORNSON.
LA GUERRE
Le général Shafter va avoir à lutter con-
tre des rebelles, attendu que te général
Blanco encourage de toutes ses forces les
résistances; c'est ainsi qu'on nous a signalé
une action devant Manitanillo dans laquelle
une chaloupe canonnière, et trois steamers
cûtiers ont été coulés. Or, par ordre du gé-
neral Shaftor les troupes espagnoles ont
reçu avis que si elles ne consentaient pas
à rendre leurs armes, elles ne pourraient
pas être rapatrices plus tard et qu'elles se-
raient traitées en prisonnières de guerre.
D'autres difficultés surgissent da côté de
Cuba. Les bandes insurrectionnelles espé-
raient mettre Santiago au pillage. Des or-
dres précis du cabinet de Washington ont
empèchú que le triomphe des armes amé-
ricaines ne fut le prélude d'un massacre.
Les instructions du président Mac-Kinley
au général Shafter ont exprimé l'absolue
volonté de l'investir d'une entière respon-
sabilité et d'établir l'ordre, la justice, la
paix biens dans l'intérêt de tous. La sécurité des
iens et des personnes est pleinement as-
surée. La proclamation du général shafter
contient comme chef principal celte phrase
significative : IC Les Américains ne sont pas
venus pour faire la guerre aux habitants
de Cuba ou à aucun des partis qui divisent
l'ile, mais pour les protéger dans leurs
biens, dans leurs intérêts et dans leurs
droits religieux,il y aura aussi peu de sévé-
rité que possible.
Malgré celte réconfortante »... parole , la , dé-,.
pêche qui nous parvient de Santiago laisse
pressentir que l'apaisement est loin de se
faire. " Les officiers et les soldats améri-
cains » nous écrit-on, sont très imprcs-
s)o:tu''s par la tension toujours croissante
do leurs relations avec les insurgés. Cet
état de choses est si accentué que toute
communication entre les deux armées a
virtuellement cessé ; leurs rapports sem-
b'ent plutôt ceux d'ennemis que d 'auiés.
« Ouaiul le général Shafter a annoncé sa
décision de ne pas permettre à la junte in-
d'cnlrer dans la ville, des murmures
ont éclaté parmi les hommes de Garcia qui
espéraient piller Santiago comme ilsavaient
déjà saccagé Baïquiri et Siboney.
.. Castillo, frère du général Demetrius
Caslilln, s'est reudu vendredi dernier au
(lu:1 ri ¡tor général et a demandé au général
Sha:tt'r pourquoi Santiago devait rester
entre les mains de leurs ennemis.
t' Le général Shafler lui répondit:
« Les Espagnols ne sont pas nos ennemis;
nous luttons contre les soldats de l 'Lspagiie
mais nous ne voulons pas voler ses conci-
toyens. Aucun Cubain ne sera autorise à
entrer dans la ville. Je crois probable qu a-
pr» s le départ de l'armée américaine 1 ad-
m iuislralioD de la ville sera transférée entre
vos mains, mais pas avant ».
« Castillo, n'a pas dissimule son mecoo-
ement.i- Garcia a reftisé l'invitation tlii générât
Shaner d'assister à la cérémonie du déliloie-
ment du drapeau américain sur cannage.
Depuis lors, les insurgés restent dans leur
camp; ils acceptent néanmoins les vivres
américains.
.. Le général Shafler a télégraphié la liste
des prisonniers de Santiago qui lui a été
remise hier par le général Toral. Le total
de celte liste est de 22,780 hommes, c est à
dire que le nombre des prisonniers est plus
élevé que celui de l'armée de Shafter. »
On le voit, d'après cette relation câblée
aux sources américaines, les négociations
pacifiques seront longues à débattre, les
conclusions auront quelque peine £ en
sortir, à dégrever la situation faile. De la
révolution préconisée par les Etats-Unis
doit naître une législatlon-de aqncorde et
de progrès, une sécuritéjtaatfBfwbitraire,
une évaluation de toutis Ilo teces pour
cette société qui com»»W Il faut que
ceux qui-ent souffert, en Montant les éche-
lona saaértaurs s'effappent d'étouffer en
eus toaros aspiration le représailles. Les
C8llai:ù la eoàaprendrsat difficilement. Ils
forment pourtant un peuple neuf qui va de-
voir son existence et 88 immunités so-
ciales à la grande République de Washing-
ton, laquelle n'a consenti à la guerre his-
nano-améftaaine qae ponrmargaBr une des
taupes de la civilisation, e'eat-à-dire remet-
tre en l'état les droite ce*taetife et les droits,
individuels des peuples trop longtemps
écrasés dans les ornières de la féodalité
espagnole.
IBO.
LES FEMMES
employées de banque
LES FEMMES ET LA BANQUE. — CONDITIONS
DU TRAVAIL ET SALAIRES. — MUTUALITÉ
ET PRÉVOYANCE.— LES CAISSES DE RE-
TRAITE. — L'ORPHELINAT DES EMPLOYÉS
DE BANQUE.
Les minutieuses occupations fdo bu-
reau, la comptabilité, la banque offrent
aux femmes un travail dont elles s'ac-
quittent à merveille. Il ne faut pour
cela que de l'intelligence, de l'assiduité,
de la patience et de la bonne volonté, or
ce sont là justement par excellence des
qualités féminines.
Que deviendraient les jeunes fiUes ins-
truites, mais pauvres, sans ces occupa-
tions qui leur permettent d'utiliser leurs
connaissances. La carrière d'institutrice
est aujourd'hui si encombrée. les grands
magasins ne peuvcntsatisfaireàtouteslcs
demandes d'emploi qui ieur arrivent, il
faudrait bien que celles-ci se rabattissent
sur la couture — ce travail à domicile si
mal rétribué — ou sur l'atelier et l'usine.
Elles sont nombreuses celles qui s'es-
timeraient — à tort ou à raison — dé-
classées dans une profession ouvrière.
La Banque justement leur offre un mi-
lieu qui leur-semble plus élevé, où leur
éducation, leur sensibilité ne sont pas
froissées par des contacts souvent péni-
bles.
Elles sont bien réellement les privilé-
giées du travail, elles ignorent ces tran-
ses douloureuses de l'ouvrière, assurée
aujourd'hui d'avoir un salaire, mais qui
ne sait pas s'il en sera de môme le lende-
main. C'est une quiétude pour la mère,
pour la jeune fille, que la stabilité du tra-
vail, avec la certitude du salaire mensuel
permettant de fixer par avance, dans tous
les détails le modeste budget des dé-
penses.
A la Banque de France
C'est la Banque de France qui.la prc-
mière, donna l'exemple de l'emploi des
femmes dans ses divers services. Les
plus importantes maisons de Paris et de
province l'ont ensuite imitée.
L'emploi des femmes à la Banque de
France remonte à 1852,lors de la création
du service des Dépôts. Nous empruntons
ces détails à une intéressante communi-
cation, de M. Gerbeaud à la Société pour
l'amélioration de la femme et la revendi-
cation de ses droits.
Au début, le service des Dépôts em-
ployait quatre ouvrières. Il y en avait
quatre autres à l'impnmerie et à la comp-
Labilité des billets. Leurs salaires va-
riaient de 2 fr. à 3 francs par jour, sans
qu'il y eût aucune règle fixe pour l'aug-
mentation.
Le nombre des employées augmenta
rapidement ; ainsi en 1872 elles étaient
au nombre de 108. En 1875 il fut élevé à
312 ; on chargea les femmes de la vérifi-
cation et de l'annulation des billets de 5,
20 et 25 francs. Puis,ce travail acbcvé,on
en licencia un certain nombre, elles n'é-
taient plus que HX) en 1882 ; aujourd'hui
elles sont plus de 300.
Les salaires se sont beaucoup amélio-
rés. Depuis i885 les employées débutent
à 3 fr. 30 par jour soit Ofr. 55 par heure
ou 1.023 fr. de traitement annuel, l'année
étant comptée de 310 jours de travail.
Après 3 ans elles ont 3 fr. 85 par jour;
après G ans, 4 fr. 40; après 9 ans, 4 fr. 95;
après 12 ans, 5 fr. 50; après 20 ans,
6 fr. 05..
La journée réglementaire est de 0 heu-
i J'CS avec un repos de 1 heure pour le
déjeuner. Les heures supplémentaires
sont comptées il part. Avec les heures
supplémentaires le salaire s'élève.
Pour les ouvrières à 3 fr. 30 à 1,200 fr.
— 3 fr. 85 à 1,400
— 4 fr. 40. a 1,600
— -4 fr. 95 à 1,800
— 5 fr. 50 à 2,000
— 6 fr. 05 à 2,200
Les Caisses de retraite
D est peu de corporations où l'on ob-
serve un tel développement des insttta»
tions de prévoyance et de mutualité. s0-
ci été de secours mutuels, caisses de pré-
voyance, caisses de retraites,tout cela est
admirablement organisé ; on. vient mème-
de fonder on orphelinat des employés da
baffle.
LE caisse de retraite de la Benne cie-
Fiance, fondée en 1813,eSt alimenta» par
lesre venus d%ne somme de500^)00 francs
avancée par la Banqae à cet effet, et un
prélèvement de 1 010 sur les salaires fé-
minins. Les ouvrières sont ainsi assurées
d'une pension qui s'élève. :
après :',0 ans de service à 600 fr.
à 55 ans, après 25ans de service à @QQL» -,
à 00 ans, après 20 ans de service à400*
Les employés de banque qui n'appar-
tiennent pu à la Banque de France, .
également fondé une caisse de retraite.
Après une longue discussion on a voté
par Ii voix contre 28, l'admission des
femmes employées.
M. Sam&m a fort judicieusement fait
remarquer qu'on ne pouvait exclure les
femmes, parce qu'elles entrent pour la
moitié, quelquefois pour les deux tiers
dans la composition du personnel de cer-
taines banques. Il ajoutait que les chefs
de maisons n'accepteraient jamais cette
distinction entre les membres de leur
personnel et refuseraient leurs sympa-
thies et môme leurs souscriptions à la
caisse de retraite.
La caisse de retraite des employés de
banque compte aujourd'hui une ving-
taine de membres titulaires dames.
Caisses de prévoyance
Une « Association mutuelle des em-
ployées de la Banque de France » a été
fondée en 1874. Les membres paient une
cotisation de 1 fr. par mois à laquelle
s'ajoute une subvention annuelle de la
Banque de France.
Cette Société a pour but de suppléer
au salaire en ca3 de maladie. Les em-
ployées reçoivent 3 fr. par jour ; le mé-
decin et les médicaments sont gratuits.
En dehors de la Banque de France, il
existe également une Association ami-
cale des employés, mais cette société n'ad-
met pas les femmes. Elle donne comme
raison, que les risques de maladie sont
beaucoup plus considérables pour ce
sexe que pour le sexe fort. Mais le jour
viendra sans doute, où les employées
fonderont elles-mêmes une Société de
secours mutuels.
Orphelinat des employés de
banque
La solidarité des employés de banque
est très vive. Quelle meilleure preuve
de leur bienfaisante activité que la créa-
tion d'une œuvre aussi inléressante,a.ussi
1 désintéressée, aussi féconde en heureux
résultats qu'un orphelinat 1
Il est fondé depuis un mois à peine et
il compte déjà un grand nombre de
membres titulaires. On vient de recevoir |
les deux premières dames « C'est déjà
un commencement » m'écrit le sympa- j
thique président, M. Ovadia, qui a bien
voulu m'initier au fonctionnement de
toutes ces œuvres.
L'Orphelinat a pour but do protéger
l'enfance, de recueillir les orphelins des
membres titulaires, quel que soit leur j
âge, de subvenir à leurs premiers be-
soins, de veiller à leur éducation, de
leur assurer l'instruction, l'apprentissage
d'une profession en rapport avec leurs
aptitudes et de leur faciliter plus tard,
dans les limites de ses ressources, les
débats de leur carrière. Il ne faitpoint
de distinctions entre les enfants légitimes
et les illégitimes.
Lorsqu'ils peuvent se suffire à eux-
mêmes, il leur continue ses conseils et
son appui moral.
Mais il faut pour une œuvre de ce
genre, beaucoup d'argent. Les modiques
ressources des membres titulaires ne
pourraient y subvenir, si les membres
honoraires et les dames patronnesses, ne
leur venaient en aide. Ces dernières sont
déjà nombreuses, il est à souhaiter que
leur nombre augmente encore. Quel
meilleur emploi de la richesse que celui
qui consiste à protéger l'enfant, à élever
l'orphelin, à lui donner,avec une instruc-
tion solide, une éducation parfaite, la
profession qui en fera plus tard un
i homme utile à la société.
CLOTILDE DISSARD.
DES AFFAIRES!
Xa de nos confrères du Tonkin, dans un
article récent, établit une statistique fort
suggestive sur les affaires commerciales
(lui pourraient être faites par la Métropole
et ses colonies.
« On est frappé, dit-il, de la masse énorme
de denrées provenant des pays tropicaux
fournies à la France par l'Etranger. »
Examinant lie nroduitrdont l'importa-
tion chez nom est Je plus considérable,
notre confrère a consisté !M proportions
suivantes :
Sur 65,183,586 kilos de aJ1 qui entrent
dans ou ports, 785,525 seulement provien-
«ealde ms colonies, soit 1,883,673 francs
sur 115 millions 1
Hais l'on sait que nos colonies commen-
cent seulement à produire du café, et que,
sauf les anciennes plantations de la Marti-
nkaae, de la Réanion et de quelques autres
peins de nos possessions, es sont surtout
lie colonies étrangères qui, jusqu'à pré-
..... étaient seules en mesure d'alimenter
notre consommation : Bourbon, Libéria,
Java, Zanzibar, etc.
Le public sait peut-être que des essais
ont été courageusement entrepris par nos
colons en Nouvelle-Calédonie, au Dahomey,
et surtout à Madagascar, dont les produits
nous soat tnnonoés comme prochains et
excellents. ,
La proportion indiquée est donc appelée
à sa tout en laveur de nos pos-1
sessions.
Les clous de girofle, la -vanille, la ea-
nelle et le poivre ne comptent pas tout à
fait pour moitié dans les importations. Il
en est de même pour les arachides.
Mais les différences s'accentuent d'une
manière bien plus défavorable lorsque 1'011
prend : le coton,dont l'étranger nous four-
nit pour près de ICI millions alors que
nous en achetons pour 20,080 francs à nos
colonies 1
On ignore sans doute chez nous que le
coton d'Egypte, dont on a fait des essais do
culture en Algérie et qui a donné des pro-
duits magnifiques, n'a pu trouver d'indus-
triels se chargeant de le décortiquer sur
place. Nous en avons vu des échantillons,
déclarés par les spécialistes les plus beaux
du monde, comme grosseur et blancheur :
il aurait fallu les envoyer dans !e Nord pour
les faire tisser. Devant ceLLe perspective, les
agriculteurs ont renoncé a une culture
qu'ils prévoyaient exceptionnellement ré-
munératrice, A la condition d'avoir sur place
ou à proximité des usines de décorti-
quage.
Mais ce n'est pas tout : les laines de nos
colonies, Algérie et Tunisie comprises, en
trent en France pour 6 millions et demi,
tandis qu'il en vient de l'étranger pour 393
millions de francs.
Nous devons noter, pour cet article, les
espérances qui nous ont été apportées par
les explorateurs au sujet des nombreuses
régions récemment acquises à notre do-
maine colonial dans l'Afrique occidentale et
li Madagascar notamment.
Nous ne parlerons pas des730 mille francs
de bois d'ébénislerie envoyés par nos colo-
nies à côté des cinq millions de francs payés
pour les mômes matières à l'étranger.
Lorsqu'on se plaintde cela aux négociants,
ils vous répondent que les stocks en réserve
au Havre et à Bordeaux demanderont do
longues années pour s'épuiser l Cependant
l'étranger continue à fournir les plus gros-
ses quantités de bois, sans doute pour
donner aux nôtres lo temps ile sécher...
Nous passons sur les bois de Leinture, un
million de nos colonies contre dix-sept du
l'étranger, les noix de coco, lo cacao et au-
tres denrées que nos colonies produisent
en quantités largement suffisantes pour
notre consommation et leur bien-ètre, car
il faudrait tout passer en revue.
Et puis cela nous conduirait à parler de
l'ivoire que nos indigènes du Congo et du
Dahomey vendent aux Anglais à qui nous
le rachetons bravement, à Anvers ou Li-
verpool ; de la nacre, que nos possessions
de l'Océanie sont obligées d'expédier à
Aucklanll, à Sidney et en Angleterre faute
de marché établi en France ; des bois, dont
nous parlons plus haut, achetés pour être
manufacturés en Allemagne ou en Autriche;
des fruits tropicaux qu'on se procure à
Londres à peu près au mémo prix qu'à Mus-
tapha, et tutti quanti !
Notre confrère qui a emprunté à un rap-
port de l'honorable M. Pauliat, les chiffres
3ue nous venons de rappeler, ajoute à ces
données, qu'il aurait pu faire suivre des
considérations que nous avons cru devoir
émettre, des indications d'un autre ordre,
mais tout aussi pratiques.
Il fait remarquer, avec juste raison, que
nos colonies auraient bien d'autres débou-
chés que la mère-patrie, si elles étaient en-
couragées à produire.
C'est ainsi que le riz de Cochinchine se
vendrait, sans limite de production, dans
toute la mer des Indes ; l'opium, dont la
culture a été tentée dans le Haut-Laos, fe-
rait dans cette région, une concurrence re-
doutable aux Indes anglaises, etc.
Il nous semble qu il ne faut guère se
mettre martel en tête pour remédier à cet
état de choses : combler ces lacunes dans
nos rapports avec nos possessions, déveiop-
per leurs cultures et favoriser leurs expor-
tations. Un peu d'initiative et de bonne vo-
lonté do la part de notre haut commerce,
des encouragements méthodiques et rai-
sonnés, un appui effectif au profit de nos
colons, jeunos ou vieux, expérimentés ou
non, et l'on arriverait fatalement, dans un
laps de temps plus court peut-être qu'on
no croit, à bénéficier largement des ri-
chesses encore trop peu connues de nos co-
lonies.
On parle souvent dans les discours oni-„
! ciels, de l'initiative privèe, de l'exode des
capitaux et des énergies : c'est à notre haut
commerce à donner l'exemple, il montrer,
lui qui peut attendre, ce que l'on peut obte-
I nir dans nos colonies avec de l'initiative, de
l'énererie... et de l'argent 1
ABDA.
Les Concours
DU CONSERVATOIRE
Aa.tIsWtoI un peu plus ..aoaIn'euse
qu8ax deux précédents coneon».
Sur les 26 concurrentes qui se sont
fait entendre ma cours de cette séance, il
y en au moins six qu'on aérait pu se dis-
penser de laisser concourir, et qui ont
lait preuve d'une notoire fIlfêlÙl'iW.
Heureusement, nous avons en quel-
ques bonnes surprises à l'audition de
quatre jeunes filles vraiment très remar-
quables.
Pour procéder par ordre, disons tout-
d'abord que le jury était composé de
MM. Théodore Dubois, président ; Le-
nepveu, G. Fauré. V. Joncières, P. Gail-
hard, Delmas, Dubulle et Escalats. Ces
messieurs se sont montrés fort géné-
reux. Dix des concurrentes ont obtenu
des récompenses.
Je mets à part Mlle Crépin, qui a par-
tagé le 181' prix avec Mlles Menjaud et
Truck. C'est une véritable artiste, qui
n'a plus rien à apprendre. Elle possède
une fort belle voix, très étendue, une
diction claire et nette, elle chante avec
beaucoup d'intelligence et de chaleur. Je
ne crois pas qu'elle se destine au théâtre,
mais si elle tient ses promesses, elle est
appelée au plus brillant avenir. C'est
dans l'air d'nérodiade qu'elle a concouru
et s'est imposée au public.
Mlle Menjaud, nommée la seconde est
aussi un soprano dramatique. Dans l'air
de Freyschutz qu'elle nous a chanté,elle a
fait prouve d'une grande intelligence de
diction; la voix est un peu inégale, mais
la cantatrice y remédie par de nombreu-
ses ficelles. Elle chevrote légèrement,
néanmoins, elle ajustement mérité le 2,1
premier prix qu'on lui a décerné.
Mlle Truck qui a obtenu le 3* premier
prix nous a dit avec un beau sentiment
dramatique et un style très correct l'air
du Songe d'Iphigénie en Tauride. La
voix est veloutée et très timbrée. Je si-
gnale la parfaite tenue de MUes Crépin et
Truck, qui ont été les soules à ne pas
tordre leurs bras dans tous les sens en
exécutant leur morceau de concours.
Toutes les autres concurrentes nous ont
donné le spectacle pou gracieux de leur
voir contourner les bras.en X, en Z, etc.,
ce qui est fort choquant.
Mlle Crépin est de la classe de M. Bus-
sine; Mlle Meujaud, do celle de M. Wa- '
rot; Mlle Truck est élève de M. Masson.
Deux seconds prix ont été accordés à
Mlle Riotont (classede M. Duvcrnoy) et
Mlle Hatto, (classe de M. Warot) ; Mlle
llioton est la seule de tout le concours
qui possède une voix claire et juste; elle
ne tire pas ses sons du fond de la gorge.
Elle nous a dit l'air si difficile de Jules
César d'une façon claire et nette, ave -
une excellente prononciation et un style
très correct. Elloa largement mérité cette
récompense. Mlle Hatto est une fort jo-
lie personne, dix-neuf ans à peine, qui
nous a chanté l'air de Fidelio, avec une
crânerie et une correction qui ont pro-
duit un grand effet. La voix est encore
un peu stridente et la chanteuse froide,
mais, avec un an d'études en plus. je
suis convaincue que Mlle Hit tu arrivera
à être excellente.
Mlle Torrès (classe de M. Vergnet) a
partagé le premier accessit avec Mlle
Gottrand (classe Bussine).
La première a chanté l'air de la folie
iXHamlet avec bien de la gentillesse et
de jolies recherches dans les nuances ;
la voix n'est pas très timbrée, mais, la
chanteuse est intelligente et parait douée
d'un sens artistique très développé.
Mile Gottrand a concouru dans l'air
(ÏAlceste, Où sfliçje, elle l'a dit avec une
jolie voix, de l'intelligence, mais un peu
de mièvrerie,
Enfin, trois 2"5 accessits ont été pour
Mlles Minssart (classe de M. Crosti),
Soyer (classe de M. Duprez), et Telmat
(classe de M. Vergnet).
Mlle Minssart nous a dit l'air de Judas
Macchabée avec une petite voix un peu
voilée, mais un goût exquis; elle chante
avec une adresse infinie, une grande
correction et bien de l'intelligence. Elle
méritait sûrement mieux qu'un 2e acces-
sit. Peut-êtreses notes de l'année y sont-
elles pour quelque chose.
Mlle Soyer chante aussi avec intelli-
gence, mais la voix est gutturale et la
prononciation très défectueuse. Quant à
Mlle Telmat, elle nous a chanté l'air de
Galatké't avec un peu de mièvrerie, mais
non sans grâce.
On s'est fort étonné de ne pas voir
Mlle Charles sur la liste des récompen-
ses, elle a concouru dans l'air d'Obéron,
où elle a fait preuve d'un beau sentiment
dramatique et chaleureux. La voix est
forte; ces qualités auraient dû, a mon
sens, la signaler à la bienveillance du
~ jury.
Je termine en disant que, beaucoup de
ces aerâiiii" sent remarquablement
jolies ; malheureusement, pour ce qui
est de la YOÀ:9,,il est à CQMtâtec presque
généralement que, presque toutes chan-
tent en dedans, lourdement, et avec une
difficulté ,qai devient pénible à l'auditeur
lui-même.
La prononciation est pâteuse et molle,
l'accentuation colle.
Pourquoi, aussi, ces demoiselles se
sotyt-elles toutes ornées de colliex» do
perles semblables? On aurait cru facile-
ment que c'était ua uniforme pour les
faire reconnaître. -
A vendredi, pour le concours d'Opéra*
Comique.
GABRIELLE FERRARI.
LE CRIME DE LA RUE SAINT-DENIS
Hier matin a eu lieu ainsi que nous t'a*
vions annoncé, la confrontation de l'anas-
sin Schneider, avec le corps de Mme Le-
priuce, la fleuriste de la rue St-Denis, sa
victime.
Trois inspecteurs de la Sûreté était aUé
chercher l'assassin à la prison de la Santé
où il est actuellement détenu et l'avait con-
duit dans le fiacre 10017 à la Morgue où se
trouvaient déjà MM. Feuilloley, procureur
de la République ; Ruhland, juge d'instruc-
tion; M0 Henri Robert, le défenseur de
Schneider et son secrétaire, le Dr Socquet,
et M. Cochefert, chef de la Sûreté.
Le corps de Mme Le prince qui était con-
servé dans l'appareil frigorifique en avatt
été retiré à sept heures et placé sur l'une
des dalles de l'amphithéâtre où on l'avait
recouvert d'un drap blanc.
Après avoir répondu à plusieurs ques-
tions qui lui sont posées à son arrivée, par
M. Rulhand, Schneider est introduit dans
cette pièce malgré ses supplications de ne
pas subir cette épreuve.
En eftet Schneider qui, pendant le trajet
de la prison de la Santé à la Morgue avait
été très loquace, s'était assombri subite-
ment en voyant la voiture qui le conduisait
s'arrêter devant la Morgue.
Au moment de pénétrer dans l'amphi-
théâtre ses jambes fiageollèrent sous lui et
instinctivement, il chercha à fuir; mais on.
le poussa et brusquement M. Gocheferl leva
le drap qui oachait la victime.
Schneider recula.puis tomba à genoux en
s'écriant : « Pardon, Madame « ! il fut pria
aussitôt de tremblements convulsifs ; il
ferma les yeux et perdit connaissance.
On le fit asseoir. Le docteur Socquet en-
voya chercher de l'eau de mélisse et du vi-
naigre et pendant plus d'une demi-heure
on chercha à. faire revenir à lui l'assassin
qui était dans un état cataleptique complet.
Quand enfin, il revint à lui M. Ilulhantl
voulut lui poser quelques questions, mais
il refusa énergiquement de répondre :
— Non ! pas ici, s'écria-t-il, pas ici, j'ai
peur !
EL il fut pris & nouveau de tremblements,
sos jambes fléchirent et pour la scco ndo
fois, on crut qu'il allait perdre con nais-
sance.
On l'entraîna rapidement dans la salle
liell magistrats où il fiL le récit do son
crime.
« Le 2 juin, dit-il, après avoir quitté mon.
patron à la gare, j'ai fait les courses dont il
m'avait chargé. Je m'étais attardé, car en
route, j'avais rencontré des camarades avec
lesquels j'avais pris plusieurs verres. Quand
je suis arrivé à l'atelier, j'étais très surex-
cité et je répondis très vertement aux ob-
servations que la patronne m'adressait.
Je terminais de retirer les courroies do
cuir des boîtes île fleurs que j'avais appor-
tées, quand elle mo dit quelque chose qui
me mit hors de moi.
Je tenais la courroie à la main, je la lui
jetai autour du cou, sans me rendre compte
de l'action que je commettais et je tirai.
Elle tomba. Alors seulement je compris co
que je venais de faire ; je pris la fuite.
Dans l'escalier, je me ravisai, je son-
geai qu'il me fallait gagner la fron-
tière au plus vite. Je remontai à l'ate-
ticr; avec une paire de ciseaux, je forçai
l'armoire 0\'1 j'avais vu serrer l'argent ;
je pris 600 francs et sans m'arrêter, je cou-
rus à la gare, je pris mon billet pour Noisy
oa j'attendis le premier tmin se dirigeant
sur Strasbourg.
Avant d'arriver à la frontière, je descen-
dis et gagnai par les champs et les vignes-
Mulhouse où j'ai été arrêté. »
Schneider fit tout ce récit d'une voix mo-
notone. Il s'interrompait par moment et
dt's sanglots s'échappaient. Le docteur Soc-
quet dut lui faire prendre à plusieurs re-
prises des cuillerées d'eau de mélisse car
on craignait à chaque instant une nouvelle
syncope.
Le docteur Socquet lui demanda, son ré-
cit terminé, s'il n'avait pas frappé Mme
Lo prince car on a relevé sur le cadavre de
cette malheureuse des traces assez nom-
breuses d'ecchymoses.
— Non ! non f a répondu Schneider, je n'ai
pas touché la patronne avec mes mains. Je
ne puis pas 1 je ne puis pas 1
Les magistrats jugèrent inutiles de pro-
longer cette scène pénible et à 11 heures,
Schneider était reconduit à la prison de la
Sauté.
Le docLeur Socquet a procédé dans la
soirée à l'autopsie du cadavre de Mme Le-
prince pour déterminer les causes des
ecchymoses trouvées sur son corps.
L'inhumation aura lieu vendredi matin
et la victime sera transporté aujourd'hui à
. son domicile.
TRIBUNE DE LA FRONDE
DU 21 JUILLET 1898
LA TRIBUNE
A TRAVERS L'EDUCATION
LES VACANCES
II
Nécessité des vacances pour
les externes
(2)
Cette rubrique forme - feuilleton votant
dont te sujet change tous les trois JOWM.
Mettons en regard, ai-je dit :
t- Les dispositions naturelles des en-
fants et des adolescents ;
2* Les exigences de leur développe-
ment ;
se Notre plan d'études que nous n'arri-
vons pas à simplifieir.
4" Notre système disciplinaire.
Si ces quatre numéros s'harmomsent ;
si les écoles de tout ordre comptent avec
les penchants des écoliers ; si l'hygiène
du corps et celle de l'intelligence sont
sauvegardées ; ai rien n'antfaveyédoston
et le libre essor des forces, nous serons
les externes comme une institution de
luxe, sinon...
Nul n'ignore que. sauf exceptions,
étudier dans les livres est antipathique à
l'enfance, parce que le livre est une
abstraction ; aussi est-on tenté de s'api-
tover sur le « petit » que l'on rencontre
le "sac au des, se rendant à récole. Hélas!
pourquoi le nombre de ceux qui succom-
bent à cette tentation généreuse est-il de
jour en jour plus-rest rein11
Pourquoi ceux qui ont assez aimé et
respecté les enfants pour les étudier et
apprendre à lire en eux sont-ils si timi-
des ? Pourquoi ne crient-ils pas de toute
la force de leurs poumons qu'il faut re-
mettre les choses au point? Pourquoi ne
s'efforcent-ils pas de faire comprendre
aux parents et aux maîtres que, si les
débuts sont à la fois si pénibles et si
désespérément fastidieux,c est que notre
plan pêche par la base ?
Nous devons à l'enfant, que nous vou-
lons instruire, de répondre graduelle-
ment aux sollicitations de son intelli-
gence qui l'attire d'abord vers le monde
extérieur, c'est-à-dire que nous devons
l'initier aux sciences naturelles ; nous
lui devons les moyens de communiquer
avec ses semblables par le langage - et
l'audition est, au début, le seul procédé
qui puisse être employé — nous lui de-
vons de développer son merveilleux pen-
chant à l'observation, et de la lui rendre
sensible parle dessin, et nous lui ensei-
gnons d'abord à Kre,& écrire,à orthogra-
phier toire, ! Et nous lui enseignons aussi Fliis-
rire, alors qu'il ne Dent comprendre ni
les hommes ni les faits 1 Il en résulte pour
lui, sinon une fatigue aignë, du moins
une réelle lassitude qui atrophie les
meilleures facultés de son être.
Ceete lassitude est aggmvée par une
discipline étroite cft méticuleuse dont
noos ne j!MvOMM ans à news débar-
rasser, malgré la campagne méritoire
menée par quelques individualités de-
vant. lesquelles tout le monde s'incline,
et malgré toute la bonne volonté d'un
certain nombre d'éducateurs do mé-
rite.
Dès l'école maternelle, alors qu'il fau-
drait au « petit » une liberté complète
pour assurer ses pas titubants et déve-
veloppcr son initiative, il marche accro-
ché a la robe de son potit camarade du
même âge; puis, assis, il croise les
mains sur sa poitrine ou sur son dos. A
quoi bon cette coutume que je finis par
croire indéracinable?
— Elle a pour but d'empêcher l'enfant
de tomber, de mettre les doigts dans sa
bouche, de griffer son voisin. C'est, en
somme, le début de cette discipline pré-
ventive que nons traînons comme une
chaîne pesante et qui est le contraire de
l'éducation. Bientôt, il sera défendu à
l'élevé de parler « dans les rangs », un
mouvement maladroit qui fera tomber sa
règle lui vaudra un mauvais point...
11 a fallu dix séances orageuses delà
« commission consultative de l'enseigne-
ment public » et un rapport éloquent au
conseil supérieur pour que les « pota-
ches » eussent la permission de causer
au réfectoire!
Certes, il est des moments où î élevé
doit rester tranquille et silencieux et
avoir, au moins, les apparences de l'at-
tention. n les doit au maître qui se dé-
pense, et aux camarades qui désirent
écouter. Mais entre deux leçons, pour-
quoi tant d'entraves ? pourquoi 1 immobi-
lité et le silence sont-ils considères com-
me la seule preuve du respect que roa
doit aux quatre murs de la classe?
Tiarig la rue, au logi&,les enfants se dé-
dommagent. J'en eoPAfÍl dont l'exubé-
rance comprimée au lycée se déchaîne le
toir. JleuNu ceux dont les parenta
comprennent au lieu de taper dessus 1 Il
y a quelques soirs j'entendais, chez des
amis de vrais rugissements de fauve.
« C'est Popaul qui se détend » répondit
le père à mon regard interrogateur.
Cette discipline étroite et qui rappelle
celle de la caserne, si pénible aux cita-
dins est d'autant plus insupportable aux
campagnards que les matières du pro-
gramme lui sont encore plus étrangères,
et lui paraissent moins utiles. Et puis,
comme aggravation l'école, le lycée, le
collège dévorent la journée entière. On
s'est levé pour revoir ses leçons ; on ne
se couchera qu'après avoir terminé ses
devoirs. Il n'y a pas à dire, l'écolier est
constamment sous pression, à moins
qu'il ne soit en contravention.
Et c'est pour cela que les vacances
s'imposent pour les externes comme
pour les internes. Quant aux professeurs
il ne saurait être question de les en pri-
ver, le métier, pour qui le fait en cons-
cience, étant, de tous, le plus épuisant.
« Les vacances pour tous » telle est
donc notre formule.
Mais entre le principe et l'exécution,
les difficultés fourmillent; aussi pour
qui n'écrit pas comme dans les livres ou
ne parle pas du haut de sa tête des cho-
ses de réduction — qu'il ignore—et des
inégalités sociales — qu'il aime à oublier
— il importe de s'identifier avec la réa-
lité des faits et d'énumérer les diffé-
rentes catégories d'enfants qui fréquen-
tentent les écoles de tout ordre.
Il y a 1° ceux qne l'on est convenu d'ap-
peler les « fils (ou les filles) de famille. »
C'est-à-dire les privilégiés de la fortune,
pour lesquels tout marche comme sur
ces roulettes. Us suivent pendant les va-
oanoes leurs parents dans leurs terres
o
1 tton&aines, beaucoup plas- nombreux aue.
les premiers, dont le père a des vacances
régulières. En famille, on voyage ou
bien l'on s'installe chez des parents ou
bien encore dans une location à la campa-
gne. De ceux-là, nous n'avons point à
nous préoccuper.
C'est avec la troisième catégorie — les
enfants des petits commerçants, atta-
chés à leur comptoir du ter janvier au
31 décembre — que les difficultés com-
mencent; elles s'accentuent avec la qua-
trième catégorie — les enfants d ou-
vriers — et deviennent si graves avec la
cinquième — les enfants d'indigents —
qu'on les a crues pendant longtemps
inextricables, U tombe cependant sous le
sens que les vacances sont d'autant plus
nécessaires que les enfants souffrent da-
vantage du manque de bien-être.
Aussi est-ce des plus malheureux que
l'on s'est occupé d'abord. Quelques indi-
vidus de bon cœur et de bonne volonté
agissante, ont inventé les colonies de va-
cances et les voyages scolaires ; un cer-
tain nombre de particuliers — nombre
encore trop restreint— ont ouvert leurs
bourses, les Caisses des Ecoles se sont
montrées généreuses, la cause est en-
tendue — nous le prouverons de-
main; — mais il y a toute une classe
d'enfants pour lesquels rien ne parait en-
core ébauché et qu'il ne faudrait pour-
tant pas punir de ce que leurs parents ne
sont pas les forçats du prolétariat. Je
veux parlerdes enfants de la& catégorie,
fils de petits commerçants et de modas-
tes employés attachés sans merci à leur
chaîne. Les mornes six semaines qu'ils
passent chez leurs parents 1
Ceux-ci connaissant les périls de
l'abandon dans les rues et daca les jar-
dins publies, les casament à la maison,
où ils ne tardent pas à regretter les ca-
i marades et la bone elle-méme. Or, leii-
[ Demi n'est sas 88 itoo runsfiltor; 1m
petits manquements deviennent chaque
jour plus nombreux, les gamineries plus
graves ; par malheur le pèra et la mère,
occupés et préocupés sont peu endu-
rants...
Il ne reste aux petites victimes qu'un
seul refuge : bâcler tes devoirs de va-
cances!
J'ai dit au chapitre précédent ce que
je pense de l'internat — oh ! pas tout
encore 1 — et des parents qui se désinté-
ressent de l'éducation de leurs enfants
— qui s'en débarrassent si vous préfé-
rez. Je ne serai donc pas accusée do
vouloir désorganiser les familles si je
m'étonne de notre apathie à l'égard de
cette classe si nombreuse d'enfants qui
sont privés des avantages de la richesse
et des dédommagements que la bienfai-
sance apporte à la réelle pauvreté.
Les parents qui usent si largement de
l'internat, alors que la demi-pension ou
externat surveillé, sauvegarderait à la
fois leurs affaires et tes relations étroites
de la famille, ne peuvent avoir aucun
scrupule, aucune inquiétude à les
confier pendant les vacances à des per-
sonnes d'une moralité incontestée qui
conduiraient de petites troupes d'excur-
sionnistes à la montaigne, à la mer,ou plus
modestement encore dans une propriété
buée pour la saison. Ce serait une imi-
tation à peu de frais des inoubliables
Voyages en Zig-Zay, dont Topfer a
charmé notre jeunesse.
L'association produirait des merveilles.
Voua une nouvelle occasion de se Il-:
gnaler.. - --s
PAULINE KERGOMAR.
(A swmrt
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 80.49%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 80.49%.
- Auteurs similaires Bibliothèque Diplomatique Numérique Bibliothèque Diplomatique Numérique /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "MAEDIGen0"
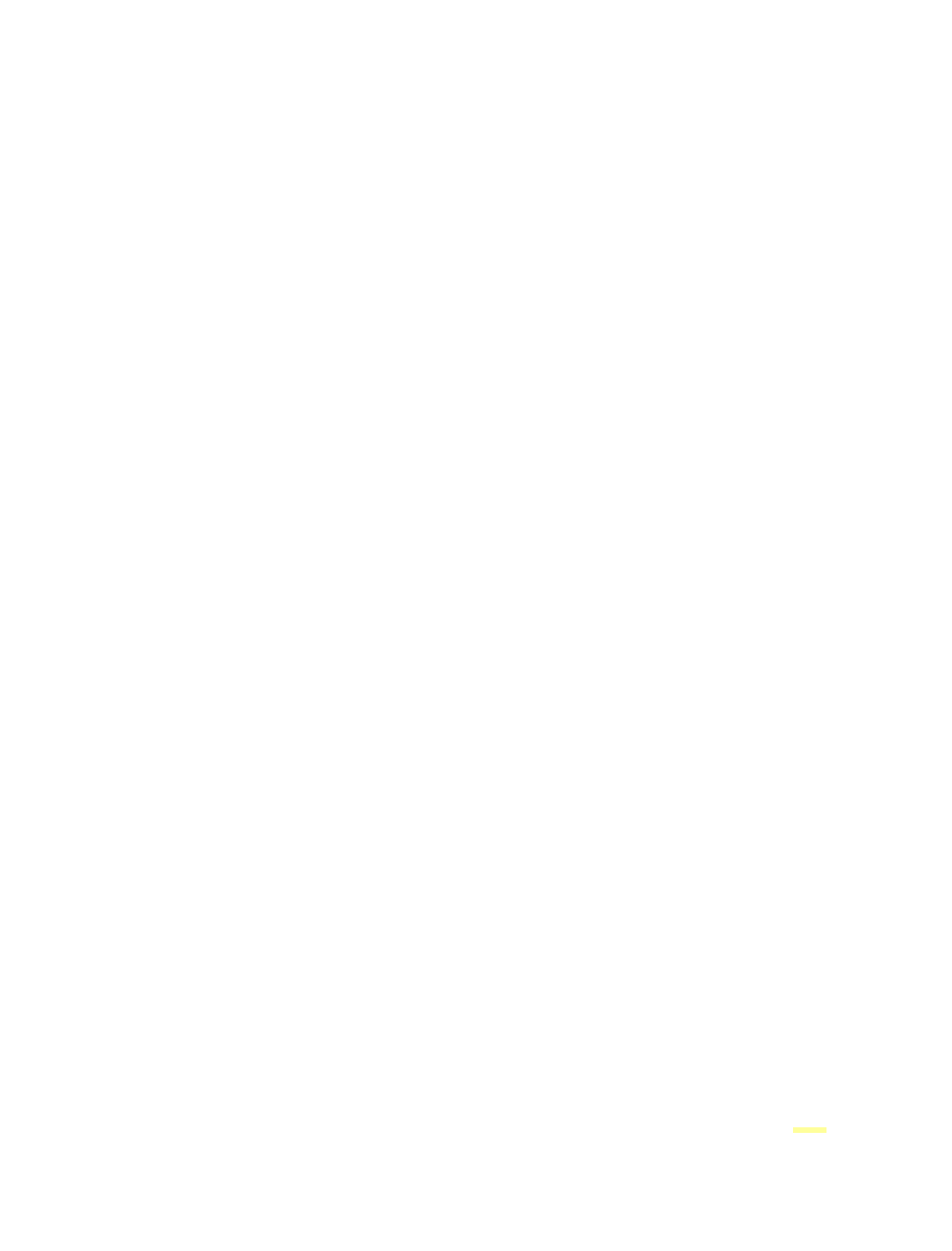
-
-
Page
chiffre de pagination vue 2/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k67033441/f2.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k67033441/f2.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k67033441/f2.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k67033441/f2.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k67033441
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k67033441
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k67033441/f2.image × Aide




Facebook
Twitter
Pinterest