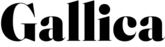Louise Ackermann : une solitaire trop moderne
Louise Ackermann (1813-1890) est une figure très singulière du paysage littéraire du XIXe siècle. Cette poétesse volontiers qualifiée de « mâle génie » reste largement incomprise de ses contemporains tant sa façon de vivre, son style et ses idées vont à l’encontre des idées reçues de son temps sur les femmes et la poésie féminine.
Louise Ackermann est très différente des autres femmes de lettres de son temps : trop solitaire, dès l’enfance, veuve trop vite, trop vertueuse, sans enfant, trop moderne pour son temps sans doute. S’ajoute une discordance entre son aspect et ses écrits :
« C'était une vieille dame d'humble apparence. Le grossier tricot de laine, qui enveloppait ses joues, cachait ses cheveux blancs, dernière parure qu'elle dédaignait comme elle avait dédaigné toutes les autres. Sa personne, sa mise, son attitude annonçaient un mépris immémorial des voluptés terrestres […] elle ressemblait à une loueuse de chaises. Mais elle pensait fortement et son âme audacieuse s'était affranchie des vaines terreurs qui dominent le commun des hommes », écrit Anatole France (Le Temps, 10 août 1890).
Une vie solitaire
« Ma vie peut elle-même se résumer tout entière en quelques mots : une enfance engourdie et triste, une jeunesse qui n'en fut pas une, deux courtes années d'union heureuse, vingt-quatre ans de solitude volontaire. » C’est ainsi que Louise Ackermann résume elle-même son existence dans la dernière page de Ma Vie.
Louise-Victorine Choquet est née à Paris le 30 novembre 1813, puis a passé une enfance solitaire à la campagne, entre un père libre-penseur et une mère plus traditionnelle et aigrie. Ses deux sœurs la taquinent pour sa sauvagerie, son amour de l’étude et son avidité de lectures.
Louise-Victorine Choquet est née à Paris le 30 novembre 1813, puis a passé une enfance solitaire à la campagne, entre un père libre-penseur et une mère plus traditionnelle et aigrie. Ses deux sœurs la taquinent pour sa sauvagerie, son amour de l’étude et son avidité de lectures.
« Dès que je sus lire, je me précipitai avidement sur tous les livres qui se trouvaient à ma portée.»
Le catéchisme, découvert en pension à Montdidier suscite en elle un « élan mystique » très vite guéri par son père à coup de Voltaire, Platon et Buffon. En pension à Paris, toujours aussi farouche et surnommée l'« ourson », elle compose ses premiers alexandrins et reçoit son brevet de poète quand son professeur de littérature les fait lire à Victor Hugo. Elle apprend l'anglais et l'allemand, découvre les auteurs romantiques (Lamartine, Musset, Vigny, Shelley, Byron). Après la mort de son père, elle fait en 1838 un premier séjour d’un an à Berlin. Rentrée dans sa famille, elle refuse de se prêter comme ses sœurs au jeu de la vie mondaine et de la chasse au mari : « Je continuai à opposer une résistance respectueuse, mais invincible, aux tentatives de ma mère pour me mener dans le monde. Voyant qu'elle ne gagnait absolument rien sur moi, elle me laissa vivre à ma guise, c'est-à-dire enfermée dans ma chambre avec mes livres. »
Après la mort de sa mère elle se résout à rester vieille fille et repart à Berlin, où elle rencontre un « jeune homme doux, sérieux, austère », ex-séminariste devenu athée et linguiste, ami de Proudhon, Paul Ackermann. Cédant à ses avances, elle l’épouse, non sans poser ses conditions, début 1844 : « Je me serais donc passée sans peine de tout amour dans ma vie ; mais rencontrant celui-là, si sincère et si profond, je n'eus pas le courage de le repousser. […] le mariage ne pouvait être pour moi qu'exquis ou détestable : il fut exquis. Je m'attachai extrêmement à mon mari. »
Mais Paul est malade : après deux ans de bonheur, la phtisie l’emporte à 34 ans, en juillet 1846. Très éprouvée, Louise rejoint l'une de ses sœurs à Nice, où elle achète une ancienne propriété isolée :
« j'achetai un petit domaine, ancienne propriété des Dominicains, dans une position admirable. L'habitation était encore divisée en cellules. J'y fis bâtir une tour d'où la vue, d'un côté, s'étendait sur un splendide golfe bleu, et, de l'autre, atteignait les cimes blanches des montagnes du Piémont. On n'arrivait chez moi que par des sentiers difficiles ; ma solitude en était d'autant plus assurée. Incapable, du moins pendant les premières années, de me remettre à l'étude, je me livrai à des travaux agricoles. Je n'étais connue aux environs que comme une planteuse et une défricheuse acharnée. Enfin le calme se rétablit. »
Le contact avec la nature l’apaise peu à peu, réconfort qu’elle évoque de manière très sensible dans les trois poèmes d’« In Memoriam » (1850-1852) qui s'ouvrent sur des vers désespérés :
Après la mort de sa mère elle se résout à rester vieille fille et repart à Berlin, où elle rencontre un « jeune homme doux, sérieux, austère », ex-séminariste devenu athée et linguiste, ami de Proudhon, Paul Ackermann. Cédant à ses avances, elle l’épouse, non sans poser ses conditions, début 1844 : « Je me serais donc passée sans peine de tout amour dans ma vie ; mais rencontrant celui-là, si sincère et si profond, je n'eus pas le courage de le repousser. […] le mariage ne pouvait être pour moi qu'exquis ou détestable : il fut exquis. Je m'attachai extrêmement à mon mari. »
Mais Paul est malade : après deux ans de bonheur, la phtisie l’emporte à 34 ans, en juillet 1846. Très éprouvée, Louise rejoint l'une de ses sœurs à Nice, où elle achète une ancienne propriété isolée :
« j'achetai un petit domaine, ancienne propriété des Dominicains, dans une position admirable. L'habitation était encore divisée en cellules. J'y fis bâtir une tour d'où la vue, d'un côté, s'étendait sur un splendide golfe bleu, et, de l'autre, atteignait les cimes blanches des montagnes du Piémont. On n'arrivait chez moi que par des sentiers difficiles ; ma solitude en était d'autant plus assurée. Incapable, du moins pendant les premières années, de me remettre à l'étude, je me livrai à des travaux agricoles. Je n'étais connue aux environs que comme une planteuse et une défricheuse acharnée. Enfin le calme se rétablit. »
Le contact avec la nature l’apaise peu à peu, réconfort qu’elle évoque de manière très sensible dans les trois poèmes d’« In Memoriam » (1850-1852) qui s'ouvrent sur des vers désespérés :
« Comment pourrais-je encor, désolée et pieuse,
Par les mêmes sentiers traîner ce cœur meurtri,
Seule où nous étions deux, triste où j’étais joyeuse,
Pleurante où j’ai souri ? »
Après ses vers d’écolière, Louise avait cessé d’écrire. Mariée, elle s’était conformée aux préjugés sociaux : « Mon mari a toujours ignoré que j'eusse fait des vers ; je ne lui ai jamais parlé de mes exploits poétiques », car « la femme qui rime est toujours plus ou moins ridicule ». De fait, elle n’est pas tendre avec ses consœurs : « Les femmes qui écrivent sont, hélas ! naturellement disposées à se laisser aller à de déplorables écarts de conduite. » Ces propos sont toutefois complétés par une réflexion originale pour l’époque :
« l’homme n’a pas le droit de se plaindre des défauts, ni même des vices de la femme. Celle-ci n’a qu’un but au monde : le captiver, et pour y parvenir elle se modèle sur ses désirs. Or, que lui demande-t-il ? Des charmes et du plaisir. Elle se fait donc coquette, frivole, menteuse pour le séduire. »
Et ses Pensées d'une solitaire prennent parfois des accents féministes : « J’éprouve parfois une vraie colère en voyant qu’une grande intelligence ne met pas les femmes à l’abri de toutes sortes d’erreurs et de faiblesses. Au contraire, on dirait que c’est la monnaie dont elles paient leur supériorité. Pauvres femmes de génie, c’est à vous que le cœur et surtout les sens gardent leurs plus mauvais tours ! »
Son deuil terminé, lui revient l’envie d’écrire. Elle adapte des Contes orientaux, allemands et slaves en vers légers, qu’elle publie en 1855. Elle s’y adresse à ses lecteurs et mêle des éléments autobiographiques à la trame fictionnelle, notamment dans deux « contes tirés du sanscrit », Savitri, où des amants ne se voient accorder que « Deux ans d'amour, ah ! c'est si tôt passé ! » avant de fléchir les dieux, et Sakountala : « « La mémoire est le coffret parfumé / Où tient notre âme un trésor enfermé […] Ah! si perdez l'objet de vos tendresses / Fuyez les lieux où vous avez aimé ! ».
Son deuil terminé, lui revient l’envie d’écrire. Elle adapte des Contes orientaux, allemands et slaves en vers légers, qu’elle publie en 1855. Elle s’y adresse à ses lecteurs et mêle des éléments autobiographiques à la trame fictionnelle, notamment dans deux « contes tirés du sanscrit », Savitri, où des amants ne se voient accorder que « Deux ans d'amour, ah ! c'est si tôt passé ! » avant de fléchir les dieux, et Sakountala : « « La mémoire est le coffret parfumé / Où tient notre âme un trésor enfermé […] Ah! si perdez l'objet de vos tendresses / Fuyez les lieux où vous avez aimé ! ».

Marcellin Desboutin, Portrait de Louise-Victorine Ackermann, 1886. Musée Anne-de-Beaujeu de Moulins
J'ai voulu monter sur le pont
Si la publication des Contes n’avait pas eu tellement d’écho, il en va tout autrement de celle des Poésies Philosophiques, publiées d’abord en plaquette à Nice en 1871 puis chez Lemerre en 1874. Ces vers puissants expriment ses convictions de libre penseuse. Le recueil s’ouvre par un manifeste, « Mon livre » où elle revendique son droit à s’exprimer :
« Quoi ! ce cœur qui bat là, pour être un cœur de femme,
En est-il moins un cœur humain ? […]
Au lieu de m'enfermer tremblante en fond de cale,
J'ai voulu monter sur le pont. »
Plusieurs poèmes, « Les malheureux », « L’amour et la mort », « Paroles d’un amant », évoquent indirectement son deuil pour refuser une vaine immortalité et rejeter l’illusoire consolation des retrouvailles dans l’au-delà.
Elle glorifie les luttes de l’humanité contre l’ignorance : « Satan » prend la parole pour s’enorgueillir d’avoir arraché l’homme à Dieu et à son ignorance : « Il fallait qu'il péchât, eh bien ! il a péché. / Il le prit de ma main, ce fruit de délivrance, […] / Sortir du fond obscur d'une étroite ignorance, / Ce n'était point déchoir, non, non ! c'était monter. » Dans « De la lumière », les flambeaux de la Foi et de la Science sont renvoyés dos à dos ; « Prométhée » veut « en finir avec les dieux pervers » ; et elle s’adresse à « Pascal » pour l’admirer dans son combat avec le Sphinx et regretter sa soumission à la Croix : « Tout roseau que l'on est, s'incliner sans fléchir. »
Elle fait aussi écho aux drames de son temps : « La guerre », écrit en février 1871, est dédié à son neveu tué à Gravelotte. Son pessimisme tout philosophique prend des accents très sensibles dans les derniers vers frappants du « Déluge » : « Les moins à plaindre encore seront les engloutis » et, dans le tout dernier poème, « Le Cri », qui, souvent cité par les commentateurs, est le plus sombre et l’un des plus forts :
Elle glorifie les luttes de l’humanité contre l’ignorance : « Satan » prend la parole pour s’enorgueillir d’avoir arraché l’homme à Dieu et à son ignorance : « Il fallait qu'il péchât, eh bien ! il a péché. / Il le prit de ma main, ce fruit de délivrance, […] / Sortir du fond obscur d'une étroite ignorance, / Ce n'était point déchoir, non, non ! c'était monter. » Dans « De la lumière », les flambeaux de la Foi et de la Science sont renvoyés dos à dos ; « Prométhée » veut « en finir avec les dieux pervers » ; et elle s’adresse à « Pascal » pour l’admirer dans son combat avec le Sphinx et regretter sa soumission à la Croix : « Tout roseau que l'on est, s'incliner sans fléchir. »
Elle fait aussi écho aux drames de son temps : « La guerre », écrit en février 1871, est dédié à son neveu tué à Gravelotte. Son pessimisme tout philosophique prend des accents très sensibles dans les derniers vers frappants du « Déluge » : « Les moins à plaindre encore seront les engloutis » et, dans le tout dernier poème, « Le Cri », qui, souvent cité par les commentateurs, est le plus sombre et l’un des plus forts :
« Ah ! c'est un cri sacré que tout cri d'agonie ; […]
Eh bien ! ce cri d'angoisse et d'horreur infinie,
Je l'ai jeté ; je puis sombrer ! »
Satan féminin
Avec ce recueil, Louise Ackermann accède à une notoriété de scandale parmi les critiques de son temps. Cette libre-penseuse s'est introduite par effraction dans un domaine interdit : la poésie, à moins d'être lyrique, n'est pas alors un domaine féminin. Elle ose, en outre, faire profession publique d'athéisme, ce qui augmente le scandale, tant il est alors entendu que le sentiment religieux est « inné chez la femme » et qu’« une femme impie est plus impie que cinquante voltairiens », comme l'écrit Armand de Pontmartin (« la poésie athée : Mme Ackermann », Nouveaux samedis, 1875). Il poursuit en tournant la poétesse en ridicule : « une honnête sexagénaire, une savante de moeurs simples et austères [...] montrant à Dieu son vieux petit poing ridé, tout en affirmant que Dieu n'existe pas. »
C’est un long article d’Edme Caro, « Un poète positiviste » (dans La Revue des deux mondes le 15 mai 1874), qui fait du livre un événement : il prend date du fait que grâce au développement des sciences, les « vieilles croyances » sont mortes et déclare :
C’est un long article d’Edme Caro, « Un poète positiviste » (dans La Revue des deux mondes le 15 mai 1874), qui fait du livre un événement : il prend date du fait que grâce au développement des sciences, les « vieilles croyances » sont mortes et déclare :
« On assure que l'auteur est une femme. On ne s'en douterait pas à l'énergie et à la virilité de la pensée. Tout cela d'ailleurs n'importe guère. C'est une partie de l'âme moderne que nous voyons. »
Le recueil est ensuite largement commenté par tous les journaux, dans une polémique qui fait intervenir les grands noms de la critique. La presse conservatrice se lance dans une entreprise de démolition, fait de cette femme athée une « pythonisse proudhonnienne » manipulée, tout en se moquant de son apparence et de son âge. Dans le camp progressiste, on balaie les préjugés. Anatole France considère que loin de copier les maîtres, la poétesse les a dépassés en puissance et en audace. Mais même dans les louanges, le lexique utilisé est très masculin : « sanglots virils », « mâle génie », ou « altière virilité de talent » ! Albert Cim salue à sa mort « une femme qui a été l'un des poètes les plus virils, l'un des penseurs les plus personnels et les plus hardis de ce temps » (Le Radical, 12 août 1890).
Même les femmes sont partagées à son sujet, comme Aurel, nom de plume d'Aurélie de Faucamberge, qui salue le talent, mais n’est pas tendre pour la femme : « aède bourrelé, mais superbe de ce rien qu’est la libre pensée [...] elle est le Satan féminin [...] elle est homme dans tous les coins de son esprit […] sans élégance et vieillie avant l’âge avec son menton volontaire, son regard obstiné, poilue comme la montre son dernier portrait, sans coquetterie […] elle n’osa pas être femme. Elle ne livra pas son âme même en amour, ni même à son mari, puisqu’elle lui cacha qu’elle écrivait. […] Le Féminin ne peut qu’honorer cette femme qui ne le fut guère que par une tristesse démoniaque. […] On pourrait l’appeler la grande fossoyeuse. / Je la salue et je la fuis. »
Intéressante est la réaction du très traditionnaliste Jules Barbey d’Aurevilly, dans son article pour Le Constitutionnel (28 avril 1874), repris dans Les Poètes (1889). S’il ne ménage pas son admiration pour ces poésies « impies, athées, – résolument athées, – navrantes, navrées et superbes », il se montre stupéfait que ce soit cette « matrone simple et grave », une « amie de Proudhon » qui a priori ne devrait pas susciter sa sympathie, qui ait écrit
Même les femmes sont partagées à son sujet, comme Aurel, nom de plume d'Aurélie de Faucamberge, qui salue le talent, mais n’est pas tendre pour la femme : « aède bourrelé, mais superbe de ce rien qu’est la libre pensée [...] elle est le Satan féminin [...] elle est homme dans tous les coins de son esprit […] sans élégance et vieillie avant l’âge avec son menton volontaire, son regard obstiné, poilue comme la montre son dernier portrait, sans coquetterie […] elle n’osa pas être femme. Elle ne livra pas son âme même en amour, ni même à son mari, puisqu’elle lui cacha qu’elle écrivait. […] Le Féminin ne peut qu’honorer cette femme qui ne le fut guère que par une tristesse démoniaque. […] On pourrait l’appeler la grande fossoyeuse. / Je la salue et je la fuis. »
Intéressante est la réaction du très traditionnaliste Jules Barbey d’Aurevilly, dans son article pour Le Constitutionnel (28 avril 1874), repris dans Les Poètes (1889). S’il ne ménage pas son admiration pour ces poésies « impies, athées, – résolument athées, – navrantes, navrées et superbes », il se montre stupéfait que ce soit cette « matrone simple et grave », une « amie de Proudhon » qui a priori ne devrait pas susciter sa sympathie, qui ait écrit
« les plus belles horreurs littéraires qu’on ait écrites depuis les Fleurs du mal de Baudelaire. Et même c’est plus beau, car dans le mal, – le mal absolu, – c’est plus pur. ».
Elle en devient presque un homme : « cette Origène femelle est parvenue à tuer son sexe en elle et à le remplacer par quelque chose de neutre et d’horrible, mais de puissant », ou « ce poète mâle […] une aigle, qui déplace beaucoup d’air autour d’elle quand elle vole.
« Cette madame Ackermann est, au fond, quelque chose comme un démon et, moralement comme esthétiquement, c’est intéressant, un démon ! » Elle devient presque une de ses Diaboliques, publiées la même année, qu’il lui dédicace « À la grande diabolique, les petites ». Elle le remercie d’un recueil « À Barbey d’Aurevilly, Un monstre reconnaissant » et, dans les années 1880, les deux écrivains se voient régulièrement.
« Cette madame Ackermann est, au fond, quelque chose comme un démon et, moralement comme esthétiquement, c’est intéressant, un démon ! » Elle devient presque une de ses Diaboliques, publiées la même année, qu’il lui dédicace « À la grande diabolique, les petites ». Elle le remercie d’un recueil « À Barbey d’Aurevilly, Un monstre reconnaissant » et, dans les années 1880, les deux écrivains se voient régulièrement.
Une vie libre
Surprise par la violence de la réception des Poésies philosophiques, Louise Ackermann donne à lire en 1874 ses Premières poésies aux thèmes plus attendus d’une femme. Pour répondre à ceux qui mettent son athéisme sur le compte du désespoir, elle rédige aussi des textes autobiographiques et des fragments en prose, genres considérés comme plus féminins. Elle publie en 1882 Pensées d'une solitaire, des extraits de son journal qui mêlent des aphorismes et quelques notations plus intimes, qui seront rééditées en 1902, précédées d'une belle introduction de son amie Louise Read « Madame Louise Ackermann intime ».On peut y lire des considérations sur la poésie (« Le vers doit être à la fois transparent et fluide ; il faut qu’il laisse passer la lumière et qu’il coule. ») et quelques jugements très pertinents sur les écricains de son temps : « La poésie d’Hugo a fait une telle consommation d’images, qu’il y aurait vraiment lieu de se demander s’il en restera encore pour les poètes à venir. » ; « Lamartine a la note magnifique, mais rarement la note émue ; celle-là, c’est le cœur qui la donne. Or, Lamartine n’a guère aimé. Les femmes n’ont été pour lui que des miroirs où il s’est regardé ; il s’y est même trouvé très beau. » ; « George Sand me fait l’effet d’un enfant terrible ; ce qu’elle ne brise pas, elle le met sens dessus dessous. » Ou « Musset pèche par la composition. Ses poésies sont décousues ; on les dirait faites de pièces et de morceaux. Mais quels morceaux ! C’est du cristal, de l’or, du diamant, ou plutôt c’est un métal à lui et sorti de ses entrailles, fluide, transparent, brûlant. »
On y trouve aussi des réflexions très modernes sur la nature (« Mon premier soin, lorsque je me lève, est d’aller voir comment mes arbres ont passé la nuit, mes arbres fruitiers surtout. Quelle vivante image de la bonté que ces êtres muets qui tendent vers nous leurs bras chargés de présents ! »), le suicide (« J’ai toujours eu une admiration profonde pour ces âmes courageuses qui, en pleine possession d’elles-mêmes et par pur dégoût des misères terrestres, ont trouvé en elles la force de se débarrasser de l’existence ») ou l'évidence de l'athéisme : « Il y a eu un temps où il fallait une certaine force d’esprit pour ne pas croire à Jupiter. Il en viendra un où l’on ne comprendra pas qu’on ait pu croire en Dieu » ; « Je ne me figure pas qu’un astronome puisse jamais être un croyant. La vue, pour ainsi dire immédiate, de l’infini dissipe, comme de légers nuages, les fables dont l’homme s’est plu à envelopper sa destinée. Il cesse de se croire un être assez important pour arrêter sur lui la pensée divine. [...] c’est le sentiment de son propre néant qui saisit l’homme en face de ces espaces sans bornes. Il comprend que sa destinée, perdue dans une pareille immensité, est tout à fait insignifiante, et qu’il n’est lui-même qu’un simple atome emporté dans le mouvement universel. »
Et les notations intimes y sont celles d'une femme moderne, solitaire et indépendante : « L’âge mûr semble être mon âge naturel. Ce calme encore accompagné de force, ces opinions rassises, ces vues claires en littérature et en philosophie, voilà ce que je goûte et dont je jouis avec délices. J’aurais dû naître à quarante ans. » Ou encore:
« Je me compare à ces insectes qui, réfugiés à l’extrémité d’une branche, dans une feuille, s’y tissent une enveloppe fine où s’ensevelir. La solitude est ma feuille ; j’y file mon petit cocon poétique. »
Ma vie, d'abord intitulé « Autobiographie », rédigé en janvier 1874 et publié en 1885, ne se soumet qu’en apparence à la norme : cette « autobiographie » très mince, à peine 20 pages, apporte un démenti au stéréotype de l'épanchement féminin. Le récit dessine une figure originale de femme et de poète, qui se défend d’avoir été aussi malheureuse qu’on veut le croire : « Les grandes luttes, les déceptions amères, m'ont été épargnées. En somme, mon existence a été douce, facile, indépendante. Le sort m'a accordé ce que je lui demandais avant tout ; du loisir et de la liberté. »
Il constitue aussi un guide de lecture et un manifeste, où la poétesse revient sur ses motivations : « Considéré de loin, à travers mes méditations solitaires, le genre humain m'apparaissait comme le héros d'un drame lamentable qui se joue dans un coin perdu de l'univers, en vertu de lois aveugles, devant une nature indifférente, avec le néant pour dénouement. L'explication que le christianisme s'est imaginé d'en donner n'a apporté à l'humanité qu'un surcroît de ténèbres, de luttes et de tortures. […] De là, ma haine contre lui […] c'est au nom de l'homme collectif que j'ai élevé la voix ; je crus même faire œuvre de poète en lui prêtant des accents en accord avec les horreurs de sa destinée. »
L’écrivaine poursuit sa vie solitaire, mais pas si austère, à Nice : elle voyage, voit régulièrement des amis cultivés, passe des saisons à Paris, puis revient y vivre à partir des années 70, rue des Feuillantines, où elle tient un salon que Louise Read évoque avec nostalgie :
« À Paris, dans les dernières années de sa vie, le portrait de ce « compagnon chéri » surmontait le bureau sur lequel elle écrivait, dans le petit salon si modeste et si recueilli de la rue des Feuillantines où, chaque samedi, un groupe d’amis choisis se réunissait. Les regards allaient de lui à elle avec émotion. Ce charmant et distingué jeune homme, depuis tant d’années parti, et la jeune femme d’alors devenue, par son deuil et par sa souffrance, le grand poète au front superbe, aux somptueux cheveux blancs, aux yeux pénétrants, de qui Léon Ostrowski a laissé un si énergique et si beau portrait. [...] L’intimité des samedis de la rue des Feuillantines était précieuse à ceux qui avaient le privilège d’y être admis. L’accueil chaud et vivant de la chère vieille amie, si joyeuse à l’arrivée de ses préférés, reste inoubliable.
De nombreuses sympathies lui parvenaient de loin aussi : de Roumanie, de Hongrie, de Russie notamment, d’où on lui signalait l’admiration de Tolstoï pour ses poésies. On se faisait présenter, on avait la curiosité d’approcher du poète pessimiste. Sa rude simplicité, son absence totale de pose, déroutaient parfois les nouveaux venus, et l’ardeur avec laquelle se traduisaient ses antipathies n’était pas faite pour les rassurer. Elle avait l’exécration de tout mensonge, quel qu’il fût, et exécutait sommairement, malgré son extrême indulgence, quiconque lui paraissait transiger avec l’absolue vérité. »
Louise meurt à Nice le 2 août 1890, à 76 ans. Louise Read évoque les vers gravés sur son tombeau :
« J’ignore ! — Un mot, le seul par lequel je réponde
Aux questions sans fin de mon esprit déçu ;
Aussi quand je me plains, en partant de ce monde,
C’est moins d’avoir souffert que de n’avoir rien su. »
Une poésie de l’intelligence
Il est aujourd’hui possible de lire autrement cette autrice plus complexe qu’il n’y paraît. En dépit de son pessimisme revendiqué, Louise Ackermann sait aussi être drôle : « je ferai aussi remarquer que je ne suis pas tout d'une pièce. Bien que naturellement grave, je ne hais pas le rire. » Elle s’est remise de ses deuils et note avec lucidité : « Les douleurs chantées sont déjà des douleurs calmées. Ce n’est point lorsque nous sommes encore engagés dans la sensation que nous serions capables de l’exprimer. » Elle n’est pas désespérée au sens romantique du terme, juste lucide ; son pessimisme philosophique et son athéisme sont construits à partir d’une large et solide érudition, de toutes ses lectures depuis l’enfance.
D’une grande curiosité, elle se passionne pour les avancées scientifiques de son temps : « Du fond de ma retraite, je suivais avec un intérêt intense les travaux de la science moderne. Les théories de l'évolution et de la transformation des forces étaient en parfait accord avec les tendances panthéistes de mon esprit. » Elle exprime sa fierté d'avoir ouvert un champ poétique neuf, où elle s'étonne de ne pas avoir été devancée, en faisant entrer la science dans sa poésie : « la science venait de créer un nouvel état d'âme et d'ouvrir à l'esprit des perspectives où la poésie avait évidemment beau jeu. Je m'étonne fort que sur ce terrain je n'aie pas été devancée par quelques-uns de nos jeunes poètes. Il leur eût été si facile de me couper la poésie sous le pied ! » Le cosmos et l’astronomie en particulier la fascinent : elle écrit dans son Journal : « Je n’ai plus envie de voyager […]. Les autres planètes seules me tenteraient. » Et s’adresse « À la Comète de 1861 » :
D’une grande curiosité, elle se passionne pour les avancées scientifiques de son temps : « Du fond de ma retraite, je suivais avec un intérêt intense les travaux de la science moderne. Les théories de l'évolution et de la transformation des forces étaient en parfait accord avec les tendances panthéistes de mon esprit. » Elle exprime sa fierté d'avoir ouvert un champ poétique neuf, où elle s'étonne de ne pas avoir été devancée, en faisant entrer la science dans sa poésie : « la science venait de créer un nouvel état d'âme et d'ouvrir à l'esprit des perspectives où la poésie avait évidemment beau jeu. Je m'étonne fort que sur ce terrain je n'aie pas été devancée par quelques-uns de nos jeunes poètes. Il leur eût été si facile de me couper la poésie sous le pied ! » Le cosmos et l’astronomie en particulier la fascinent : elle écrit dans son Journal : « Je n’ai plus envie de voyager […]. Les autres planètes seules me tenteraient. » Et s’adresse « À la Comète de 1861 » :
« Dans ces mondes épars, dis ! avons-nous des frères ?
T'ont-ils chargé pour nous de leur salut lointain ? »
Louise Ackermann polit longuement chacun de ses poèmes (« Nos écrits sont comme les galets de la mer ; ce n’est qu’à force d’être roulés dans notre esprit qu’ils acquièrent du poli et de la rondeur ») afin de parvenir à une expression efficace et percutante ; elle utilise des images qui donnent beaucoup de sensualité à ses descriptions de la nature notamment. Si son vocabulaire est assez simple, le champ lexical de la passion y fait souvent irruption : « Et si j'ai de mon temps, le long de mes vertèbres, / Senti courir tous les frissons ? »
Louise Ackermann n’est ni un démon, ni une désespérée, ni une loueuse de chaise, mais juste une femme libre, sans doute passionnée davantage par l’intelligence et par les sciences que par les sentiments et les passions, et qui a consacré l’essentiel de sa vie à la lecture, à l’étude et à l’écriture. Ses textes méritent aujourd’hui d’être redécouverts.
Pour aller plus loin
- Dans le sillage de Louise Ackermann : sources croisées & morceaux choisis. Choisis et présentés par Christine Jeanney. Montpellier : Publie.net, 2020. 193 p. (Classiques)
- Œuvres de L. Ackermann : ma vie, premières poésies, poésies philosophiques. Westmead : Gregg international, 1971. XX-187 p. Fac-sim. de l'éd. de Paris : A. Lemerre, 1885.
- « "Un démon dans une honnête femme" : Louise Ackermann face à la critique », dans Masculin / Féminin dans la poésie et les poétiques du XIXe siècle, p. 409- 420.