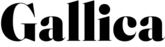Le vicomte d’Arlincourt (1788-1856)
En 1821, Le Solitaire fut le grand succès romanesque de la Restauration. Son auteur, le vicomte d’Arlincourt, fut même surnommé le « Prince des romantiques », mais aussi, par ses adversaires, « Le Vicomte inversif », tant son style outrancier fit scandale. Ses œuvres suivantes ne connurent pas de ventes importantes, mais le triomphe du Solitaire lui laisse une petite place dans l’histoire littéraire.
Il voit le jour au château de Mérantais près de Versailles. Son père, ainsi que son grand-père, ont été fermiers-généraux et sont décapités sous la Terreur en mai 1794, en même temps que Lavoisier. Sa mère connaît du monde cependant, et elle peut plaider sa cause auprès de Napoléon devenu Empereur, qui nomme alors le jeune homme écuyer de Madame Mère. À 19 ans, le vicomte d’Arlincourt écrit déjà une tragédie, Charlemagne, à la gloire de son protecteur ; mais, refusée par le Théâtre Français, elle ne sera jamais jouée. Il épouse une jeune Cholet, fille d’un sénateur impérial, en 1808, mais il en divorcera pour se remarier avec une femme riche, Contenot de Laneuville, en 1851. Cependant, il n’aura pas d’enfant. En 1811, il est nommé auditeur d’État et participe en tant qu’intendant des armées à la guerre d’Espagne. À la chute de l’Empire, Louis XVIII lui rembourse une somme que lui avait prêté le père d’Arlincourt. Devenu riche, il se met au service du nouveau pouvoir, qui lui fait cependant comprendre qu’il n’a pas besoin de lui. Il s’achète sur ces entrefaites le château de Saint-Paer en Normandie, où il va donner des fêtes fastueuses, notamment celle de 1825 où il accueille la duchesse du Berry, et qui est restée dans les annales.
Mais c’est surtout son activité littéraire qui en fait la coqueluche des salons et de la bonne société. En 1818, reprenant sa pièce, il la transforme en poème épique, Charlemagne ou La Caroléide.
Les trois romans suivants, Le Renégat en 1822, Ipsiboé en 1823 et L'Étrangère en 1825, s’ils ne connaissent pas le même succès, se vendent cependant très bien. Son but, explique-t-il dans une préface, est de « spiritualiser toutes les impressions de l’existence ».
Il voyage alors en Europe, notamment chez les princes en exil, se faisant également le propagandiste de lui-même. « Toute sa vie se passait à courir après des décorations, des louanges dans les journaux et des invitations dans les salons », écrit Virginie Ancelot, en 1858, dans Foyers éteints (p. 218). Et un demi-siècle plus tard, un journaliste ajoute dans La Revue hebdomadaire (16 juin 1906) :
« Tout d'Arlincourt est là-dedans ! Pas méchant, bien sûr, mais orgueilleux jusqu'à la sottise. Son excuse est d'avoir été réellement convaincu de ses mérites. Il disait volontiers : « Chateaubriand et moi ! » — et il n'aurait probablement pas fallu le pousser beaucoup pour lui faire proclamer que le génie de l'auteur de René n'était rien auprès du sien. »
Sa vie de fêtes le ruine. En 1848, indigné par les journées de Juin, il publie Dieu le veut ! pamphlet qui lui vaut d'être poursuivi en cours d'assises en même temps qu'il lui donne un regain de popularité. En 1850, il rapporte d'un voyage en Italie un récit, L'Italie rouge, où il dépeint ce que sont pour lui les horreurs du Risorgimento. Il se bat contre la République, puis le Second Empire après 1848, allant de procès en procès, mais cela l’épuise. Il meurt à Paris le 22 janvier 1856. Il avait 67 ans.
Dans son Foyers éteints de 1858, Virginie Ancelot affirme que « le vicomte d’Arlincourt [fut] la première expression du romantisme exagéré… », ajoutant « il y a aussi trop de choses exagérées, fausses, ridicules et bizarres, pour qu’on ose en placer l’auteur au nombre des écrivains de mérite qui doivent compter… ». Car la critique s’est déchaînée sur le pauvre vicomte, surtout après ses années de gloire. On lui reproche de ne s’intéresser qu’à lui, comme dans ce compte-rendu de L’Étoile polaire, récit de son voyage en Russie : « M. le vicomte d'Arlincourt se serait moins inquiété des objets nouveaux qu'il avait sous les yeux que de sa propre personne » et plus loin « les princes se le disputent, les généraux se l’enlèvent, les duchesses se l’arrachent ; c’est une bataille en règle et dont la présence du pèlerin [Arlincourt] est le prix » (La Revue de Paris, 1843, p. 128). On persifle aussi sur son attachement à un monde disparu, ses passions légitimistes, ses attaques contre les pouvoirs du moment, son catholicisme presque sectaire et on glose sur sa dévotion à Chateaubriand. Dans une biographie qui date de 1909, Alfred Marquiset résume les scénarios du Vicomte : « Toujours une intrigue mystérieuse ayant pour centre quelque illustre et coupable infortuné qui se traîne à travers mille violentes péripéties vers une catastrophe sanglante » (p.108). Ses romans sont généralement historiques, se référant à la sainte Église et à la monarchie de droit divin : les Renégats se situe par exemple à l’époque de Charles Martel et voit le triomphe de la « vraie foi » sur les apostats, Le Double règne conspue les Albigeois du XIIIe siècle.
Mais c’est le succès du Solitaire qui explique la présence du vicomte d’Arlincourt dans les histoires littéraires. L’histoire est relativement simple et assez classique pour l’époque. Un ermite, retiré sur le pic Solitaire dans les Alpes Suisses, où la nature sauvage impressionne, tombe amoureux d’Élodie, une jeune fille incarnation de la pureté et de l’innocence. Après de nombreuses péripéties, le lecteur apprend qu’il n’est autre que Charles le Téméraire, que tout le monde croyait décédé. Les deux amants mourront dans les bras l’un de l’autre. On a peine aujourd’hui à imaginer le succès colossal de ce texte à l’époque. Publié le 21 janvier 1821, l’ouvrage est réimprimé au moins douze fois la première année (on comptera près d’une trentaine d’éditions en 1830 !). Il donne lieu à de nombreuses adaptations au théâtre, au moins sept, dont une de Pixérécourt (Le Mont sauvage, joué près de cent fois), une autre de Ducange (Élodie), plusieurs opéras (comme Le Solitaire de Planard et Carafa). Le succès dépasse celui d’Atala en 1802. Mais cela ne s’arrête pas là : ainsi Le Miroir des spectacles peut affirmer le 1er mars 1822, dans une démesure d’ailleurs semblable à celle de d’Arlincourt (à moins que le ton ne soit très ironique), que « Les vêtements, les meubles, les équipages, les bijoux, les aliments même rappellent aujourd’hui les sublimes conceptions du barde français, de l’homme de nos jours, de l’auteur de l’époque, de l’écrivain des siècles ». Trente ans plus tard, on trouve la même chose, avec moins d’emphase : « le Solitaire eut un retentissement inusité. On en fit en peu de temps trois ou quatre éditions ; on en fit un drame ; on donna son nom à tous les colifichets à la mode ; on porta des habits solitaires, des robes solitaires ; le solitaire s’applique à tout » (le Dictionnaire de la conversation et de la lecture, 1852). Il y a même eu des jeux de cartes du Solitaire.

Portrait par Robert Lefèvre (1822)
Ce roman est également traduit dans plusieurs langues. « Sauf en français », disaient les mauvaises langues. Et c’est là que le bât blesse. Car c’est le style d’Arlincourt qui fit débat, assura son succès, puis son rejet. Il relate son récit au présent, ce qui est assez rare et pouvait décontenancer. Surtout, il joue sans cesse sur l’inversion des mots. Par exemple les noms de lieux sont placés en avant, pour mieux les mettre en valeur : « des lointaines montagnes la cime indécise commençoit à se perdre dans les vapeurs de l'horizon. » Mais cela s’applique à tout : « Puissent jamais de nos vallons écartés n'approcher les princes de la terre », « Jamais au Mont-Sauvage, d'aucun crime le Solitaire ne s'est souillé » ou encore « Pourquoi du chef des rebelles le front audacieux, orné d'un panache vainqueur, a-t-il soudain fléchi ? » . Enfin il y a les métaphores grandiloquentes, voire prétentieuses, comme « Le char de la nuit roulait silencieux sur les plaines du ciel » ou « L'amante de l'Érèbe et la mère des Songes avaient achevé la moitié de sa course ténébreuse ». Et, enfin, on a des idiomes anciens et des périphrases pour remplacer les mots courants.
Déjà les ennemis des Romantiques disaient : « M. d'Arlincourt publia le Solitaire, véritable gageure contre tout ce que la langue française a de plus saint et sacré. » (Journal des débats politiques et littéraires, 22 décembre 1822). Pierre Larousse dans son Dictionnaire de 1866 observait : « Ces productions, dont la vogue est aujourd’hui un sujet d'étonnement, sont des modèles de bizarrerie, d'invraisemblance, d'enflure et de mauvais goût. Le style n'appartient qu'à l'auteur ; jamais on n'avait écrit la langue française d’une manière aussi extraordinaire. Il y a des audaces grammaticales qui dépassent tout ce que les romantiques ont aventuré depuis, des inversions impossibles, incompréhensibles, un luxe d'adjectifs et d'épithètes à faire dresser les cheveux ; enfin, des conceptions absurdes, des caractères faux et des sentiments outrés. » . Et Léon Séché assénait en 1906 : « On n'avait pas encore, semble-t-il, torturé la langue à ce point. Le style de d'Arlincourt, d'ailleurs fluidique et incolore […] est rempli d'inversions impossibles, farci d'adjectifs, encombré d'épithètes comme jamais aucun des plus excentriques et fougueux romantiques n'en employa. »
Il voulait imiter son idole Chateaubriand à qui il emprunte beaucoup de ses tics. Par exemple l’affectation qu’il pousse à ses limites, comme « avide fureur », « pieuses victimes » ou « rougeâtre granit ». On l’a appelé « l’Inversif Vicomte » pour se moquer de ses tournures stylistiques. Ainsi Stendhal : « Il n’y aurait pas plus de justice à reprocher à votre école d’avoir produit le célèbre vicomte inversif, qu’il n’y en aurait de votre part à accuser le Classicisme d’avoir produit un Chapelain ou un Pradon » (Racine et Shakespeare, II, 1825).
Balzac l’évoque explicitement dans Les Illusions perdues, quand Lucien de Rubempré regarde avec amusement des caricatures accompagnant « le Solitaire, livre qu’un succès inouï recommandait alors à l’Europe et qui devait fatiguer les journalistes ». (p.189). Même Victor Hugo y fait allusion dans Les Misérables : « Il y avait un faux Chateaubriand appelé Marchangy, en attendant qu'il y eût un faux Marchangy appelé d'Arlincourt. »
Il n’empêche : le vicomte d’Arlincourt a marqué son temps, même s’il a poussé le romantisme au-delà de ses limites par ses tournures stylistiques, ses canevas devenus stéréotypés et son manichéisme souvent primaire. Mais apparemment son style fonctionne toujours : le Solitaire a été réédité depuis peu, en 2017.