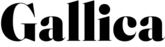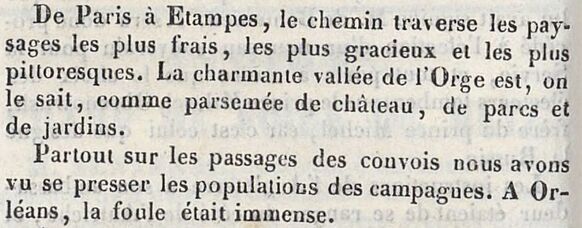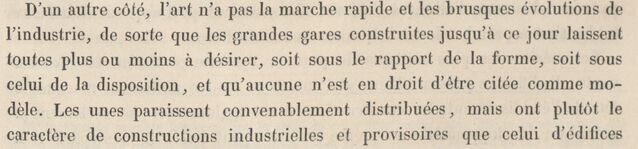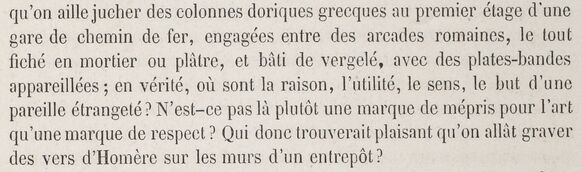« Formation du train des messageries à la gare de Paris ». Album Champin vues pittoresques du chemin de fer de Paris à Orléans. Champin Publication : Paris : A. Leboux éd., 1840.
« Qui mérite mieux d’être orné que le Terminus d’un chemin de fer, ce temple de l’idée moderne ? » demandait Théophile Gauthier en 1853. Les constructions et reconstructions des gares « extrêmes », c’est-à-dire des terminus parisiens du réseau français, soulèvent pourtant au XIXe siècle quelques inquiétudes auprès des architectes et des artistes classiques.
Lorsque paraît en 1840 l’Album Champin des vues pittoresques du chemin de fer de Paris à Orléans, c’est surtout le côté « pittoresque » promis par le titre qui semble mis en évidence dans les gravures et illustrations. Ce que l’on voit des gares et des convois évoque irrésistiblement un petit train touristique, destiné à satisfaire le besoin d’air pur de la bourgeoisie parisienne à travers des destinations aussi exotiques et champêtres qu’Yvry-sur-Seine, Vitry ou Etampes, en attendant que la ligne atteigne effectivement Orléans trois ans plus tard. L’inauguration de 1843 donnera d’ailleurs lieu dans la presse à d’intéressantes appréciations sur ce qui sera plus tard la Grande Couronne parisienne :
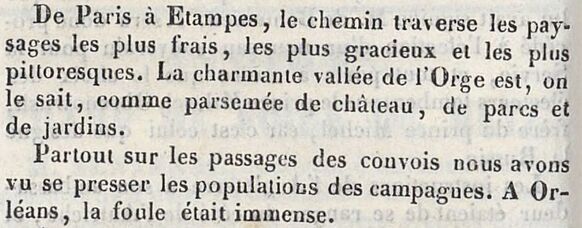
Si l’on se fie à l’iconographie proposée, la future gare d’Austerlitz, dessinée par Félix-Emmanuel Callet, se caractérise par sa sobriété quasi industrielle : pas de fioritures ni de sculptures allégoriques visibles sur les façades. « L’embarcadère d’Orléans », comme on l’appelle alors, semble se réduire à une halle à trois entrées accolée à l’immeuble de l’administration, Boulevard de l’Hôpital.

Embarcadère et débarcadère sont les désignations usuelles des stations ferroviaires depuis l’inauguration en 1837 de la toute première ligne de voyageurs de la capitale, Paris-Saint-Germain, dont la tête de réseau deviendra l’actuelle Saint-Lazare. Deux termes que le Dictionnaire des chemins de fer de De Cousy de Fageolles considère déjà en 1861 comme « entièrement passés de mode », au profit de « gare », présenté comme « un nouveau mot ». Changement de terme sans doute significatif : dorénavant, c’est le bâtiment que l’on désigne et non plus un simple espace de transit pour personnes et marchandises.
Premier concepteur de la gare du Nord en 1845, Léonce Reynaud semble justifier les choix apparemment basiques de l’architecture ferroviaire primitive. La rigueur des formes n’est-elle pas préférable, à tout prendre, pour des constructions qui sont avant tout destinées à une vocation utilitaire ?
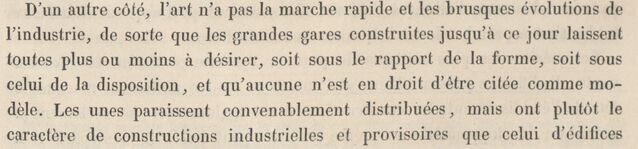

Mais à l’époque où écrit Reynaud, le chemin de fer est devenu une affaire sérieuse. Entre 1841 et 1860, l’étendue du réseau est multipliée par dix-sept et les voitures n’évoquent plus les diligences montées sur châssis des illustrations Champin. Les gares de la capitale doivent s’adapter à l’essor du trafic : Austerlitz va plus que doubler sa superficie pendant les travaux engagés par Pierre-Louis Renaud entre 1862 et 1870. À force d’expansion, Saint-Lazare atteint les onze hectares et n’a plus rien à voir avec la « masure qui, sur la place de l’Europe, accueillait les voyageurs », pour reprendre l’expression de Maxime Du Camp dans la Revue des deux Mondes. Quant à la nouvelle gare du Nord, conçue par Jacques-Ignace Hittorff, elle est envisagée dès ses prémisses en 1858 comme un « monument de premier ordre, qui surpassera par ses proportions et la majesté de son architecture, toutes nos autres gares », à commencer par le bâtiment originel de Reynaud qui sera démoli six ans plus tard. La comparaison entre les deux bâtiments successifs parle d’elle-même :

Il est devenu difficile de dénier aux gares le statut de monuments, susceptibles donc de s’inscrire dans le patrimoine architectural au même titre que les cathédrales du passé, dont elles étaient déjà explicitement considérées comme un équivalent moderne par Théophile Gauthier dans l’article déjà cité de 1853 :

Le processus d’assimilation a sans doute commencé avec l’inauguration de la gare de l’Est en 1849, très admirée pour sa rosace et sa façade. Il s’accélère avec les bouleversements hausmanniens des années 1860 et le percement de grandes places, dignes des parvis du Moyen Âge. La ville elle-même sort des limites de l’Ancien Régime, la fameuse barrière des fermiers généraux, doublant presque sa superficie. Rattrapées par un intra-muros augmenté de huit arrondissements, les gares ne sont plus des bâtiments périphériques en marge du tissu urbain parisien. Reliées au centre-ville par le percement de grands boulevards, les voici définitivement inscrites dans le paysage de la capitale, c’est-à-dire intégrées dans un centre historiquement et architecturalement très chargé.
Les mœurs en tout cas ont évolué :
« L’étude de la partie architecturale des chemins de fer, n’est plus comme autrefois, pour la plupart des architectes, un sujet de répugnance et d’invincible dégoût »
se réjouit en 1859 César Daly, dans la Revue générale de l’architecture et des travaux publics dont il est le directeur. Les termes ont l’air excessifs et pourtant on est surpris de constater la discrétion de certains architectes ferroviaires des premiers temps, au point que l’orthographe du concepteur de la gare de l’Est, pourtant si appréciée, en devient incertaine : François Duquesney pour la plupart des sources, Duquesnay tout court pour d’autres.
De fait, ces constructions relèvent autant du génie civil que de l’architecture proprement dite et par conséquent troublent les catégories ordinaires de l’art. César Daly est souvent cité lorsqu’il s’agit d’exprimer la menaçante nouveauté du monde industriel dont les gares constituent, pour les « vieux architectes », un des symboles les plus visibles :
Comment assumer des siècles d’héritage esthétique avec des bâtiments soumis aux lois nouvelles de l’ère des machines ? Devant ce défi inédit il est tentant de recourir à ces trompeuses « réminiscences du passé » auxquelles Reynaud faisait allusion dans son traité d’architecture, au risque de plaquer de force des formes anachroniques sur les structures les plus modernes. Sans que le terme soit employé, la tentation du kitsch est dénoncée avec fermeté par Viollet-le-Duc :
Dans son passage en revue des gares parisiennes, le vulgarisateur Amédée Guillemin fustige également ces réflexes passéistes qui, sur trop de façades, « trahissent encore l’hésitation des architectes, que retient toujours une éducation par trop classique ». Même si, à l’en croire, on peut toujours compter sur le bon goût français pour éviter le pire :
Mais surtout pour Guillemin, ces réflexes empêchent d’apprécier l’architecture des chemins de fer là où « le génie des architectes-ingénieurs s’est vraiment donné pleine carrière » : la hardiesse des grandes halles métalliques « où chaque ornement à sa raison d’être, où chaque pièce utile a servi à la décoration générale ».

Si l’artiste s’inquiète de devenir ingénieur, on demande donc à contrario à l’ingénieur de se faire artiste et d’associer l’esthétique à l’utilitaire. Une définition du beau qui a déjà trouvée en langue anglaise sa formulation, le design, au sens moderne que lui donne Henry Cole depuis 1849. À défaut de s’exprimer sur les parties maçonnées extérieures, l’innovation artistique aurait donc trouvé refuge à l’intérieur des bâtiments, dans les structures aériennes autorisées par la technologie du fer. Reprenant implicitement la comparaison avec les cathédrales, Guillemin n’hésite pas à user d’un vocabulaire connoté en évoquant « nef » ou « rosace ». Arcades métalliques et verrières seraient des avatars contemporains des voûtes gothiques et des vitraux du Moyen Âge, assurant aux gares une légitimité et une continuité dans la tradition architecturale. Cela n’exclut pas la présence d’œuvres d’art pour les espaces destinés à l’attente des voyageurs. Mais à la recherche excessive du luxe, qui « est loin de frayer toujours avec le beau », Guillemin préfèrerait une esthétique volontiers didactique, peintures et sculptures devant se mettre au service de la représentation « des grands inventeurs, les grandes actions industrielles, les hauts faits du travail ». Une logique qui rappelle là aussi le contenu narratif et édifiant des vitraux et peintures du Moyen Âge.

Quoique pour d’autres voix, ces cathédrales profanes aient aussi un air de Tour de Babel :

« Histoire des chemins de fer », conférence de A. Perdonnet citée dans L’ami des sciences, 1860
(commentaire hors guillemets du journal)
La suite de l’histoire en tout cas n’ira pas vraiment dans le sens de la sobriété architecturale. Avec sa nombreuse statuaire et sa décoration, la nouvelle gare du Nord de Jacques-Ignace Hittorff annonce déjà une évolution vers le faste et le monumental, ce luxe qui déplaisait tant à Guillemin parce que contraire à « cette élégance de bon goût, cette beauté simple, cette grandeur même qui résultent plus de la science des proportions que de la richesse des ornements ».
Par ailleurs, les agrandissements successifs de la période 1870-1900 aboutiront souvent à de quasi reconstructions où les bâtiments originaux sont tellement intégrés aux nouveaux édifices qu’il devient difficile d’en repérer les traces, quand bien même le plan général reste le même pour des raisons techniques. C’est le cas de la gare de Lyon de François-Alexis Cendrier, éclipsée en 1895-1900 par le nouveau bâtiment de Marius Toudoire, exactement comme celui de Reynaud avait été supplanté par l’œuvre de Hittorf. Plus grandes, plus richement décorées, ces nouvelles gares offrent à l’aube du XXe siècle des façades chargées de sculptures et de bas-reliefs. Leurs espaces intérieurs, tel le buffet de la gare de Lyon, accumulent dans un esprit fin de siècle compositions picturales, décors en staff et stucs dorés, tournant délibérément le dos au souhait d’austérité perceptible chez les commentateurs des années 1860.
Pour aller plus loin
- Bowie, Karen (dir.) Les grandes gares parisiennes du XIXe siècle. Paris : Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, 1987.
- Wilson-Bareau, Juliet (catalogue par). Manet, Monet, la gare Saint-Lazare : exposition, Paris, Musée d'Orsay, 9 février-17 mai 1998, Washington, National gallery of art, 14 juin-20 septembre 1998. Paris : Réunion des musées nationaux, 1998.
- Camard, Florence ; Zagrodzki, Christophe. Le Train à l'affiche : les plus belles affiches ferroviaires françaises. Paris : La Vie du rail, 1989.
- Le site Passerelles de la BnF consacré à la construction et à l’architecture.