Titre : La Fronde / directrice Marguerite Durand
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1898-10-04
Contributeur : Durand, Marguerite (1864-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327788531
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 04 octobre 1898 04 octobre 1898
Description : 1898/10/04 (A2,N300). 1898/10/04 (A2,N300).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k67034199
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, GR FOL-LC2-5702
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/01/2016
F.. • —
Celle nouvelle qui noasvieirt de Braxslles
tal-elle vraie T Pourquoi pasî
La reine de midâ" vin*»}Lî4^
nommée par I* roi Lèooold B. eoleueUe de
la première lésion de 1& garde civique de
Bruselles.
0
Wap»s plusieurs journaux italiens, le
Pape Léon XiH ewmttdéeM* te coDférer,
cette Annéo, ta Rose d or à la princesse Oi-
sèle de Bavière.
L* police d'Oporto a arrêté Mme Sorgue,
socialiste..
Accompagnée par les sodatoto» , porto-,
gais, Mrao Soreuc se proposait de faire une
conférence à Oporto.
Elle avait été expulsée du congres de la
presse, après avoir lanoê, daxM un
url verre à la figure du journaliste Msga-
liaes Lima, qui lui avait reproché d être
moins socialiste qu'elle ne le croyait.
--0 --
L'inhiunation de la reine de Danemark
à la cathédrale aum lieu le 15 octobre.
L'Empereur de Russie assistera à lacéré
TOonie. Il viendra de Liban à teMbegws
sur le vacht la PoUarmtin-Zjmzda. 11 arti-
ver» vendredi et séjournera pendant ue
semaine au cbiteau de BeMStoff.
UN PEU PARTOUT
Le train ramenant à Paris le corps de
M'ne Carnot est arrivé dimanche soir a la
aarc de Lyon à 6 h. 30. MM. Sadi Carnot,
capitaine d'infanterie, Ernest Carnot et les
mniittire* de la famille avaient seuls pris
place dans le train.
Un fourgon des pompes fuoèbres suivi
d'une voiture dans laquelle se trouvaient
NM. Pa»li et E rnest Carnot, a transporte le I
cercueil jusqu'à l'église de la Madeleine où
il est arrivé à 7 h.
M. l'abbé llertzog, 13.....cure de la Matlelerae,
a reçu le corps et a prononcé les prières
d'usage, puis le cercueil a été descendu
dans le caveau et déposé sur un catafalque
entouré de 4 lampaderes.
Aucune décoration extérieure n'a été
donnée au caveau et les parents et mem-
bres de la famille sont seules autorisés à le
visiter.
Les nombreuses couronnes envoyées en
hommage à la défunte ne seront portées à
l'église que dam» la soirée de demainou plus
probablement mercredi matin.
Les obsèques seront simples, MM. Carnot
n'ayant pas voulu contrevenir aux goûts si
marqués de leur mère pour le: simplicité.
—o—
Le Groupe do la Solidarité des femmes,
-réunion extraordinaire le mercredi 5 octo-
bre, à 2 heures précises, salle de la mairie
du VI. arrondissement, place St-Solpioc.
Ordre du tour : Reprise des travaux;
— lecture du catéchisme féministe par la
• secrétaire Mme Kauffmann ; organisation
d'une commission du travail ; propositions
diverses.
—o—
On annonce la mort, à rAge de cinquante-
deux ans, de M. Lambrecht, secrétaire-
bibliothécaire de l'Ecole des langues orien-
tales rivantes.
LA DAME D. VOILÉE.
AUTOUR DE LA REVISION
Le Matin a complété hier le récit de
YOôserver, en publiant les révélations de
M. Ilowland Strong, correspondant du
journal anglais.
... J'ai LlÚjà. Mlcont\: la façon dont le bordereau
fut ciril et par qui. Mais il y a un détail intercs-
gnut que je n'ai vu nulle part : M. [,:stertiitzy m a
ranih-lè que les rei>r»»due lions de ce document
«lui ont paru dnus lus journaux n ont pas eus
faites d'après l'original. Ktant donnée la tenu:Ui
du papier pelure sur lequel il était trace, on ne
pouvait le calquer, car les lettres se voyaient à
travers le papier et occasionnaient DM confu-
sion de traits. Par suite, il y a deux ou trois
mots dans les dernières lignes du document
copié qui ne sont pas du tout de la main d bs-
tcrhazy. Otto copie calquée fut invariablement
produite devant les tribunaux partout où Jo
bonlereau fut soumis comme témoignage.
C'est ainsi qu'au conseil de guerre devant le-
quel tëaterhaxy a comparu pour la première fois
J ancien connu:!niant, quand on lui montra ce
document — le calque — put lépoodro en toute
vérité qu'il n'en était pas 1 auteur.
* Les complicités
En dehors de la paternité du bordereau, la
seconde déclaration essentielle que M. Ester-
bazy m'a faite est de ta plus grande importance.
FAI admettant qu'il ait fabrique certains ducu-
ments, il y a,dit-il, d'autres j»orsonnv:8, occupant
1rs situations les plus élevées, qui s en sont
150r\' U .."81 clair qiiS ces déclarations sur ce sujet
ne peuvent être reproduites que sous les plus
expretil5ès réserves..
Û'aprt'a lui, la décision prise par M. „ Bertulusa
au sujet des télégrammes atones a Speranza -
et . Blanche g était parfaitement juste et bien
fondée..
» Les deux télégrammes « Spcranza » et
• Manche .. nous dit M. Esterhazy, étaient des
faux voulus. Ils furent faits snr l'ordre direct
du colonel du lJaty de Clam, agissant au nom
de n;(at.major, dont le but était d avoir un
ii'rtruinent en mains pour s'en servir contre le
colonel Picquart si c était nécessaire, et auss
"J * . t > . ii
Mue de potiee — fer m SHBSuSSjfcgji if -
fieSSSËua "il te»&^Lsjr^^d^
0-
du*
nii
M^raSumnidn ooloBp^iu^P
èm arriv4«Mveê«l^v *
UL MeÉncttaeMitleMlHlAHlrtisM
àMÉkairifii3e ses dMsâetlwae: «urdre de"
fabriquer ces documente, disait-Il, n'aurait ja-
mais pu être donné sans avoir été approuvé par
une très haute autorité militaire. la fait da
contresigner en quelque sorte cet ordre ooustt-
t- ë'aprts le là fwmsis», Yusag*dê pnuefsk).
M. Bertulus n'avait pas le moindre doute quant
à l'auteur véritable cr. ces faux. et détail tm H1d
atd uètt ému teesef
. Ce juge décida que je serais poursuivi et
jugé. Un appel fut fait... moi d«v»at la tim-
bre des mises en accusation, et alors 88 passa le
fait extraordinaire suivant :
• LtnNtMMt ntfnMérielle s'easrçajMorpir-
au
fineompéteeeede M. Bertnlus ea ee qui concer-
nan cet officier fut prononcée parla chambre des
miàcs en accusation.
L'adoa goaveraemiaBtale
. Dans le cours ordinaire des ehmu..Imiffl'ack
appel est fait d'un ordre de poursuivre,le prison-
nier soumet un rapport à la chambra des mises
en accusation. Mon rapport était prêt, et,cepen-
dant, le erohrieat-vous? les juges refusèrent de
l'écouter, et je fus remis en hberté suis qu'on
oùt pris connaissance des explications que j'au-
rais pu être disposé h faire.
• C'est là oe qu'un ministre a appelé a faire
sentir l'action gouvernementale ».
M. Esterhazy, poursuit M. S troog. m'a déclaré
que, depuis le début de l'affaire, 1 Etat-major lui
avait fourni des informations secrètes alir. qu'il
pût s'en servir pour M défense personnelle.
- Ainsi, in'afllrma-t-iJ, lorsquo le général de
Peilieux pourswvailsa première enquête sur ma
conduite, avant mon procès devant le conseil de
guerre, de je recevais tous les jours de M. du Paty
e Clam une note écrite disant sur quel sujet les
différents témoins seraient examines et me don-
nant les indications nécessaires pour que mes
réponses ne fussent pas en contra diction avec
les leurs. »
M. Kslerhary prétendait que, s'il avait été
chassé de l'armée, c'était parce que l'Etat-major
ne voulait pas avouer à M, Cavaignac les faits
vrais de la situation. M. Cavaignac était résolu à
se débarrasser d'ltstarhazy. Il voulait qu'il fût
- tué moralement - «pour se servir delà pro-
rre expression du ministre It. qu'on le jetât de
lOrs comme on jette du lest, pour employer celle
du chef de cabinet du ministre, le général Ro-
Ce fut cette manière d'agir que rex-comman-
dant ne voulut pas endurer,et il était déterminé.
s'il était mis de côté de cette cavalière façon. à
en entraîner d'autres dans sa propre chute. L&
colonel Henry, après avoir été forcé de confes-
ser son faux et en se trouvant abandonné à son
sort, s était suicidé. M. Esterhazv était une autre
nature. C'était un combatif, un homme de lutte,
et il voulait vendre sa vie et sa réputntion chè-
rement.
L' « homme de l'État-major »
« Pendant des années, m'a dit M. E.sterhazy,
j'ai été ihomme de l'Etat-major, et personne ne
connaît le secret de l'affaire Dreyfus aussi bien
que moi. C'est par ces mots : « Je suis l'homme
de Vgtt.,t-triajor » que j'ai commencé mon rap-
port écrit aux juges du dernier conseil d'en-
quête, et j'en dis alors assez pour rendre mes
jujçetf très disposés à !n*.tc'tuitt.cr ; mais la pres-
sion ministérielle était trop forte. a
Telles sont les lignes générales des révélations
que de M. Esterhazy m'avait, à l'origine, proposé
e faire dans mon journal, pour ensuite, les
relater en détail daRS un livre. Depuis lors, M.
Esterhazy a légèrement modifié ses pla-is. Sa
première idée était de publier ses allégations au
sujet de La complicité de l'Etat-major dans les ■
faux « Speranza » et « Blanchi! » le premier
jour ,le la réunion des Chambres, c'est-à-dire
vers le t8 octobre, de façon à provoquer, tout
au moins, une crise ministérielle.
La paternité du bordereau devait être réservée,
jusqu'au dernier monvnl, commo « gros pé-
tard It, pour employer sa propre phrase, p»;turd
destiné à faire »aut*r la Pruioe ju-;tlu aux
nues. 11 entretenait môme l'idée itig-imiouso et
quelque peu diabolique de le faire éclater lo
lendemain du second procès de Dreyfus, où
l'effet serait étourdissant, surtout si le miséra-
ble captif de l1Ie du Diable devait être recon-
danine, comme t' commandant pensait qu'il
pourrait bien l'être.
Palàaal;luDs
M. -André VCI'voort,directeur du Jour,
s'étant trouvé offensé par un entrefilet
pa.ru hier dans Y Aiti-ore, a envoyé hier
matin deux de ses amis MM. Daniel
Clonlicr et Augustin Thierry à M. de
Pressensé, l'auteur de cette note.
Les témoins de M Vervoor~ se sont
présentés à ii heures dans les bureaux
du Temps et ont immédiatement été in-
troduits auprès de M. de presscnsé qui,
à l'issue de cette entrevue, leur aadressé
la lettre suivantes :
Messieurs, ..
Je n'ai nullement l'intention de constituer des
témoins pour rendre raison à M. André Ver-
voort d'un entreliiot paru dans l'Aurore, bwr
matin, sous ma signature et reproduit par 1 A-
gence Nationale. Ju me suis contenté dop|Hjs»'r
— dans la stricte limite cie mon droit — un dé-
menti au récit mensonger publié par le Jour,
journal de M. Vervoort. J'ai rétabli les faits et
j'ai demandé au publie de choisir entre ma pa-
~r—t-—'
-
Vervoort, 4oa& le toeteai S>3^^^^nSi
L%mofiftit
wmml, aBrimUe bml »H| m
7oyit l&liMre wbmto :
Si niiiilpi eompte des tiHÈêtHÈÊÊ^m terni
iwodeits Wer UIX abords de la
certains journaux prêtent à moa |||jHp eris
.^tfiJL^n'a jaa^^Aréa.t
crié : « 55e Pioquart 1 RevSon I'>»!!3RBlI^
ment : « A bu l'armée / A bas la RwBpJJbas
la pet" 1 *, mat laveieioa dtt(Areta|p|pupar-
Mon fils a te respect de l'armée et Émmmr de
ses MM. et. c'est véritablement krtwfclÉ InJiiHre
1 que aemt attribuer d MtMt me" peeeee.
Agre
ùble Tin it
~l
-
M. ûm -*t'y. ie daa
t D'après la Capitale, M. du Pèty de
Clam est descenQu,jen dedans un hôtel
de Rome sous le nom de comte Marcois
de Beel..
U s'est entretenu avec quelques amis
et avec un journaliste français, et est re-
parti samedi en disant qu'il allait à Na-
{4es ; mais il a pris le train pour la Haute-
UaIMt.
Au domicile de M. du Paty, on déclare
que l'ami d'Esterhazy se trouve actuelle-
ment à Brest, et que sa correspondance
lui est adressée dans cette ville. En con-
séquence, M. du Paty de Clam a passé
par la Bretagne pour se rendre en Italie.
L'instruction que la Cour de cassation
fait actuellement sur « son oeuvre » l'a
sans doute décidé à s'éloigner mlJmenta-
nément.
MARINA POLONSKY
Mme Marina Polonsky vient de succom-
ber'aux'suites d'une longue et douloureuse
rriaMic. Avec elle disparait une des plus
grandes et des plus nobles figures du parti
révolutionnaire russe.
Elle s'était réfugiée à Paris,il y a environ
quinze ans, à la suite d'une condamnation
dont elle fat l'objet pour avoir pris part à
un complot nihiliste. Elle était un des der-
niers membres survivants du glorieux et
terrible comité exécutif de « La volonté du
peuplo Il (Narodna'ia Volia) dont les vaillants
efforts et l'énergique résistance firent pen-
dant longtemps l'admiration du monde en-
tier. Pendant do longues années LaNaTod-
nata Volia tint en échec toutes les forces de
l'aristocratie russe et déconcerta les recher-
ches de la police.
Mme Marina Polonsky a été enterrée hier
sans pompes et sans cérémonie ; aucun dis-
cours n'a été prononcé sur sa tombe et
quelques amis seulement ont suivi son cer-
cueil.
Gela résultait d'ailleursde volontés expri-
mées par elle dans une lettre que nous
pubi ions ici, et qui nous a été communiquée
par M. La.vro!T qui fut un grand ami de la
défunte.
Désireuse de laisser à mes amis le souvenir
d'une personne et non, d'un cadavre, et croyant
en même temps que les soi-disant a derniers
honneurs » (coutume absurde), qu'ils se croi-
ront obligés de rendre à mon corps ne feront
qu aviver inutilement la douleur qu'ils éprou-
veront à ma mort, je les prie do laisser aux
étrangers lo soin de s'occuper do ma dépouille
et de ne se rendre ni à mon lit de mon, ni à
mon enterrement. Celui-ci doit du reste ôtre
des plus simples : convoi de la dernière classe,
fosso commune. J'aimerais encore mieux être
incinérée, à condition que mes cendres soient
jetées, dispersées, et non amassées et gardées
par qui que ce soit. Pas de discours, pu de cou-
ronnes, pas de lettres de faire part, pas de bio-
graphie, cela va sans dire. Dols-je ajouter que
mes obsfrjucn doivent être civiles t
Fait et signé de ma main à Paris le 21 juin
1898.
MARINA POLONSKY.
P. S. — Après ma mort, on ne trouvera dans
ma chambre que quelque linge et quelques
robes que je prierais de distribuer aux gardes-
malarlcs qui m'ont plus ou moins soignée et qui
se trouveront encore dans l'établissement au
moment de ma mort. Quant aux manuscrits et
aux. lettres, depuis longtemps déjà, je les mets
en lieu sûr, pour ne pas donner au corsât russe
(cp, valet que je déteste presque autant qoe son
mattre). le plaisir de s en emparer après ma
mort. J'espère que monsieur le consul et tous
les agents me sauront gré d'avoir pris cette pré-
caution, qui leur épargnera la honte d'an nou-
veau procès : ils out bien assez, jo suppose, de
l'affaire Sawitzky et du procès que nous leur
avons intenté et qui a attiré au gouvernement
russe et à ses représentants en France, le mé-
pris de tous les honnêtes gens, sans compter les
- dommages-intérêts » (ou « les frais », je ne
sais pas au juste) auxquels ils sont con-
damnes.
M. P.
^llpj liiimai tUée vol? p. Lavret Mpt» <
torr,
trioè 4*la * iïSS? ï. LavrofT «eus tend
cordialement la mata eàapvae tm bon sou •
ixfe»* a'Mwuse de ne ....i.r satisfaire
wtÈm Uritt Lisez la liIDN. nous dit-il et
fouayemarque Je ne foi» parter, o'eet la
formelle de m obère morte et
sengMi
niéai demeure. Je sais le doyen des réfu-
giés rttsaes à Paria. j'ai sotxaute-qiiinze ans
#awM, et d'ordiMinau MifM l'un d'entre
mm fg«rt, c'est mm quip))MOWcer son oraison rueihvfi.
Ptmr Marina Polonsky j'ai dû me taire
voulant absolument me oonrormer au
vesu qu'elle a émis,et maimenam enoere le
ne puis, sans allorù rencontre de ce qu'ene
a désiré. vous donner aucun renseignement
sar _110 qui fut le eourege, la bonté et
l'intelligence même et à la mémoire de la-
quelle je voudrais voir élever un impéris-
sable monument.
Rien ne peut exprimer quelle fut l'éner-
gie de cette femme qui contribua peur une
grande part au -dàvelq*emeut du fâxaiai*-
me en Russie. Cest par miracle quelle
échappa à la rigueur îles lois et qu eue
n'eut point à subir la peine des travaux
forcés comme beaucoup de ses compagnes
et cie ses imitatrices.
Et à ce propos, M. Larvoff très ému nous
montre des essuie-mains brodés qui lui
ont été envoyés du fond de la Sibérie par
de malheureuses femmes qui subissent
d'atroces souffrances sous le climat le plus
inclément du monde pour avoir trop aimé
la justice et la liberté.
Kn France, Mme Marina Polonsky s'est
beaucoup occupée de la question des syndi-
cats ouvriers et elle fut en rapport avec un
granJ nombre de nos députés socialistes,
notamment avec M. Vaillant qui fut un de
ses trèi fidèles Mnis. Faisant abstraction de
sa personne, ayant abandonné jusqu'à son
véritable nom, cette femme grande et sim-
ple a consacré toute sa vie à la révolution,
A Paris, sa maison était ouverte à tous les
réfutés russes et elle combattit la cause
qu'elle défendait jusqu'au moment où la
maladie vint la terrasser. Après deux an-
nées de grandes soutrra.ncos.elle est entrée
dans le repos de la mort emportant avec
die les témoignages d'admiration, de sym-
fUl:tip et de respoct de tous ceux qui l ont
connue ou approchée.
JEANNE BRÉMONTIER.
M. de Boisundré, dans la Libre Parole,
rectifie un passage très accessoire du
récit que j'at fait dans la Fronde de mon
récent voyage à Londres.
Si M. de Boisandré tenait absolument
à rectifier quelque chose, il me semble
qu'il aurait dû commencer par s'occuper
de ce qui le concerne personnellement.
Il y a quelques jours,un de nos confrères
du soir écrivait au sujet de son duel
avec M. de Dion :
JI. de Boisandré s'attribua même quel-
ques records de vitesse qui sont restés
légendaires.
S'il y avait urgence à rectifier, c'était
hip.n dans ce MtS-ià.
J. B.
CHOSES DE L'ENSEIGNEMENT
Le Congrès de Rennes
Nous couchons sur nos positions; mais s'il est
vrai que la gloire se mesure au péril affronté,
nous avons droit à Cadmiration des foules. Ces
pauvres délégués cantonaux ont, en effet, une
si mauvaise réputation, que la majorité de l'as-
semblée pléniere a failli les supprimer, et c'en
eût été fait des déléguées qui nous tiennent si
fort au cœur.
Tout est bien qui finit bien ; après une agita-
tion qui dégénérait presque en brouhaha notre
proposition a été volée. Quand passera-t-elle
dans la loi ?
A quelle époque toutes celles qui ont été dis-
cutées et adoptées dans les quatre autres com-
missions y seront-elles de même inscrites ?
Chi lo sa ! Mais ne fût-ce que pour remuer en-
semble dos idées, les congrès sont excellents.
Or c'est à tlota que les idées ont coulé ces jours-
ci; il y en a tant que je renonce à mettre dès
maintenant toutes ces richesses en ordre. Dans
quelques jours, je donnerai une liste exacte de
tous les résultats du Congrès et je me borne en
ce moment à en tracer une ébauche aussi fidèle
que possible.
La matinée a été très chaude au sein de la
commission des tXBUZ; c'était la liberté de l'ensei-
gnement qui était sur le tapis. Or il est à remar-
quer que cette « liberté de renseignement
n'existe que pour l'e» saignement prive contre
l'enseignement de l'Etat. Et ce n'est point ici un
paradoxe. En effet, tout instituteur attaché & une
classe d'école pubiiquo doit avoir le brevet su-
périeur; blique tout instituteur dirigeant une école pu-
lique doit être pourvu en outre du certificat
d'aptitude-pédagogique, alors que dans les écoles
privées le brevet élémentaire est la règle — trop
souvent violée — le brevet supérieur est l'excep-
tion, et que le certificat d'aptitude pédagogique
est ignoré (j'en appelle au témoignage de l'au-
teur des Religieuses enseignantes.).
Dans l'enseignement secondaire publio, le bac-
calauréat ne suffit plus pour un simple répÓli-
teur; la licence est reléguée dans les collèges
communaux ou du moins ne donne pas le titre
V"
t
m
9
« L8 ilMNMMI a©GOtc» nBBMvros jvnvwv
118 iasUtuiewi'P employés 1Iaa8 008.......;
tes directeurs et les frotefliearo des établisse-
mu
aux
tiens que 1. directeurs instituteurs et
seuFS des écoles primaires el des- établissements
d'enseignement secondaire pabUes ».
Un autre vœu mérite dètre immédiatement
signalé.
. Toutes les sociétés d'instruction populaires
s'efforceront d'organiser des conférences de pro- 1
paxande accessibles au grand publie, poarcom-
DIéIe. l'enseignement moral et civhpie des et .
toyeits, et pour mettre en lainière les questions if
d'aetualité ».
La hMBÎèM! Elle me pan1t être oMh&e sons de
gros nuages dans le pays que j habite dépota qua-
tre jours ; et oequi me donne la mesure de 1 obs
cunté régoaDte,o'est que nous attendions M.Léon
Bourgeois qut,avant d'être ministre de l'instruc-
tion pttbliqueétaitprésident de la Ligue,qï son Ame
vivante et agissante. Or, nous ne le voyons pas
arriver, et est même assez probable qu'il ne
viendra pas, parce que sa présence scandali-
serait la majeure partie de la population de
Rennes. Car -on He sait trop comment dire eela
honnêtement — M. Bourgeois est accusé d'être
révisionniste I
Mais... 06 faisons point de politique et trans-
crivons un vœu de la commission d'extension
universitaire :
a Il est désirable que la solidarité des profes-
seurs des trois ordres s'affirme de plus en plus
dans leur libre collaboration à l'œuvre de l'édu-
cahon populaire, à laquelle seront admis et
appelés les étudiants de tous ordres et les amis
de rUniversite. a ,, ...
(Ce vœu concerne l'éducation des adolescents
l et des adultes des deux sexes), j'ai souligné les
deux derniors mots, et j'ajoute que jamais dans
aucun congrès — sauf les congrès féministes,
bien entendu — en n'avait eu, comme dans
celui-ci, le souci d'assooier la femme à tout ce
que l'on demandait pour l'homme.
Et les fêtes continuent, alternant avec les
séances et les conférences. Hier soir, conférence
culinaire de M. Driessens, qui nous a révélé
tous les secrets de la Soie normande, ce soir,
retraite aux flambeaux.
Demain... mais : à demain.
Les questions posées, discutées et votées au
Congrès de tiennes sout si intéressantes et si
nombreuses que jo n'ai pas la prétention môme
de les effleurer toutes dans ces lettres à toute
vapeur. Je me borne pour l'instant, à signaler
soit celles qui ont le plus intéressé les capita-
listes, soit celles qui mo paraissent intéresser
spécialement notre journal.
Le rapport de Mlle Saffroy, membre du
Conseil supérieur de l'Instruction publique et
inspectrice des écoles primaires de Paris est à
sa place, ici plus encore que partout ailleurs. Il
s'agit du patronage des jeunes filles et des asso-
cialionl d'anciennes élèves.
Les associations d'anciennes élèves, dit
Mlle Saffroy, sont très goûtées et déjà très
répandues. C'est, en effet, la forme de groupe-
ment qui se prête le mieux à une organisation
rapide, qui donne des résultats immédiatement
appréciables -...
« Bien des œuvres solliciteront le concours des
associations de jeunes gens, mais il n'en est pas
de plus propre à intéresser 10s associations de
jeunes (Illes que celle dos patronages ».
Et Mlle Sallroy définit « association » et « pa-
tronage Il l'une s'adressant aux jeunes Il lies
ayant dépassé l'âge scolaire, l'autre,les groupant
au moins dès l'âge de 9 ans. L'« association re-
pose sur la mise eu commun de forces à peu près
égales; le patronage est avant tout œuvre de
sauvegarde et de protection. » Et en terminant
son rapport Aille Saffroy pose les cinq questions
suivantes qui pourraient donner lieu dans la
Fronde à un échange de communications inté-
ressantes :
t. Est-il possible, est-il désirable que les as-
sociations de jeunes gens et do jeunes tilles dont
la prospérité est maintenant assurée, s'attachent
à des œuvres sociales ?
2° Quelle peut être l'inOuenco des associations
des jeunes tilles sur la création et la prospérité
des patronages ? i
3* Dans quelle mesure l'action des patronages
peut-elle s'étendre aux mères de famille ?
4, De la création d'associations de mères de
famille?
5" De la création, pour les jeunes fillest d'éco-
les pratiques d'agriculture ? ,
Le Congrès a répondu affirmativement a la
première ; il est d'ailleurs un fait acquis que des
associations de jeunes filles s'occupent de vêtir
des enfants indigents, et de coopérer à des
œuvres philanthropiques.
Il e engagé les associations de jeunes fllles q,
donner leur temps, leur activité, leur galté aux
réunions hebdomadaires des patronages.
Sur la troisième question, M. Priou, président
de la Société d'instruction populaire de tiennes
a dit que le concours des mères de famille a
permis à la Société de pratiquer avec un grand
succès la co-instruction. Jeunes gens et jeunes
filles reçoivent lo même enseignemeut, assistent
aux mêmes cours, et les mères de famille, assi-
ses sur les mêmes bancs. sont à la fois les sur-
veillantes et les condisciples de leurs filles. Et
M. Priou estime qu'on peut demander à de telles
femmes d'être les fondatrices do groupes d'A-
mies de l'école et d'intéresser spécialement ces
groupes à la protection des jeunes JUles orphe-
lines.
La quatrième question a été notée sans ob-
servation; la cinquième a été au contraire très
disculéel
L'idée d'enseigner l'agriculture à la femme
^ - ^
Crisnadimi me jeme Ah dont les parents
cæ::: ' . "".P"""'" .. OTOTM «Mt lotorêtà
telle au viSge pattr «Kgttar aa vie. pullqu'..
village Il n'y a auras moyen d'exercer son aeti-
vitéTPour elle, a n'y a que l'abandon du peut
coin natal ;* vis ea loin
la domesticiti» ftvomt qaeetet deuloureux et
dangereux.
Jo .
Vin* arrondissement de Paris, président do
T Association de la PMSSS de lqpdûnetnent,sur sur
le rôle de ta Presse dans Fédueation populaire, a
été très applaudi. Après avoir fait le tableau des
pMgfèe aeoesipMe ter les Journaux spéciaux de
pédagogie qui ont attendant une influence res-
tntte an jMfeUe ....-nut, il ajoute :
« La pédagogie a fait son entrée définitive
dans les gmdes, revues littéraires et scienti-
fiques et dans les grands journaux politiques
quotidiens. , ,
La duiabue de renseignement, qoe le lec-
teur retrouve périodiquement sous une forme
0ns familière dans spa journal politique, met à
aapokèi . III"'" .I1IIJ" n'eat pm eté cher-
oiwr dans bu organes spéciaux rédigés surtout
pour des profedfonnels. Le grand publie est
ainsi tenu au courant des recherches, il profite
des découvertes faites par des pédagogues, et la
pédagogie cesse d'être une science fermée. in-
terdite aux profanes.
Grâce iL cette diffusion, à cette floraison nou-
velle de la Presse de l'Enseignement, les nial-
tres et les maltresses sont mieux renseignés et
se sentent plus soutenus. La confiance pénètre
dans les familles qui s'intéressent davantage aux
travaux de leurs enfants. Les élèves eux-mêmes
sont mieux préparés, leur esprit s'clévo et s'é-
largit au contact dos idées nouvelles qui leur
ont été préalablement appropriées
L'éducation donnée à 1 école ne saurait pro-
duire ses fruits qu'à la dounle condition de trou-
ver dans l'élève un terrain favorable et de s'être
assuré les concours éclairés de la famille.
De même que l'on a su intéresser l'enfant à
ces études par ces n.mjaslnes et ces journaux qui
ont tint frappé notre jeunesse et que nous ne
pouvons relire sans émotion, il est indispensable
d'attacher les parents et de les retenir en les
associant aux efforts que font leurs enfants paar
s'instruire.
On remarque qu'à mesure que l'Etat et les
institutions d'initiative privée s'évertuent davan-
tage pour la formation du citoyen, la tendance
de beaucoup de familles est de se désintéresser
d'une œuvre dont on se charge si volontiers à
leur lieu et place et qui reste néanmoins le
premier de leurs devoirs: le devoir primordial
des pères et mères, l'éducation de l'enfant par
laquelle ils refont et complètent leur propre
éducation. 11 est nécessaire, à l'heure actticlit!,
de rappeler qu'il y a là un devoir individuel et
par dessus tout un intérêt social. »
Enfin, l'auteur de la communication fait con-
naître au congrès l'association qu'il préside :
L'association des membres do la Presse de
l'Enseignement se propose, en mémo temps
qu'elle assurera la protection des intérêts pro-
fessionnels de ses membres, d'étudier avec eux,
de discuter les solutions à proposer au Parle-
ment, aux pouvoirs publics et à l'opinion publi-
que, et de se mettre d'accord sur lets campagnes
& entretenir en vue de réformes nouvelles.
Qui peut douter que la force de la presse de
l'enseignement sera plus grande, son action plus
certaine, qu'ello sera plus indépendante et plus
respectée lorsque l'union des bons vouloirs et des
dévouements aura été ainsi réalisée, lorsqu'une
direction librement ressenti o lui aura été impri-
mée.
L'accueil fait à cette idée a été en quelque
sorte unanime. Immédiatement les organes de
la Presse Pédagogique ainsi que nombre des
chronitlucurs de l'Enseignement, appartenant à
la rédaction des journaux politiques et les ré-
dacteurs de bulletins spéciaux out adhéré à ses
statuts. Les patrons sont venus de toute part et
de haut. Citons avec les noms de Dcrlhclot,
Léon Bourgeois, Leygucs et Poincaré, ceux do
Gréard, Buisson, Ltgouvé, Mézières, Boutmy,
llréal, Fouillé, Lavisse, §arccy, Mme Kergo-
mard et Mlle Malmanche.
L'Association des membres de la Presse do
l'Enseignement a, dès son premier exercice,
donné des gages. Elle a proposé à la Chambre
des députés un texte de loi sur la responsabilité
des instituteurs. Elle a mis à l'étude fa que t on
des garanties qui doivent être assurées au per-
sonnel ( joignant en cas de déplacement d'or-
llce, et proposé une solution. En Un elle a pré-
pare l'organisation d'un Congrès de la Presfso
de l'Ens ignement pour 1900, et présente à son
examen les questions suivantes :
1* Râle du la Presse de l'Enseignement dans
tous les pays, ses moyens d'action sur les pou-
voirs publics et l'opinion;
2' Organisation d'un bureau international de
renseignements sur les questions d'instruction
et d'éducation ;
3" Action de la Presse de l'Enseignement sur
l'éducation populaire;
4, Rapports à établir par son intermédiaire
entre les divers ordres d enseignement;
5' Moyens à employer pour associer les fa-
milles à l'œuvre de l'enseignement et de l'édu-
cation.
Elle prépare pour 1900 la solution pratique de
ces questions.
J'arrête ici, non pas la discussion des fJUrs-
tions posées au Congrès, mais le compte rendu
quotidien de nos travaux; car nous avons Uni.
Aujourd'hui, séance solennelle de clôture sous
la présidence de M. Bayet, directeur de rensei-
gnement primaire. remplaçant M. L. Bourgeois.
Grand et légitime succès. Distribution de tuh:m
violet, car... il faut bien que le commerce lIlar-
che. Banquet à la mairie (j'ai décidé plusieurs
femmes à y venir et j'ai eu raison, car elles y
out tenu leur place à leur satisfaction et surtout
à celle des autres^. Jamais ville ne fit à un Con-
grès un accueil plus emprcssé,plus cordial, plus
brillant.
Il fallait voir hier soir la population suivant la
retraite aux flambeaux 1
PAULINE KERGOMARD
(1)
LA TRIBUNE
4 OCTOBRE 1898
NOS TITRES DE POLITESSE
MONSIEUR, MADAME ET MADEMOISELLE
I
Monsieur
CAM rvbriqme fan* an «M.
ow k ntfel tkange tous les trou jour*.
i II n'est presque pas on de nos mages
mondains qui ne soit absurde par ses
origines, et en contradiction flagrante
avee ce que notre'conscience contempo-
raine considère comme le droit, Injus-
tice et même le simple bon sens. C'est
ce que sir John Lubbock a si bien
nommé des survivances, c'est-à-dire des
usages qui ont pu avoir leur raison d'ôtre
dans un Damé lointain, dans des états
sociaux différente du nôtre, mais qui
jurent, comme des insanités, dans nos
sociétés actuelles.
Tels sont ces titres de politesse, Mon-
sieur, Madame et Mademoiselle dont
nous faisons si grand abus.^.
Ni en Orèce,ni à Rome nous ne voyons
les citoyens se donner entre eux. des
Utres analogues à noire mes Monsieur
(Test par le non» propre qw'ih s'mtef.
Client individuellement. A Rome, Fom-
*r ftumMStM an gewpto nsseyMé en
** eSoyens. Les^recs disaient pedgi4m.
Cie&on appelait les sénateurs pfres coas'
crits, (paires conscripti). En'général, en
lear parlant iodrriàueUenent on les sî>-
•elait semaine* "'''''6
C'est que le Sénat ......, d'apvta l*
tradition, était .-fO'6t à l'etteiiM» des
chefs dee eent premiers élans tsavs ées
«yajèofétTajwtés^StSfs
ai 8,1 M'M-fâfo liualoii dM émm eiMi.
nous Tullus Hostilins. DelèyeeMttdcmé
A tous les sénateurs de paires conserfyti
m tninriti emesMe. Ma* le 4Um de
adeeémz ta 4w m tif&.
volu dans chaque famille patricienne,
non par droit de priniogéniture, mais
par droit de sénescence. Le chef de la
famille, le pairici ou patronus était le
plus âgé de ses membres. Un sénateur
ne pouvait être mineur. Le patriciat ne
pouvait tomber en tutelle. De là le nom
d'anciens, seniores, qui leur était donné
par opposition à j un iores, les cadets, les
jeunes,
C'est du latin senior que l'italien a fait
signor, et l'espagnol senor. C'est ainsi de
ce mot senior que le français a fait sei-
gneur, puis ses dérivés sire, sienr, mes-
sire et, enfin, monsieur..
Le titre de seigneur s'est généralisé à
l'époque féodale, avec le sens de noble,
de suzerain, de maître. Il montait d'étage
1 en étage jusqu'au roi, suzerain des suze-
rains, seigneur des seigneurs.
Cest par le mot seigneur que l'Eglise
a traduit le latin dotnmm, chat ou maî-
tre de maison, (408¡.).
Du latin dominus vint le titre abrégé
don ou primitivement dom qui resta
longtemps employé dans la hiérarchie
ecclésiastique. 11 fut donné aux abbés,
aux moines et clercs enseignants* jus-
qu'à la Renaissance. Ce titre s'est sur-
| tout perpétué dans certains ordres mo-
nastiques, têts que les bénédictins.
En Espagne, le terme abrégé Dm de-
vint dtsfanctif de toute la noblesse et porto
par tout gentilhomme, tout chevalier,
par Don Juan,coatuoe par Don Quichotte.
Au mjMCQÏin, il .n'a pas pa^é,4ans les
autres pays latins quiont adopté 'les
venteaftes degrés deSemtyi
Le tenaedematongtào»* gs?**!*
sens nrittitài d'ancien. M feéfeftsyneByaM
de père. On disait grall4HtN pour grand-
père. Avant d'être dmx 8 a
posseseMrs de ou de
cbI eaies, tell que le sire de ec.,.14
sire de Joinville. le sire de Lavàl, type
~ , original de Barbe-Bfeue.
SniisiLouisXlf M descendit à de iliia-
aise bouJiesia, à des parvenus tels nue
Olivie*4a»Beiiat rime damnée du vleu*
MMtMjHC etTenéeutnar» de sencmanlée.
SMIC9 9iOv -VVHW WfmP
"sSî* -mugi 4e ca. sggnéixron
époque plus récente. Ce fut le titre donné
aux gens de robe, aux bourgeois ano-
blis, aux financiers enrichis; puis aux
bourgeois des villes, aux échevins et
aux autres officiers municipaux, quand
on les désignait à la troisième personne.
En les interpellant, on disait mettirt.
Les officiers judiciaires et gens de ba-
soche étaient appelés maUrts, (du latin
magister). Les clercs ou escholters don-
naient ce titre à leurs professeurs.
C'était aussi le titre des chefs de corps
de métiers, des artisans-patrons qui
avaient brevet de maîtrise.Leurs ouvriers
n'étaient que compagnons ou apprentis.
De nos jours, on revient beaucoup à
l'usage du mot Maître. Non seulement
les étudiants le donnent à leurs protes-
seurs, mais les jeunes politiciens le don-
nent aux chefs des partis auxquels ils
accordent leur confiance. On le donne
aux écrivains, aux artistes, peintres,
sculpteurs ou musiciens qui ont acquis
.de la notoriété.
C'est une appellation plus logique et
plus flatteuse que tous le.3 dérivés du
la'in,seHiol',est moins déplacé,dans notre
état social, que le diminutif de monsei-
gneur, Monsieur.
Les nobles ou gentilshommes furent les
premiers à se donner ce titre entre eux.
Ba valeur honorifique fut longtemps
"Wate. Il fat parfois do naé Qu roi lui-
même, non sans provoquer de sa part
des protestions, Un frère du duc de
Vendôme ayant appelé Monsieur 1" roi
François, celui-ci lui observa que s'il
aoa ataé à lui donner ee w..,
il n'en était pas de même du cadet -Au
XÏftPyflitole Mensteur, sens auto» titre
ou nom, désigna le frère du roi.
Dès le XVI' aiède.1e titre de Mmuidm
était descendu aux gêna de rotejta
disaitHessieurs du a=e= A%&f8S
Il se géAéralm paraît tosge^deliMs,
ffl #&v«W. On dit alors Measiii§*i9
fAfladésMft. B «•'étendit eux mm»m «I
. «kilitaise». On disait Monsieur flewwf
'Efttfn*7MaMfet»r Jeep WatUmmmÊm
'' ^ MeStSSp
00mit dKjNnSS*
mm* deMro.ird5fip
&Kfcfiiu»6tor4,aGwm0 M. rouwflMg»
H'
XVIII. siècle acheva l'anoblissement par
l'esprit, et l'ancien valet Rousseau passa
à la dignité de Monsieur, en même temps
que le même titre se généralisait parmi
les nobles rapetissés à la taille de valet
de cour. Dans leurs fiefs, ils étaient en-
core Monseigneur, à Versailles, ils n'é-
taient plus q ue Messieurs. Ils se donnaient
ce titre les uns aux autres, en se parlant
ou en s'écrivant. Leurs titres féodaux
1 étaient extérieurement suscrits sur l'a-
dresse, revêtue du cachet armorié; à
l'intérieur on ne lisait que Monsieur. Il
se faisait une sorte de nivellement au tour
do la royauté envahissante, mais d'au-
tant plus isolée, au sommet de la hiérar-
chie sociale.
PourLant,jqsqu'à la révolution, le titre
monsieur ne dépassa pas les limites do
la bourgeoisie urbaine, riche ou lettrée.
Il resta étroitement circonscrit parmi
l'élite cultivée de la nation.
Le mot italien sigT»©/*et l'espagnol senor
sont, encore plus directement que le
français tire, sieur et seigneur dérivés
t du latin senior. Ils ont donc ce même
sens d'aîné, d'ancien, de vieux. En par-
, ' lant à des jeunes gens, les Italiens ont la
ressource d'employer leur diminutif
! signormo qui signifie petit atteiem ou
jeune vieux, c'est absurde.
Il n'est pas douteux que la vulgarisa-
tion en France du mot monsieur, n'ait
été due surtout à l'influence de nos deux
reines do la famille de Médicis. Elles ont
italianisé la cour, qui fut imitée par la
ville èt ceUe-ci par la province.
Chez les Allemands, Herr slftnifie le
nofcle, le chef, le maître. Cest l'équiva-
lent du français seigneur, dans son sens
féodal. Ce n'est pas la traduction du latin
senior, mais du dominus, maître de lUi-
son, ou peat-etre de pÀtnmus, chef de
! dan, protecteur et défenseur de ta fias,
de sa clientèle.
Les Anglais ont pri» du normand notre
mot dm, dont ils ont fait ér (prononces
jswMoiut w p»pml e'eet 118 titre
de noblesse que tout Je monde n'a ma
le droit de Pr -u4m, Itee emrioyé ...,
c'est n« siwple tume 4e p^H5j»{ya-
tofue % notre sa tout
la parotO. On «pelle .... cie .... jev-
nm jr«ns m fEmml 1m mmi lM-
dis qu'on appelle les bourgeois de leur
nom précédé du titre de mister, équiva-
lent de maître. Mais si on leur écrit, il
est d'usage d'ajouter sur l'adresse le
titre (Yesquire, qui signifiait à l'origine
écuyer, et qui le fait monter au rang de
gentlemen.
C'est par ce mot Gentleman que les
Anglais ont traduit textuellement notre
mot gentilhomme. Meis ce terme a eu
pour eux un sens plus indéterminé que
chez nous. Il n'implique aucun degré de
noblesse héréditaire, mais s'applique à
tout homme bien élevé, de bonne com-
pagnie et, comme tel, faisant partie de
la gentry.
fi faut traduire par Seigneur le titre de
Lord qui est héréditaire et analogue au
titre de sénateur romain. Mylord est
donc l'équivalent de Monseigneur.
Les actes de procédure conservaient
pourtant les anciennes distinctions. Les
titres de noblesse s'y étalaient tout au
long. Mais pour les robins de la chicane,
tout bourgeois n'était que le sieur un tel
et l'usage s'en est perpétué. Quant aux
manants ou vilains, ils étaient appelés
de leur nom tout court; encore tous n'en
avaient-ils pas.
Ollmd les registres de l'état-civil furent
institués par la Révolution, il ae trouva
dans les villages que la majorité des
Français n'ivaient pas de nom de famille.
Il fallut leur en Inventer. Le hasard pré-
sida à cette distribution. Beaucoup de
gens furent nommés du nom de leur pro-
fession . De IJ4 le nombre considérable
de familles qui s'appellent Boulancer,
Charpentier, Fafrre ou Serrurier. Tel fut
nommé du nom de son champ, tel autre
de celui du bordage dont il était fermier,
ou dans lequel il était né comme domes-
tique. D'autres reçurent le nom de leurs
terre ou de 1ocaIiI6I, eurent des dési-
vWages ou hameau natal. Ce tarent
les mieux partagés; car ces noms de
nenoes aristeeranques qui n'étaient pas
les noms de métiaM. Bien des gens ont
trouvé moyen de joindre à çdi nom# la
particule qui n'auraient pu le taire s lis
s'étaient nommés CbwronouTisserind.
La destinéedeeertatoes tojNi tenu à
ee fait qu'un «naire ou un U#oiat a hap-
tistf d ua nom pins 08 moins uobDesa-
We un arrière Emnd-pèro W* ftmss-ià
s'était appelé Pierrot ou Jeannot, et ne
savaitque mettre sa croix sur les actes
de naissance de ses enfants, devenus des
messieurs.
Quand les législateurs de l'Assembléo
Constituante curent aboli en France, les
titres de noblesse et les distinctions do
classe, les législateurs de la rue ou dee
clubs, jacobins ou montagnards, décrus
tarent a leur tour qu'on devait renonce-
au titre féodal de sire, de sieur, ou mèmr
de Monsieur, dérivés de celui scif/ncur.
C'était logique. Ce titre, par son étymo-
logie, donné à des jeunes gens ayant lo
sens d'ancien, d'aîné, de vieux, était
absolument ridicule; et avec son sens
féodal de suzerain il était également dé-
placé entre des égaux qui n'étaient plus
ni seigneurs ni suzerains de personne.
Au point de devtiedu droitetdela lofique,
comme au point de vue du simple bon
sens, le terme de monsieur est un contre
sens. Appeler messieurs des jeunes gens
de vingt ans, et même des éphébes im-
berbes, cela prête à rire à tous ceux qui
savent les ongines de la langue.
La génération révolutionnaire avait
donc absolument raison de vouloir effa-
cer de nos mœurs un usage devenu illo-
gique par son extension abusive, et qui
n'avait de sens que dans une société
aristocratique. Dans une démocratie, il
devient un contre-sens ridicule.
Nos pères avaient raison de revenir
aux usages des Grecs et des Latins, nos
maîtres en politesse urbaine. Ils avaient
raison de «onlofr appeler chacun par son
nom propre, ou w moins par ce nom
joint an nom de famille, sans ces péri-
phrases honorifiques qui, une fois gêné-
ralisées, deviennent de pures chinoise-
ries; comme ils avaient raison de vou-
loir revenir au tutoiement, c'est-à-dire à
la logique du bappt Ile avaient raison
aussi de soutenir que le titre le plus
digne à donner A des hommes libres est
celui de dtafem uni est ttffirmation du
droit égal pour tous, soit qu'on rem-
ploie en partant m peuple MsemMe.
soit qu'on le donne smlndividus dont
onifaerele nom "."..
CLÉMENCE ROYER.
. (Xj^twre),
Celle nouvelle qui noasvieirt de Braxslles
tal-elle vraie T Pourquoi pasî
La reine de midâ" vin*»}Lî4^
nommée par I* roi Lèooold B. eoleueUe de
la première lésion de 1& garde civique de
Bruselles.
0
Wap»s plusieurs journaux italiens, le
Pape Léon XiH ewmttdéeM* te coDférer,
cette Annéo, ta Rose d or à la princesse Oi-
sèle de Bavière.
L* police d'Oporto a arrêté Mme Sorgue,
socialiste..
Accompagnée par les sodatoto» , porto-,
gais, Mrao Soreuc se proposait de faire une
conférence à Oporto.
Elle avait été expulsée du congres de la
presse, après avoir lanoê, daxM un
url verre à la figure du journaliste Msga-
liaes Lima, qui lui avait reproché d être
moins socialiste qu'elle ne le croyait.
--0 --
L'inhiunation de la reine de Danemark
à la cathédrale aum lieu le 15 octobre.
L'Empereur de Russie assistera à lacéré
TOonie. Il viendra de Liban à teMbegws
sur le vacht la PoUarmtin-Zjmzda. 11 arti-
ver» vendredi et séjournera pendant ue
semaine au cbiteau de BeMStoff.
UN PEU PARTOUT
Le train ramenant à Paris le corps de
M'ne Carnot est arrivé dimanche soir a la
aarc de Lyon à 6 h. 30. MM. Sadi Carnot,
capitaine d'infanterie, Ernest Carnot et les
mniittire* de la famille avaient seuls pris
place dans le train.
Un fourgon des pompes fuoèbres suivi
d'une voiture dans laquelle se trouvaient
NM. Pa»li et E rnest Carnot, a transporte le I
cercueil jusqu'à l'église de la Madeleine où
il est arrivé à 7 h.
M. l'abbé llertzog, 13.....cure de la Matlelerae,
a reçu le corps et a prononcé les prières
d'usage, puis le cercueil a été descendu
dans le caveau et déposé sur un catafalque
entouré de 4 lampaderes.
Aucune décoration extérieure n'a été
donnée au caveau et les parents et mem-
bres de la famille sont seules autorisés à le
visiter.
Les nombreuses couronnes envoyées en
hommage à la défunte ne seront portées à
l'église que dam» la soirée de demainou plus
probablement mercredi matin.
Les obsèques seront simples, MM. Carnot
n'ayant pas voulu contrevenir aux goûts si
marqués de leur mère pour le: simplicité.
—o—
Le Groupe do la Solidarité des femmes,
-réunion extraordinaire le mercredi 5 octo-
bre, à 2 heures précises, salle de la mairie
du VI. arrondissement, place St-Solpioc.
Ordre du tour : Reprise des travaux;
— lecture du catéchisme féministe par la
• secrétaire Mme Kauffmann ; organisation
d'une commission du travail ; propositions
diverses.
—o—
On annonce la mort, à rAge de cinquante-
deux ans, de M. Lambrecht, secrétaire-
bibliothécaire de l'Ecole des langues orien-
tales rivantes.
LA DAME D. VOILÉE.
AUTOUR DE LA REVISION
Le Matin a complété hier le récit de
YOôserver, en publiant les révélations de
M. Ilowland Strong, correspondant du
journal anglais.
... J'ai LlÚjà. Mlcont\: la façon dont le bordereau
fut ciril et par qui. Mais il y a un détail intercs-
gnut que je n'ai vu nulle part : M. [,:stertiitzy m a
ranih-lè que les rei>r»»due lions de ce document
«lui ont paru dnus lus journaux n ont pas eus
faites d'après l'original. Ktant donnée la tenu:Ui
du papier pelure sur lequel il était trace, on ne
pouvait le calquer, car les lettres se voyaient à
travers le papier et occasionnaient DM confu-
sion de traits. Par suite, il y a deux ou trois
mots dans les dernières lignes du document
copié qui ne sont pas du tout de la main d bs-
tcrhazy. Otto copie calquée fut invariablement
produite devant les tribunaux partout où Jo
bonlereau fut soumis comme témoignage.
C'est ainsi qu'au conseil de guerre devant le-
quel tëaterhaxy a comparu pour la première fois
J ancien connu:!niant, quand on lui montra ce
document — le calque — put lépoodro en toute
vérité qu'il n'en était pas 1 auteur.
* Les complicités
En dehors de la paternité du bordereau, la
seconde déclaration essentielle que M. Ester-
bazy m'a faite est de ta plus grande importance.
FAI admettant qu'il ait fabrique certains ducu-
ments, il y a,dit-il, d'autres j»orsonnv:8, occupant
1rs situations les plus élevées, qui s en sont
150r\' U .."81 clair qiiS ces déclarations sur ce sujet
ne peuvent être reproduites que sous les plus
expretil5ès réserves..
Û'aprt'a lui, la décision prise par M. „ Bertulusa
au sujet des télégrammes atones a Speranza -
et . Blanche g était parfaitement juste et bien
fondée..
» Les deux télégrammes « Spcranza » et
• Manche .. nous dit M. Esterhazy, étaient des
faux voulus. Ils furent faits snr l'ordre direct
du colonel du lJaty de Clam, agissant au nom
de n;(at.major, dont le but était d avoir un
ii'rtruinent en mains pour s'en servir contre le
colonel Picquart si c était nécessaire, et auss
"J * . t > . ii
Mue de potiee — fer m SHBSuSSjfcgji if -
fieSSSËua "il te»&^Lsjr^^d^
0-
du*
nii
M^raSumnidn ooloBp^iu^P
èm arriv4«Mveê«l^v *
UL MeÉncttaeMitleMlHlAHlrtisM
àMÉkairifii3e ses dMsâetlwae: «urdre de"
fabriquer ces documente, disait-Il, n'aurait ja-
mais pu être donné sans avoir été approuvé par
une très haute autorité militaire. la fait da
contresigner en quelque sorte cet ordre ooustt-
t- ë'aprts le là fwmsis», Yusag*dê pnuefsk).
M. Bertulus n'avait pas le moindre doute quant
à l'auteur véritable cr. ces faux. et détail tm H1d
atd uètt ému teesef
. Ce juge décida que je serais poursuivi et
jugé. Un appel fut fait... moi d«v»at la tim-
bre des mises en accusation, et alors 88 passa le
fait extraordinaire suivant :
• LtnNtMMt ntfnMérielle s'easrçajMorpir-
au
fineompéteeeede M. Bertnlus ea ee qui concer-
nan cet officier fut prononcée parla chambre des
miàcs en accusation.
L'adoa goaveraemiaBtale
. Dans le cours ordinaire des ehmu..Imiffl'ack
appel est fait d'un ordre de poursuivre,le prison-
nier soumet un rapport à la chambra des mises
en accusation. Mon rapport était prêt, et,cepen-
dant, le erohrieat-vous? les juges refusèrent de
l'écouter, et je fus remis en hberté suis qu'on
oùt pris connaissance des explications que j'au-
rais pu être disposé h faire.
• C'est là oe qu'un ministre a appelé a faire
sentir l'action gouvernementale ».
M. Esterhazy, poursuit M. S troog. m'a déclaré
que, depuis le début de l'affaire, 1 Etat-major lui
avait fourni des informations secrètes alir. qu'il
pût s'en servir pour M défense personnelle.
- Ainsi, in'afllrma-t-iJ, lorsquo le général de
Peilieux pourswvailsa première enquête sur ma
conduite, avant mon procès devant le conseil de
guerre, de je recevais tous les jours de M. du Paty
e Clam une note écrite disant sur quel sujet les
différents témoins seraient examines et me don-
nant les indications nécessaires pour que mes
réponses ne fussent pas en contra diction avec
les leurs. »
M. Kslerhary prétendait que, s'il avait été
chassé de l'armée, c'était parce que l'Etat-major
ne voulait pas avouer à M, Cavaignac les faits
vrais de la situation. M. Cavaignac était résolu à
se débarrasser d'ltstarhazy. Il voulait qu'il fût
- tué moralement - «pour se servir delà pro-
rre expression du ministre It. qu'on le jetât de
lOrs comme on jette du lest, pour employer celle
du chef de cabinet du ministre, le général Ro-
Ce fut cette manière d'agir que rex-comman-
dant ne voulut pas endurer,et il était déterminé.
s'il était mis de côté de cette cavalière façon. à
en entraîner d'autres dans sa propre chute. L&
colonel Henry, après avoir été forcé de confes-
ser son faux et en se trouvant abandonné à son
sort, s était suicidé. M. Esterhazv était une autre
nature. C'était un combatif, un homme de lutte,
et il voulait vendre sa vie et sa réputntion chè-
rement.
L' « homme de l'État-major »
« Pendant des années, m'a dit M. E.sterhazy,
j'ai été ihomme de l'Etat-major, et personne ne
connaît le secret de l'affaire Dreyfus aussi bien
que moi. C'est par ces mots : « Je suis l'homme
de Vgtt.,t-triajor » que j'ai commencé mon rap-
port écrit aux juges du dernier conseil d'en-
quête, et j'en dis alors assez pour rendre mes
jujçetf très disposés à !n*.tc'tuitt.cr ; mais la pres-
sion ministérielle était trop forte. a
Telles sont les lignes générales des révélations
que de M. Esterhazy m'avait, à l'origine, proposé
e faire dans mon journal, pour ensuite, les
relater en détail daRS un livre. Depuis lors, M.
Esterhazy a légèrement modifié ses pla-is. Sa
première idée était de publier ses allégations au
sujet de La complicité de l'Etat-major dans les ■
faux « Speranza » et « Blanchi! » le premier
jour ,le la réunion des Chambres, c'est-à-dire
vers le t8 octobre, de façon à provoquer, tout
au moins, une crise ministérielle.
La paternité du bordereau devait être réservée,
jusqu'au dernier monvnl, commo « gros pé-
tard It, pour employer sa propre phrase, p»;turd
destiné à faire »aut*r la Pruioe ju-;tlu aux
nues. 11 entretenait môme l'idée itig-imiouso et
quelque peu diabolique de le faire éclater lo
lendemain du second procès de Dreyfus, où
l'effet serait étourdissant, surtout si le miséra-
ble captif de l1Ie du Diable devait être recon-
danine, comme t' commandant pensait qu'il
pourrait bien l'être.
Palàaal;luDs
M. -André VCI'voort,directeur du Jour,
s'étant trouvé offensé par un entrefilet
pa.ru hier dans Y Aiti-ore, a envoyé hier
matin deux de ses amis MM. Daniel
Clonlicr et Augustin Thierry à M. de
Pressensé, l'auteur de cette note.
Les témoins de M Vervoor~ se sont
présentés à ii heures dans les bureaux
du Temps et ont immédiatement été in-
troduits auprès de M. de presscnsé qui,
à l'issue de cette entrevue, leur aadressé
la lettre suivantes :
Messieurs, ..
Je n'ai nullement l'intention de constituer des
témoins pour rendre raison à M. André Ver-
voort d'un entreliiot paru dans l'Aurore, bwr
matin, sous ma signature et reproduit par 1 A-
gence Nationale. Ju me suis contenté dop|Hjs»'r
— dans la stricte limite cie mon droit — un dé-
menti au récit mensonger publié par le Jour,
journal de M. Vervoort. J'ai rétabli les faits et
j'ai demandé au publie de choisir entre ma pa-
~r—t-—'
-
Vervoort, 4oa& le toeteai S>3^^^^nSi
L%mofiftit
wmml, aBrimUe bml »H| m
7oyit l&liMre wbmto :
Si niiiilpi eompte des tiHÈêtHÈÊÊ^m terni
iwodeits Wer UIX abords de la
certains journaux prêtent à moa |||jHp eris
.^tfiJL^n'a jaa^^Aréa.t
crié : « 55e Pioquart 1 RevSon I'>»!!3RBlI^
ment : « A bu l'armée / A bas la RwBpJJbas
la pet" 1 *, mat laveieioa dtt(Areta|p|pupar-
Mon fils a te respect de l'armée et Émmmr de
ses MM. et. c'est véritablement krtwfclÉ InJiiHre
1 que aemt attribuer d MtMt me" peeeee.
Agre
ùble Tin it
~l
-
M. ûm -*t'y. ie daa
t D'après la Capitale, M. du Pèty de
Clam est descenQu,jen dedans un hôtel
de Rome sous le nom de comte Marcois
de Beel..
U s'est entretenu avec quelques amis
et avec un journaliste français, et est re-
parti samedi en disant qu'il allait à Na-
{4es ; mais il a pris le train pour la Haute-
UaIMt.
Au domicile de M. du Paty, on déclare
que l'ami d'Esterhazy se trouve actuelle-
ment à Brest, et que sa correspondance
lui est adressée dans cette ville. En con-
séquence, M. du Paty de Clam a passé
par la Bretagne pour se rendre en Italie.
L'instruction que la Cour de cassation
fait actuellement sur « son oeuvre » l'a
sans doute décidé à s'éloigner mlJmenta-
nément.
MARINA POLONSKY
Mme Marina Polonsky vient de succom-
ber'aux'suites d'une longue et douloureuse
rriaMic. Avec elle disparait une des plus
grandes et des plus nobles figures du parti
révolutionnaire russe.
Elle s'était réfugiée à Paris,il y a environ
quinze ans, à la suite d'une condamnation
dont elle fat l'objet pour avoir pris part à
un complot nihiliste. Elle était un des der-
niers membres survivants du glorieux et
terrible comité exécutif de « La volonté du
peuplo Il (Narodna'ia Volia) dont les vaillants
efforts et l'énergique résistance firent pen-
dant longtemps l'admiration du monde en-
tier. Pendant do longues années LaNaTod-
nata Volia tint en échec toutes les forces de
l'aristocratie russe et déconcerta les recher-
ches de la police.
Mme Marina Polonsky a été enterrée hier
sans pompes et sans cérémonie ; aucun dis-
cours n'a été prononcé sur sa tombe et
quelques amis seulement ont suivi son cer-
cueil.
Gela résultait d'ailleursde volontés expri-
mées par elle dans une lettre que nous
pubi ions ici, et qui nous a été communiquée
par M. La.vro!T qui fut un grand ami de la
défunte.
Désireuse de laisser à mes amis le souvenir
d'une personne et non, d'un cadavre, et croyant
en même temps que les soi-disant a derniers
honneurs » (coutume absurde), qu'ils se croi-
ront obligés de rendre à mon corps ne feront
qu aviver inutilement la douleur qu'ils éprou-
veront à ma mort, je les prie do laisser aux
étrangers lo soin de s'occuper do ma dépouille
et de ne se rendre ni à mon lit de mon, ni à
mon enterrement. Celui-ci doit du reste ôtre
des plus simples : convoi de la dernière classe,
fosso commune. J'aimerais encore mieux être
incinérée, à condition que mes cendres soient
jetées, dispersées, et non amassées et gardées
par qui que ce soit. Pas de discours, pu de cou-
ronnes, pas de lettres de faire part, pas de bio-
graphie, cela va sans dire. Dols-je ajouter que
mes obsfrjucn doivent être civiles t
Fait et signé de ma main à Paris le 21 juin
1898.
MARINA POLONSKY.
P. S. — Après ma mort, on ne trouvera dans
ma chambre que quelque linge et quelques
robes que je prierais de distribuer aux gardes-
malarlcs qui m'ont plus ou moins soignée et qui
se trouveront encore dans l'établissement au
moment de ma mort. Quant aux manuscrits et
aux. lettres, depuis longtemps déjà, je les mets
en lieu sûr, pour ne pas donner au corsât russe
(cp, valet que je déteste presque autant qoe son
mattre). le plaisir de s en emparer après ma
mort. J'espère que monsieur le consul et tous
les agents me sauront gré d'avoir pris cette pré-
caution, qui leur épargnera la honte d'an nou-
veau procès : ils out bien assez, jo suppose, de
l'affaire Sawitzky et du procès que nous leur
avons intenté et qui a attiré au gouvernement
russe et à ses représentants en France, le mé-
pris de tous les honnêtes gens, sans compter les
- dommages-intérêts » (ou « les frais », je ne
sais pas au juste) auxquels ils sont con-
damnes.
M. P.
^llpj liiimai tUée vol? p. Lavret Mpt» <
torr,
trioè 4*la * iïSS? ï. LavrofT «eus tend
cordialement la mata eàapvae tm bon sou •
ixfe»* a'Mwuse de ne ....i.r satisfaire
wtÈm Uritt Lisez la liIDN. nous dit-il et
fouayemarque Je ne foi» parter, o'eet la
formelle de m obère morte et
sengMi
niéai demeure. Je sais le doyen des réfu-
giés rttsaes à Paria. j'ai sotxaute-qiiinze ans
#awM, et d'ordiMinau MifM l'un d'entre
mm fg«rt, c'est mm qui
Ptmr Marina Polonsky j'ai dû me taire
voulant absolument me oonrormer au
vesu qu'elle a émis,et maimenam enoere le
ne puis, sans allorù rencontre de ce qu'ene
a désiré. vous donner aucun renseignement
sar _110 qui fut le eourege, la bonté et
l'intelligence même et à la mémoire de la-
quelle je voudrais voir élever un impéris-
sable monument.
Rien ne peut exprimer quelle fut l'éner-
gie de cette femme qui contribua peur une
grande part au -dàvelq*emeut du fâxaiai*-
me en Russie. Cest par miracle quelle
échappa à la rigueur îles lois et qu eue
n'eut point à subir la peine des travaux
forcés comme beaucoup de ses compagnes
et cie ses imitatrices.
Et à ce propos, M. Larvoff très ému nous
montre des essuie-mains brodés qui lui
ont été envoyés du fond de la Sibérie par
de malheureuses femmes qui subissent
d'atroces souffrances sous le climat le plus
inclément du monde pour avoir trop aimé
la justice et la liberté.
Kn France, Mme Marina Polonsky s'est
beaucoup occupée de la question des syndi-
cats ouvriers et elle fut en rapport avec un
granJ nombre de nos députés socialistes,
notamment avec M. Vaillant qui fut un de
ses trèi fidèles Mnis. Faisant abstraction de
sa personne, ayant abandonné jusqu'à son
véritable nom, cette femme grande et sim-
ple a consacré toute sa vie à la révolution,
A Paris, sa maison était ouverte à tous les
réfutés russes et elle combattit la cause
qu'elle défendait jusqu'au moment où la
maladie vint la terrasser. Après deux an-
nées de grandes soutrra.ncos.elle est entrée
dans le repos de la mort emportant avec
die les témoignages d'admiration, de sym-
fUl:tip et de respoct de tous ceux qui l ont
connue ou approchée.
JEANNE BRÉMONTIER.
M. de Boisundré, dans la Libre Parole,
rectifie un passage très accessoire du
récit que j'at fait dans la Fronde de mon
récent voyage à Londres.
Si M. de Boisandré tenait absolument
à rectifier quelque chose, il me semble
qu'il aurait dû commencer par s'occuper
de ce qui le concerne personnellement.
Il y a quelques jours,un de nos confrères
du soir écrivait au sujet de son duel
avec M. de Dion :
JI. de Boisandré s'attribua même quel-
ques records de vitesse qui sont restés
légendaires.
S'il y avait urgence à rectifier, c'était
hip.n dans ce MtS-ià.
J. B.
CHOSES DE L'ENSEIGNEMENT
Le Congrès de Rennes
Nous couchons sur nos positions; mais s'il est
vrai que la gloire se mesure au péril affronté,
nous avons droit à Cadmiration des foules. Ces
pauvres délégués cantonaux ont, en effet, une
si mauvaise réputation, que la majorité de l'as-
semblée pléniere a failli les supprimer, et c'en
eût été fait des déléguées qui nous tiennent si
fort au cœur.
Tout est bien qui finit bien ; après une agita-
tion qui dégénérait presque en brouhaha notre
proposition a été volée. Quand passera-t-elle
dans la loi ?
A quelle époque toutes celles qui ont été dis-
cutées et adoptées dans les quatre autres com-
missions y seront-elles de même inscrites ?
Chi lo sa ! Mais ne fût-ce que pour remuer en-
semble dos idées, les congrès sont excellents.
Or c'est à tlota que les idées ont coulé ces jours-
ci; il y en a tant que je renonce à mettre dès
maintenant toutes ces richesses en ordre. Dans
quelques jours, je donnerai une liste exacte de
tous les résultats du Congrès et je me borne en
ce moment à en tracer une ébauche aussi fidèle
que possible.
La matinée a été très chaude au sein de la
commission des tXBUZ; c'était la liberté de l'ensei-
gnement qui était sur le tapis. Or il est à remar-
quer que cette « liberté de renseignement
n'existe que pour l'e» saignement prive contre
l'enseignement de l'Etat. Et ce n'est point ici un
paradoxe. En effet, tout instituteur attaché & une
classe d'école pubiiquo doit avoir le brevet su-
périeur; blique tout instituteur dirigeant une école pu-
lique doit être pourvu en outre du certificat
d'aptitude-pédagogique, alors que dans les écoles
privées le brevet élémentaire est la règle — trop
souvent violée — le brevet supérieur est l'excep-
tion, et que le certificat d'aptitude pédagogique
est ignoré (j'en appelle au témoignage de l'au-
teur des Religieuses enseignantes.).
Dans l'enseignement secondaire publio, le bac-
calauréat ne suffit plus pour un simple répÓli-
teur; la licence est reléguée dans les collèges
communaux ou du moins ne donne pas le titre
V"
t
m
9
« L8 ilMNMMI a©GOtc» nBBMvros jvnvwv
118 iasUtuiewi'P employés 1Iaa8 008.......;
tes directeurs et les frotefliearo des établisse-
mu
aux
tiens que 1. directeurs instituteurs et
seuFS des écoles primaires el des- établissements
d'enseignement secondaire pabUes ».
Un autre vœu mérite dètre immédiatement
signalé.
. Toutes les sociétés d'instruction populaires
s'efforceront d'organiser des conférences de pro- 1
paxande accessibles au grand publie, poarcom-
DIéIe. l'enseignement moral et civhpie des et .
toyeits, et pour mettre en lainière les questions if
d'aetualité ».
La hMBÎèM! Elle me pan1t être oMh&e sons de
gros nuages dans le pays que j habite dépota qua-
tre jours ; et oequi me donne la mesure de 1 obs
cunté régoaDte,o'est que nous attendions M.Léon
Bourgeois qut,avant d'être ministre de l'instruc-
tion pttbliqueétaitprésident de la Ligue,qï son Ame
vivante et agissante. Or, nous ne le voyons pas
arriver, et est même assez probable qu'il ne
viendra pas, parce que sa présence scandali-
serait la majeure partie de la population de
Rennes. Car -on He sait trop comment dire eela
honnêtement — M. Bourgeois est accusé d'être
révisionniste I
Mais... 06 faisons point de politique et trans-
crivons un vœu de la commission d'extension
universitaire :
a Il est désirable que la solidarité des profes-
seurs des trois ordres s'affirme de plus en plus
dans leur libre collaboration à l'œuvre de l'édu-
cahon populaire, à laquelle seront admis et
appelés les étudiants de tous ordres et les amis
de rUniversite. a ,, ...
(Ce vœu concerne l'éducation des adolescents
l et des adultes des deux sexes), j'ai souligné les
deux derniors mots, et j'ajoute que jamais dans
aucun congrès — sauf les congrès féministes,
bien entendu — en n'avait eu, comme dans
celui-ci, le souci d'assooier la femme à tout ce
que l'on demandait pour l'homme.
Et les fêtes continuent, alternant avec les
séances et les conférences. Hier soir, conférence
culinaire de M. Driessens, qui nous a révélé
tous les secrets de la Soie normande, ce soir,
retraite aux flambeaux.
Demain... mais : à demain.
Les questions posées, discutées et votées au
Congrès de tiennes sout si intéressantes et si
nombreuses que jo n'ai pas la prétention môme
de les effleurer toutes dans ces lettres à toute
vapeur. Je me borne pour l'instant, à signaler
soit celles qui ont le plus intéressé les capita-
listes, soit celles qui mo paraissent intéresser
spécialement notre journal.
Le rapport de Mlle Saffroy, membre du
Conseil supérieur de l'Instruction publique et
inspectrice des écoles primaires de Paris est à
sa place, ici plus encore que partout ailleurs. Il
s'agit du patronage des jeunes filles et des asso-
cialionl d'anciennes élèves.
Les associations d'anciennes élèves, dit
Mlle Saffroy, sont très goûtées et déjà très
répandues. C'est, en effet, la forme de groupe-
ment qui se prête le mieux à une organisation
rapide, qui donne des résultats immédiatement
appréciables -...
« Bien des œuvres solliciteront le concours des
associations de jeunes gens, mais il n'en est pas
de plus propre à intéresser 10s associations de
jeunes (Illes que celle dos patronages ».
Et Mlle Sallroy définit « association » et « pa-
tronage Il l'une s'adressant aux jeunes Il lies
ayant dépassé l'âge scolaire, l'autre,les groupant
au moins dès l'âge de 9 ans. L'« association re-
pose sur la mise eu commun de forces à peu près
égales; le patronage est avant tout œuvre de
sauvegarde et de protection. » Et en terminant
son rapport Aille Saffroy pose les cinq questions
suivantes qui pourraient donner lieu dans la
Fronde à un échange de communications inté-
ressantes :
t. Est-il possible, est-il désirable que les as-
sociations de jeunes gens et do jeunes tilles dont
la prospérité est maintenant assurée, s'attachent
à des œuvres sociales ?
2° Quelle peut être l'inOuenco des associations
des jeunes tilles sur la création et la prospérité
des patronages ? i
3* Dans quelle mesure l'action des patronages
peut-elle s'étendre aux mères de famille ?
4, De la création d'associations de mères de
famille?
5" De la création, pour les jeunes fillest d'éco-
les pratiques d'agriculture ? ,
Le Congrès a répondu affirmativement a la
première ; il est d'ailleurs un fait acquis que des
associations de jeunes filles s'occupent de vêtir
des enfants indigents, et de coopérer à des
œuvres philanthropiques.
Il e engagé les associations de jeunes fllles q,
donner leur temps, leur activité, leur galté aux
réunions hebdomadaires des patronages.
Sur la troisième question, M. Priou, président
de la Société d'instruction populaire de tiennes
a dit que le concours des mères de famille a
permis à la Société de pratiquer avec un grand
succès la co-instruction. Jeunes gens et jeunes
filles reçoivent lo même enseignemeut, assistent
aux mêmes cours, et les mères de famille, assi-
ses sur les mêmes bancs. sont à la fois les sur-
veillantes et les condisciples de leurs filles. Et
M. Priou estime qu'on peut demander à de telles
femmes d'être les fondatrices do groupes d'A-
mies de l'école et d'intéresser spécialement ces
groupes à la protection des jeunes JUles orphe-
lines.
La quatrième question a été notée sans ob-
servation; la cinquième a été au contraire très
disculéel
L'idée d'enseigner l'agriculture à la femme
^ - ^
Crisnadimi me jeme Ah dont les parents
cæ::: ' . "".P"""'" .. OTOTM «Mt lotorêtà
telle au viSge pattr «Kgttar aa vie. pullqu'..
village Il n'y a auras moyen d'exercer son aeti-
vitéTPour elle, a n'y a que l'abandon du peut
coin natal ;* vis ea loin
la domesticiti» ftvomt qaeetet deuloureux et
dangereux.
Jo .
Vin* arrondissement de Paris, président do
T Association de la PMSSS de lqpdûnetnent,sur sur
le rôle de ta Presse dans Fédueation populaire, a
été très applaudi. Après avoir fait le tableau des
pMgfèe aeoesipMe ter les Journaux spéciaux de
pédagogie qui ont attendant une influence res-
tntte an jMfeUe ....-nut, il ajoute :
« La pédagogie a fait son entrée définitive
dans les gmdes, revues littéraires et scienti-
fiques et dans les grands journaux politiques
quotidiens. , ,
La duiabue de renseignement, qoe le lec-
teur retrouve périodiquement sous une forme
0ns familière dans spa journal politique, met à
aapokèi . III"'" .I1IIJ" n'eat pm eté cher-
oiwr dans bu organes spéciaux rédigés surtout
pour des profedfonnels. Le grand publie est
ainsi tenu au courant des recherches, il profite
des découvertes faites par des pédagogues, et la
pédagogie cesse d'être une science fermée. in-
terdite aux profanes.
Grâce iL cette diffusion, à cette floraison nou-
velle de la Presse de l'Enseignement, les nial-
tres et les maltresses sont mieux renseignés et
se sentent plus soutenus. La confiance pénètre
dans les familles qui s'intéressent davantage aux
travaux de leurs enfants. Les élèves eux-mêmes
sont mieux préparés, leur esprit s'clévo et s'é-
largit au contact dos idées nouvelles qui leur
ont été préalablement appropriées
L'éducation donnée à 1 école ne saurait pro-
duire ses fruits qu'à la dounle condition de trou-
ver dans l'élève un terrain favorable et de s'être
assuré les concours éclairés de la famille.
De même que l'on a su intéresser l'enfant à
ces études par ces n.mjaslnes et ces journaux qui
ont tint frappé notre jeunesse et que nous ne
pouvons relire sans émotion, il est indispensable
d'attacher les parents et de les retenir en les
associant aux efforts que font leurs enfants paar
s'instruire.
On remarque qu'à mesure que l'Etat et les
institutions d'initiative privée s'évertuent davan-
tage pour la formation du citoyen, la tendance
de beaucoup de familles est de se désintéresser
d'une œuvre dont on se charge si volontiers à
leur lieu et place et qui reste néanmoins le
premier de leurs devoirs: le devoir primordial
des pères et mères, l'éducation de l'enfant par
laquelle ils refont et complètent leur propre
éducation. 11 est nécessaire, à l'heure actticlit!,
de rappeler qu'il y a là un devoir individuel et
par dessus tout un intérêt social. »
Enfin, l'auteur de la communication fait con-
naître au congrès l'association qu'il préside :
L'association des membres do la Presse de
l'Enseignement se propose, en mémo temps
qu'elle assurera la protection des intérêts pro-
fessionnels de ses membres, d'étudier avec eux,
de discuter les solutions à proposer au Parle-
ment, aux pouvoirs publics et à l'opinion publi-
que, et de se mettre d'accord sur lets campagnes
& entretenir en vue de réformes nouvelles.
Qui peut douter que la force de la presse de
l'enseignement sera plus grande, son action plus
certaine, qu'ello sera plus indépendante et plus
respectée lorsque l'union des bons vouloirs et des
dévouements aura été ainsi réalisée, lorsqu'une
direction librement ressenti o lui aura été impri-
mée.
L'accueil fait à cette idée a été en quelque
sorte unanime. Immédiatement les organes de
la Presse Pédagogique ainsi que nombre des
chronitlucurs de l'Enseignement, appartenant à
la rédaction des journaux politiques et les ré-
dacteurs de bulletins spéciaux out adhéré à ses
statuts. Les patrons sont venus de toute part et
de haut. Citons avec les noms de Dcrlhclot,
Léon Bourgeois, Leygucs et Poincaré, ceux do
Gréard, Buisson, Ltgouvé, Mézières, Boutmy,
llréal, Fouillé, Lavisse, §arccy, Mme Kergo-
mard et Mlle Malmanche.
L'Association des membres de la Presse do
l'Enseignement a, dès son premier exercice,
donné des gages. Elle a proposé à la Chambre
des députés un texte de loi sur la responsabilité
des instituteurs. Elle a mis à l'étude fa que t on
des garanties qui doivent être assurées au per-
sonnel ( joignant en cas de déplacement d'or-
llce, et proposé une solution. En Un elle a pré-
pare l'organisation d'un Congrès de la Presfso
de l'Ens ignement pour 1900, et présente à son
examen les questions suivantes :
1* Râle du la Presse de l'Enseignement dans
tous les pays, ses moyens d'action sur les pou-
voirs publics et l'opinion;
2' Organisation d'un bureau international de
renseignements sur les questions d'instruction
et d'éducation ;
3" Action de la Presse de l'Enseignement sur
l'éducation populaire;
4, Rapports à établir par son intermédiaire
entre les divers ordres d enseignement;
5' Moyens à employer pour associer les fa-
milles à l'œuvre de l'enseignement et de l'édu-
cation.
Elle prépare pour 1900 la solution pratique de
ces questions.
J'arrête ici, non pas la discussion des fJUrs-
tions posées au Congrès, mais le compte rendu
quotidien de nos travaux; car nous avons Uni.
Aujourd'hui, séance solennelle de clôture sous
la présidence de M. Bayet, directeur de rensei-
gnement primaire. remplaçant M. L. Bourgeois.
Grand et légitime succès. Distribution de tuh:m
violet, car... il faut bien que le commerce lIlar-
che. Banquet à la mairie (j'ai décidé plusieurs
femmes à y venir et j'ai eu raison, car elles y
out tenu leur place à leur satisfaction et surtout
à celle des autres^. Jamais ville ne fit à un Con-
grès un accueil plus emprcssé,plus cordial, plus
brillant.
Il fallait voir hier soir la population suivant la
retraite aux flambeaux 1
PAULINE KERGOMARD
(1)
LA TRIBUNE
4 OCTOBRE 1898
NOS TITRES DE POLITESSE
MONSIEUR, MADAME ET MADEMOISELLE
I
Monsieur
CAM rvbriqme fan* an «M.
ow k ntfel tkange tous les trou jour*.
i II n'est presque pas on de nos mages
mondains qui ne soit absurde par ses
origines, et en contradiction flagrante
avee ce que notre'conscience contempo-
raine considère comme le droit, Injus-
tice et même le simple bon sens. C'est
ce que sir John Lubbock a si bien
nommé des survivances, c'est-à-dire des
usages qui ont pu avoir leur raison d'ôtre
dans un Damé lointain, dans des états
sociaux différente du nôtre, mais qui
jurent, comme des insanités, dans nos
sociétés actuelles.
Tels sont ces titres de politesse, Mon-
sieur, Madame et Mademoiselle dont
nous faisons si grand abus.^.
Ni en Orèce,ni à Rome nous ne voyons
les citoyens se donner entre eux. des
Utres analogues à noire mes Monsieur
(Test par le non» propre qw'ih s'mtef.
Client individuellement. A Rome, Fom-
*r ftumMStM an gewpto nsseyMé en
** eSoyens. Les^recs disaient pedgi4m.
Cie&on appelait les sénateurs pfres coas'
crits, (paires conscripti). En'général, en
lear parlant iodrriàueUenent on les sî>-
•elait semaine* "'''''6
C'est que le Sénat ......, d'apvta l*
tradition, était .-fO'6t à l'etteiiM» des
chefs dee eent premiers élans tsavs ées
«yajèofétTajwtés^StSfs
ai 8,1 M'M-fâfo liualoii dM émm eiMi.
nous Tullus Hostilins. DelèyeeMttdcmé
A tous les sénateurs de paires conserfyti
m tninriti emesMe. Ma* le 4Um de
adeeémz ta 4w m tif&.
volu dans chaque famille patricienne,
non par droit de priniogéniture, mais
par droit de sénescence. Le chef de la
famille, le pairici ou patronus était le
plus âgé de ses membres. Un sénateur
ne pouvait être mineur. Le patriciat ne
pouvait tomber en tutelle. De là le nom
d'anciens, seniores, qui leur était donné
par opposition à j un iores, les cadets, les
jeunes,
C'est du latin senior que l'italien a fait
signor, et l'espagnol senor. C'est ainsi de
ce mot senior que le français a fait sei-
gneur, puis ses dérivés sire, sienr, mes-
sire et, enfin, monsieur..
Le titre de seigneur s'est généralisé à
l'époque féodale, avec le sens de noble,
de suzerain, de maître. Il montait d'étage
1 en étage jusqu'au roi, suzerain des suze-
rains, seigneur des seigneurs.
Cest par le mot seigneur que l'Eglise
a traduit le latin dotnmm, chat ou maî-
tre de maison, (408¡.).
Du latin dominus vint le titre abrégé
don ou primitivement dom qui resta
longtemps employé dans la hiérarchie
ecclésiastique. 11 fut donné aux abbés,
aux moines et clercs enseignants* jus-
qu'à la Renaissance. Ce titre s'est sur-
| tout perpétué dans certains ordres mo-
nastiques, têts que les bénédictins.
En Espagne, le terme abrégé Dm de-
vint dtsfanctif de toute la noblesse et porto
par tout gentilhomme, tout chevalier,
par Don Juan,coatuoe par Don Quichotte.
Au mjMCQÏin, il .n'a pas pa^é,4ans les
autres pays latins quiont adopté 'les
venteaftes degrés deSemtyi
Le tenaedematongtào»* gs?**!*
sens nrittitài d'ancien. M feéfeftsyneByaM
de père. On disait grall4HtN pour grand-
père. Avant d'être dmx 8 a
posseseMrs de ou de
cbI eaies, tell que le sire de ec.,.14
sire de Joinville. le sire de Lavàl, type
~ , original de Barbe-Bfeue.
SniisiLouisXlf M descendit à de iliia-
aise bouJiesia, à des parvenus tels nue
Olivie*4a»Beiiat rime damnée du vleu*
MMtMjHC etTenéeutnar» de sencmanlée.
SMIC9 9iOv -VVHW WfmP
"sSî* -mugi 4e ca. sggnéixron
époque plus récente. Ce fut le titre donné
aux gens de robe, aux bourgeois ano-
blis, aux financiers enrichis; puis aux
bourgeois des villes, aux échevins et
aux autres officiers municipaux, quand
on les désignait à la troisième personne.
En les interpellant, on disait mettirt.
Les officiers judiciaires et gens de ba-
soche étaient appelés maUrts, (du latin
magister). Les clercs ou escholters don-
naient ce titre à leurs professeurs.
C'était aussi le titre des chefs de corps
de métiers, des artisans-patrons qui
avaient brevet de maîtrise.Leurs ouvriers
n'étaient que compagnons ou apprentis.
De nos jours, on revient beaucoup à
l'usage du mot Maître. Non seulement
les étudiants le donnent à leurs protes-
seurs, mais les jeunes politiciens le don-
nent aux chefs des partis auxquels ils
accordent leur confiance. On le donne
aux écrivains, aux artistes, peintres,
sculpteurs ou musiciens qui ont acquis
.de la notoriété.
C'est une appellation plus logique et
plus flatteuse que tous le.3 dérivés du
la'in,seHiol',est moins déplacé,dans notre
état social, que le diminutif de monsei-
gneur, Monsieur.
Les nobles ou gentilshommes furent les
premiers à se donner ce titre entre eux.
Ba valeur honorifique fut longtemps
"Wate. Il fat parfois do naé Qu roi lui-
même, non sans provoquer de sa part
des protestions, Un frère du duc de
Vendôme ayant appelé Monsieur 1" roi
François, celui-ci lui observa que s'il
aoa ataé à lui donner ee w..,
il n'en était pas de même du cadet -Au
XÏftPyflitole Mensteur, sens auto» titre
ou nom, désigna le frère du roi.
Dès le XVI' aiède.1e titre de Mmuidm
était descendu aux gêna de rotejta
disaitHessieurs du a=e= A%&f8S
Il se géAéralm paraît tosge^deliMs,
ffl #&v«W. On dit alors Measiii§*i9
fAfladésMft. B «•'étendit eux mm»m «I
. «kilitaise». On disait Monsieur flewwf
'Efttfn*7MaMfet»r Jeep WatUmmmÊm
'' ^ MeStSSp
00mit dKjNnSS*
mm* deMro.ird5fip
&Kfcfiiu»6tor4,aGwm0 M. rouwflMg»
H'
XVIII. siècle acheva l'anoblissement par
l'esprit, et l'ancien valet Rousseau passa
à la dignité de Monsieur, en même temps
que le même titre se généralisait parmi
les nobles rapetissés à la taille de valet
de cour. Dans leurs fiefs, ils étaient en-
core Monseigneur, à Versailles, ils n'é-
taient plus q ue Messieurs. Ils se donnaient
ce titre les uns aux autres, en se parlant
ou en s'écrivant. Leurs titres féodaux
1 étaient extérieurement suscrits sur l'a-
dresse, revêtue du cachet armorié; à
l'intérieur on ne lisait que Monsieur. Il
se faisait une sorte de nivellement au tour
do la royauté envahissante, mais d'au-
tant plus isolée, au sommet de la hiérar-
chie sociale.
PourLant,jqsqu'à la révolution, le titre
monsieur ne dépassa pas les limites do
la bourgeoisie urbaine, riche ou lettrée.
Il resta étroitement circonscrit parmi
l'élite cultivée de la nation.
Le mot italien sigT»©/*et l'espagnol senor
sont, encore plus directement que le
français tire, sieur et seigneur dérivés
t du latin senior. Ils ont donc ce même
sens d'aîné, d'ancien, de vieux. En par-
, ' lant à des jeunes gens, les Italiens ont la
ressource d'employer leur diminutif
! signormo qui signifie petit atteiem ou
jeune vieux, c'est absurde.
Il n'est pas douteux que la vulgarisa-
tion en France du mot monsieur, n'ait
été due surtout à l'influence de nos deux
reines do la famille de Médicis. Elles ont
italianisé la cour, qui fut imitée par la
ville èt ceUe-ci par la province.
Chez les Allemands, Herr slftnifie le
nofcle, le chef, le maître. Cest l'équiva-
lent du français seigneur, dans son sens
féodal. Ce n'est pas la traduction du latin
senior, mais du dominus, maître de lUi-
son, ou peat-etre de pÀtnmus, chef de
! dan, protecteur et défenseur de ta fias,
de sa clientèle.
Les Anglais ont pri» du normand notre
mot dm, dont ils ont fait ér (prononces
jswMoiut w p»pml e'eet 118 titre
de noblesse que tout Je monde n'a ma
le droit de Pr -u4m, Itee emrioyé ...,
c'est n« siwple tume 4e p^H5j»{ya-
tofue % notre sa tout
la parotO. On «pelle .... cie .... jev-
nm jr«ns m fEmml 1m mmi lM-
dis qu'on appelle les bourgeois de leur
nom précédé du titre de mister, équiva-
lent de maître. Mais si on leur écrit, il
est d'usage d'ajouter sur l'adresse le
titre (Yesquire, qui signifiait à l'origine
écuyer, et qui le fait monter au rang de
gentlemen.
C'est par ce mot Gentleman que les
Anglais ont traduit textuellement notre
mot gentilhomme. Meis ce terme a eu
pour eux un sens plus indéterminé que
chez nous. Il n'implique aucun degré de
noblesse héréditaire, mais s'applique à
tout homme bien élevé, de bonne com-
pagnie et, comme tel, faisant partie de
la gentry.
fi faut traduire par Seigneur le titre de
Lord qui est héréditaire et analogue au
titre de sénateur romain. Mylord est
donc l'équivalent de Monseigneur.
Les actes de procédure conservaient
pourtant les anciennes distinctions. Les
titres de noblesse s'y étalaient tout au
long. Mais pour les robins de la chicane,
tout bourgeois n'était que le sieur un tel
et l'usage s'en est perpétué. Quant aux
manants ou vilains, ils étaient appelés
de leur nom tout court; encore tous n'en
avaient-ils pas.
Ollmd les registres de l'état-civil furent
institués par la Révolution, il ae trouva
dans les villages que la majorité des
Français n'ivaient pas de nom de famille.
Il fallut leur en Inventer. Le hasard pré-
sida à cette distribution. Beaucoup de
gens furent nommés du nom de leur pro-
fession . De IJ4 le nombre considérable
de familles qui s'appellent Boulancer,
Charpentier, Fafrre ou Serrurier. Tel fut
nommé du nom de son champ, tel autre
de celui du bordage dont il était fermier,
ou dans lequel il était né comme domes-
tique. D'autres reçurent le nom de leurs
terre ou de 1ocaIiI6I, eurent des dési-
vWages ou hameau natal. Ce tarent
les mieux partagés; car ces noms de
nenoes aristeeranques qui n'étaient pas
les noms de métiaM. Bien des gens ont
trouvé moyen de joindre à çdi nom# la
particule qui n'auraient pu le taire s lis
s'étaient nommés CbwronouTisserind.
La destinéedeeertatoes tojNi tenu à
ee fait qu'un «naire ou un U#oiat a hap-
tistf d ua nom pins 08 moins uobDesa-
We un arrière Emnd-pèro W* ftmss-ià
s'était appelé Pierrot ou Jeannot, et ne
savaitque mettre sa croix sur les actes
de naissance de ses enfants, devenus des
messieurs.
Quand les législateurs de l'Assembléo
Constituante curent aboli en France, les
titres de noblesse et les distinctions do
classe, les législateurs de la rue ou dee
clubs, jacobins ou montagnards, décrus
tarent a leur tour qu'on devait renonce-
au titre féodal de sire, de sieur, ou mèmr
de Monsieur, dérivés de celui scif/ncur.
C'était logique. Ce titre, par son étymo-
logie, donné à des jeunes gens ayant lo
sens d'ancien, d'aîné, de vieux, était
absolument ridicule; et avec son sens
féodal de suzerain il était également dé-
placé entre des égaux qui n'étaient plus
ni seigneurs ni suzerains de personne.
Au point de devtiedu droitetdela lofique,
comme au point de vue du simple bon
sens, le terme de monsieur est un contre
sens. Appeler messieurs des jeunes gens
de vingt ans, et même des éphébes im-
berbes, cela prête à rire à tous ceux qui
savent les ongines de la langue.
La génération révolutionnaire avait
donc absolument raison de vouloir effa-
cer de nos mœurs un usage devenu illo-
gique par son extension abusive, et qui
n'avait de sens que dans une société
aristocratique. Dans une démocratie, il
devient un contre-sens ridicule.
Nos pères avaient raison de revenir
aux usages des Grecs et des Latins, nos
maîtres en politesse urbaine. Ils avaient
raison de «onlofr appeler chacun par son
nom propre, ou w moins par ce nom
joint an nom de famille, sans ces péri-
phrases honorifiques qui, une fois gêné-
ralisées, deviennent de pures chinoise-
ries; comme ils avaient raison de vou-
loir revenir au tutoiement, c'est-à-dire à
la logique du bappt Ile avaient raison
aussi de soutenir que le titre le plus
digne à donner A des hommes libres est
celui de dtafem uni est ttffirmation du
droit égal pour tous, soit qu'on rem-
ploie en partant m peuple MsemMe.
soit qu'on le donne smlndividus dont
onifaerele nom "."..
CLÉMENCE ROYER.
. (Xj^twre),
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 73.19%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 73.19%.
- Auteurs similaires Fonds régional : Nord-Pas-de-Calais Fonds régional : Nord-Pas-de-Calais /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "NordPdeC1"Ordonnance du roi, qui défend aux gouverneur-lieutenant général, intendant & gouverneurs particuliers des Isles sous le vent de l'Amérique, de percevoir le droit de deux pour cent sur les nègres ; et réunit aux caisses de la colonie le produit des fermes des cafés, boucheries & cabarets . Du 23 juillet 1759 /ark:/12148/bd6t54203985d.highres Ordonnance du roi, portant règlement pour les appointemens du gouverneur-lieutenant général, intendant, gouverneurs particuliers, lieutenans-de-Roi & autres officiers de l'État-major, commissaires & écrivains de la marine, servant aux isles sous le vent ; et qui fixe leur nombre, leur grade & leur résidence . Du 23 juillet 1759 /ark:/12148/bd6t54203983k.highres
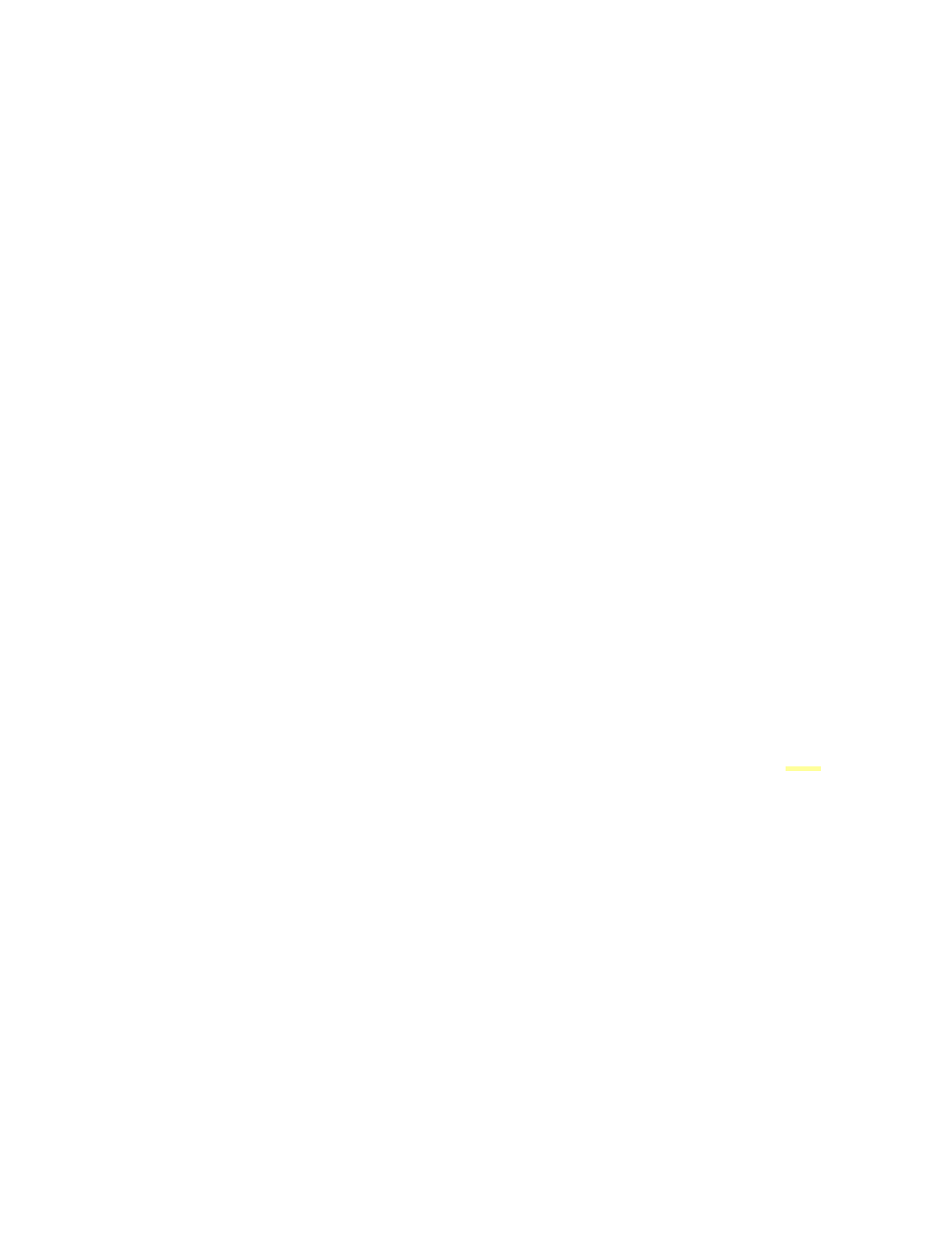
-
-
Page
chiffre de pagination vue 2/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k67034199/f2.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k67034199/f2.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k67034199/f2.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k67034199/f2.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k67034199
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k67034199
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k67034199/f2.image × Aide




Facebook
Twitter
Pinterest