Titre : L'Univers
Éditeur : L'Univers (Paris)
Date d'édition : 1876-06-08
Contributeur : Veuillot, Louis (1813-1883). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, Pierre (1859-1907). Rédacteur
Contributeur : Veuillot, François (1870-1952). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34520232c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 70622 Nombre total de vues : 70622
Description : 08 juin 1876 08 juin 1876
Description : 1876/06/08 (Numéro 3174). 1876/06/08 (Numéro 3174).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse Collection numérique : Bibliographie de la presse
Description : Collection numérique : BIPFPIG44 Collection numérique : BIPFPIG44
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k700447p
Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2011
/ • i fV«« . l.i .
! ■/>".. % c
Jeudi 8 Juin 18136
N° 3174. — E^tioa qttbtlâlêanëJ
Jeudi 8 Juin 18,7G
PARIS
Un an !>8 fr.
Six mois 50
Trois mois... 16
Le numéro, à Paris : 15 cent^--*.
— Départements : 20 /CïyJ'- C\
/ v'\» * ' ~ " . 1 A\ -,
— _ /
Paris, 10, rue des Saints-Père£< | >
O q s'abonne, à Rome, via delle Stimate, S
DÉPARTEMENTS
Un ail....... 88 fr.
Six mois SO
Trois mois............ 16
Édition seiat-qaoUdienne " ""
Un an, 32 fr.—Six mois, 17 fr.—Trois mois; 9 !'?-
L'£/;iii'cr« ne répond pas des manuscrits qui lui sont adressé.,.
FRANCE
PARIS, 1 JUIN 1876
Le rédacteur, en chef de l'Univers a rëçji
à Bordeaux le discours où M. Jules Ferry
a prétendu le citer. Voici sa réponse : '
Bordeaux, 6
M. Jules Ferry a rencontré le succès
à la tribune en m'attribuant une
phrase qui déchire, selon lui, tous les
voiles de la tortuosité catholique ;
« Quand les libéraux sont au pouvoir,
nous leur demandons la liberté parce*
que c'est leur principe, et, quand nous
sommes au pouvoir, nous la leur re
fusons parce que c'est le nôtre. » Le
sincère orateur a été couvert d'applau
dissements par son parti, qui ne ment
jamais.,
Pour le cas où M. Ferry voudrait re
nouveler la fête, je l'avertis .que cette
parole « profonde » n'est pas de moi.
Elle appartient à M. de Montalembert,
lequel a laissé croire qu'il me l'imputait,
malgré son invraisemblance. Monta
lembert devenu libéral ne méprisait
pas autant qu'il l'aurait dû tous les
mauvais petits procédés oratoires. Un
jour, étant de mauvaise humeur, il lui
plut de Tésumer ainsi les sentiments
qu'il lui plaisait de nous, attribuer. > Je
crois pourtant que la tournure était
moins lourde, et je soupçonne M. Ferry
d'y avoir touché. Quoi qu'il en soit, les
catholiques libéraux trouvèrent que
c'était tout à fait cela. Ils firent circu
ler le portrait en le déclarant authenti
que. Désormais c'est une bonne pièce
pour un dossier d'oiage. Si le pauvre
Montalembert avait su qu'il fournis
sait des couperets pour M. Ferry, il en
aurait eu quelque chagrin. Dans ce
temps-là il accusait encore lès catho
liques de vouloir étrangler la liberté en
tre le corps de garde et la sacristie. L'em
pire me tenait alors au violon-et je ne
pouvais dire que j'avais eu d'autres
desseins, de sorte que je. m£ trouvai
convaincu. . .
J'ai écrit quarante ans, et il ne res
tera peut-être d.e moi que cette parole,
que je n'ai pas prononcée et qui me
parait médiocrement française. J'en
serais fâché si j'étais de ceux qui as
pirent à l'Académie; mais je sais m'ac-
commoder des aventures que notre
temps ménage à-mou espèce, et je.
pense que je finirai par mourir tout '
de même, quoique chargé d'une phra
se de Montalembert plombée par M-
Jules Ferry. Je proteste uniquement
pour l'amour de la vérité. "
J'observe en outre que je n'ai pas
demandé là liberté aux libéraux « au
nom de leur principe. » Je l'ai deman
dée et je la demande, parce quë
c'est mon droit. Et ce droit, je ne le
tiens pas d'eux, mais de mon baptême
qui m'a fait digne et capable de la li
berté. En renonçant à Satan, à ses
pompes et '-à 'ges'œuvres,' c'est par la t
non autrement, que je suis devenu
libre; c'eèt par là que la société est
baptisée et qu'elle a donné à mes pè
res, et me doit cette liberté dont je ne
veux user ni contre le prochain ni
contre moi-même. Ceux qui n'ont pas
reçu ce même baptême et pris les mê-i
mes engagements, ou qui ne s'en sou-'
viennent que pour les reniër, né sont
plus dignes de la liberté, ne sont pas
libres et cesseront de le paraître bientôL
Apostats du baptême, ils la sont né
cessairement de la liberté ; je l'ai tou
jours dit. Non-seulement je ne m'ap
puie pas sur leur principe, mais je dis
qu'ils ne l'ont pas, qu'ils n'y croiënt
pas, qu'ils n'y peuvent pas croire,
qu'ils sont même dans l'impossibilité
d'en comprendre la pratique. La dé-:
monstration court les rues, la tribune
en est témoin, et le premier article de
leur syllabus est : Point de liberté. Ils
prennent la coutume de, nous dire que
la monarchie nous a refusé la liberté.
Oui, leur monarchie, la monarchie des
libéraux.
Mais la vérité est aussi qu'ils étaient
parfaitement d'accord avec le monar
que et qu'ils le menaçaient fidèlement
de le renverser, pour "peu qu'il parût
se relâcher là-dessus. Tout ce que nous
avons de liberté, nous l'avons conquis
sous la république, mais alors c'était
la république sans républicains. A
présent, nous avons la république avec
les républicains, et la liberté s'en va
par violence ou escroquerie. Quel était
notre unique argument contre la répu
blique des républicains? Elle tuera la
liberté, élle tuera la religion, elle tue
ra la propriété, elle essayera de tuer
même le baptême ! Gommence-t-on à
voir clair? Les libéraux devènus répu
blicains ne sont bons qu'à tuer tout
cela ; voilà cent ans que leur secte y
travaille, et dès à présent le mal serait
sans remède s'ils n'avaient l'habitude,
à laquelle ils ne manqueront pas, de
se tuer eux-mêmes. Mais par la grâce
de Dieu, sans le savoir, ils donnent
aux catholiques un bon baptême, le
baptême du sang. On leur dit : Je suis
prêt, vous l'êtes, voilà votre guillotiné,
qui empêche que je sois baptisé? Etilis
baptisent bêtement, mais validement.
Car ils ne sont pas forts, mais on ne
peut contester qu'ils ne soient sots et
un peu au-dessous de l'ordinaire hu
main; Qu'on veuille être baptisé par
eux, on le sera toujours, et c'est assez
pour vivre;
Une autre preuve que ce n'est pas
moi qui ai fourni à M. de Montalem
bert, et par suite à M. Jules Ferry, la
matière de ce résumé, c'est. qu'après
m'avoir fait parler du principe des. li
béraux, on me fait supposer la ma
nière dont les catholiques doivent se
conduire lorsqu'ils sont au pouvoir.
Les rédacteurs de l'Univers^ n'ont ja
mais eu beaucoup à réfléchir sur cette
éventualité; le temps de notre pouvoir
ne nous a jamais paru prochain. En
quarante ans, personne du petit groupe
au milieu duquel on a pu nous^ attri
buer quelque action, n'a eu un instant
de popularité, ni d'aspiration à rien
qui puisse y ressembler. Nous sommes
restés dans notre médiocre et miséra
ble condition de fidèles catholiques, et
nous espérons n'avoir rien fait ni rien
dit qui pût montrer en nous la moin
dre tentation d'en sortir, par quelque
porte que ce fût. Dans .notre parti,
c'est une habitude prise, et comme un
double sceau d'origine et de destinée.
On le sait si bien, qu'un homme qui
veut être aux affaires, si peu que ce
soit, cesse d'abord un peu d'être de
nos amis. Que de sous-préfets et de
substituts dont nous avons perdu les
complaisances, avant même de leur
donner congé ! U y a presque une ini
mitié naturelle entre l'Univers et les bu
reaux de tabac. Si on a pu voir quel-:
ques idées contraires chez quelques
catholiques, ils étaient libéraux; ils
flattaient les libéraux, ils tournaient à
la liberté des libéraux, ét ne refu
saient pas de lui donner des arrhes.
Chez nous, rien qui témoigne d'un dé
sir quelconque de parvenir aux gran
des destinées d'un Spuller ou d'uij
Jules Ferry.
Quand M. da Montalembert, séduit
par ses idées plus que par son carac
tère,. s'annonça libéral et rêva la po
pularité, ce nè fut pas son meilleur
moment; mais il eut beau faire, la
force de. ses convictions et la hauteur
de son âme le retinrent encore parmi
ceux qu'il abjurait. Il ne put, grâces a
Dieu, franchir les derniers échelons
qui devaient le séparer de nous ; ce
qu'il avait à faire pour parvenir au
pouvoir, il ne l'aurait jamais fait. Il
n'arriva qu'à l'Académie, ce qui est
beaucoup sans doute, mais ce qui est
encore innocent.
Quant à moi, protégé par l'humilité
de ma condition ét par, la bassesse de
que je ne în'y : tiendrais pas, et que
n'ayant point l'ambition de gouverner
le monde, je ne saurais pas mentir. Je
me suis borné toute ma vie à essayer
dé donner à quelques-uns de mes con
temporains l'amour de la liberté et à
leur en faire comprendre lés condi
tions. Je ne mé suis jamais occupé de;
ce que je saurais faire de moi-même '
lorsque je serais au pouvoir, ou lors
que mes amis s'y verraient. II y a une
loi de Dieu qui dicte cela aux plus pe-"
tits comme aux plus grands, et des
conseils de l'Eglise qui en règlent la
pratique. M. Ferry voudra bien remar
quer que je n'ai jamais eu l'imperti
nence dè m'offrir au suffrage univer
sel, ni de lui soumettre une profession
de foi quelconque, ni permis à l'im
pertinence d'aucun suffrage de s'oc
cuper de moi. J'ai simplement dé
fendu la vérité, sans forcer ni flatter
personne.
Gela dit, je cherche très sincèrement
ce que M. de Montalembert et ses amis
d'abord, et ensuite M. Ferry et les
siens, peuvent trouver de si extraor
dinaire et de si effronté au fond de
l'opinion qu'ils m'attribuent dans des
formes si brutales. Ce, n'est, en défi
nitive, que l'opinion de tout le monde.
Tout le monde, — du moins tous les
honnêtes gens, -r- réclame avec les li
béraux la liberté de tout le monde, qui
est d'aller, de venir et de parler comme
tout le monde; et tout le monde aussi
condamne et refuse avec les catholi
ques la liberté de mentir, de voler et
d'assassiner tout le monde. C'est vieux
et admis comme le bon sens.
Je vous demande pardon d'en dire si
long sur une billevesée catholique-li
bérale ramassée par M. Jules Ferry,
qui en a fait la partie brillante et pro
bante de son discours contre, la liberté
d'enseignement.
Louis Veuillot.
• ; . . — ^ ■
loi existante, dont M. le maire, lui-mê
me, en sa qualité, doit être le'jjremieri
à faire respecter le caractère tant
qu'elle ne sera pas abrogée. Mais à
quoi bon discuter avec M. le maire de
Rousset? .11 s'en réfère à ce que lui
diront les '«autorités supérieures.»
Nous ne-sommes pas moins curieux
de l'apprendre, et il devrait bien,
quand il aura leur réponse, nous faire
savoir .si les. autorités supérieures
ayant examiné la protestation lui don
neront enfin licence de légaliser les
signatures « y apposées dessus. »
Auguste Rousskl.
Nous faisons parvenir aujourd'hui
au Sénat une nouvelle série de 18,285
signatures, preuve nouvelle que le
mouvement, comme nous l'espérions,
s'accentue au lieu de se ralentir. Ce
matin même nous avons reçu d'autres
pétitions en grand nombre, que nous
ferons déposer demain et les jours sui
vants. En même temps nous prions
les signataires de joindre à leurs pé
titions toutes : les pièces destinées à
faire constater le mauvais vouloir ou
le refus des maires en ce qui concerne
la légalisation des signatures. L'une
des plus curieuses en ce genre, c'est
certainement celle qui nous est adres-r
sée des Bouches-du-Rhône. Le maire
de Rousset écrit à un pétitionnaire ;
Monsieur,
Après avoir lu attentivement votre pro
testation pour envoyer au Sénat et à l'As
semblée nationale, il m'est impossible de
pouvoir môme légaliser les êignatures y
apposées dessus, avant de m'ôtre adressé
aux autorités supérieures, vu que cette pro
testation est contre le projet du ministère ac
tuel.
Recevez, etc.
On voit qu'en fait de droit de péti
tion M. le maire de Rousset a des
théories étranges. Ainsi, le seul fait
que la protestation vise un projet mi
nistériel suffirait, à ses yeux, pour
motiver un refus de légaliser les signa-
: tures? M. le maire, si attentivement
qu'il ait lu la protestation, n'a oublié
qu'une chose, c'est que si elle vise un
projet ministériel, elle demande d'au
tre part le respect et le maintien d'une
amendement tendant à la création d'un jury
professionnel désigné par le conseil supé
rieur de l'instruction publique, et devant le
quel les aspirants auraient à subir un exa
men professionnel.
L'orateur a développé son amendement
en termes excellents et souvent éloquents ;
blique, M: Boyer et ses amis, voyant qu'il
|.n'y avait rien à espérer de l'armée révolu
tionnaire, conduite et excitée par M. Wad-
diogton, ont retiré leur amendement, et mis
fin à la discussion et à la séance.
Il ne reste plus qu'un amendement à dis
cuter, celui dé M. Raoul Duval. Il le sera
mais il avait trop raison pour qu'on l'enten-1 demain ; mais âl aura le même sort que
dît. Aussi ne l'a t-on point écouté. II y a eu | celui de M. Boyer. La £
On lit dans le Journal officiel :
M. Plichon, député du Nord, a déposé une pé
tition de plusieurs habitants de Maubeuge
(Nord).
M. le comté Le Gonidec de Traissau, député
d'Ille-et-Vilaine, a déposé sept pétitions signées
par un grand nopibre d'habitants des départe
ments d'Ille-et-Vilaine et d8 lîÀude.
M. de Largentave, député des Çôtes-du-Nprd,
à déposé trois pétitions signées par un grand
nombre d'habitants de Saint-Jouan,'Lihon et La
Vicomté (Côtes-du-Nord). • .
M. le vicomte de Ghambrun, député de la Lo
zère, a déposé une pétition signée par un grand
nombre d'habitants de la commune de Luc (Lo
zère). ,
M. le marquis de Partz, député du Pas-de-Ca
lais, a déposé :
1° Une pétition signée par 43 habitants de la
commune de Pierremont (Pas-de-Calais);
. 2° Des pétitions signées par 719 habitants des
départements du Nord et du Pas-de-Calais.
M. Cazeaux, dépuié des Hautes-Pyrénées, a
déposé une. pétition de plusieurs habitants de:
Recurt (Hsuies-Pyrénées). ■ • .
MM. de La Rochette et H. de La Billiais, dé
putés de la Leire-Inférieure, ont déposé 10 péti
tions revêtues de 891 signatures, toutes légali
sées, d'habitants des communes de Bouquenais,
Assefz, Saint-Léger, la Chapelle-Launay, Gros-
sac, Plessé, Plessé-Coudray, Maisdon, et Sion
(Loire-Inférieure).
M. Relier, député du Haut-Rhin, a déposé des
pétitions signées par 276 habitants du départe
ment de là Lozère.
Ces pétitions sont relatives à l'ensei
gnement supérieur.
On lit dans le Temps :
Il n'y a pas eu Mer (à proprement parler)
de conseil dès ministres, mais une" simple!
réunion de ministres dans laquelle M. de
Marcère, ministre de l'intérieur, a exprimé
à ses collègues le regret de voir que les par
tis dits conservateurs n'avaient tenu aucun
compte de la modération et des idées conci
liantes qu'il avait apportées dans le choix;
des fonctionnaires lors du mouvement ad
ministratif.
En conséquence, M. le ministre de l'inté
rieur a demandé à ses collègues, qui étaient
tous présents, d'avoir à l'avenir la plus en
tière liberté pour choisir le personnel admi
nistratif parmi les citoyens ouvertement
ralliés J&. la forme actuelle du gouverne
ment. , :
M. le garde des sceaux et tous les mi
nistres ont approuvé la iigne de conduite
qu'entend tenir à l'avenir M. de Marcère.
Si le Temps est bien informé, voilà
M. le président du conseil réduit au
rôle de sous-Marcère; nous l'aurions
cru plus fier.
La Presse confirme les informations
du Temps , dont Y Echo universel , autre
officieux, reproduit la note sans en in
diquer la provenance.
On nous écrit de Versailles, le
6 juin :
Après le vote de samedi prononçant la
clôture de la discussion générale, il était
aisé de voir que la majorité républicaine
attendait avec impatience l'héiire. où elle
pourrait enfin décapiter la loi sur l'ensei
gnement supérieur.. Néanmoins, M. Ferdi
nand Boyer est venu tenter un dernier ef
fort pour la sauver. Répondant à l'argu
ment de ceux qui pensent que l'Etat doit
exiger des garanties des jeunes gens qui
voudront se livrer à une profession libérale
privilégiée pour laquelle les grades sont
' m * t * 1 - 1 ' n «tinrirtoi nn
exigés, M. Ferdinand Boyer a proposé un
un moment cependant où sa voix, prenant
subitement de la force et.de l'étendue, a
adjuré la Chambre de ne point condamner
une loi qui n'a pas encore vécu. En tout au
tre lieu, l'argument du député de Nîmes
eût eu quelque chance de succès; mais ici
il n'en avait aucune. Sous la Convention,
dont on nous a fait encore aujourd'hui l'é
loge, la révolution émancipait les jeunes
tilles, — des enfants! — pour pouvoir les
guillotiner. Aujourd'hui, sous la Législa
tive, dont le suffrage dit universel nous a
dotés, elle émancipe les lois pour les décapi
ter. ; Celle de 4875 sur la liberté d'enseigne
ment n'a pas encore vécu, n'a fait aucun
acte bon ou mauvais,n'importe:elle trouble
l'eau de messire loup, elle est condamnée
à être dévorée. :
Messire loup no nous l'a point laissé
ignorer. Il nous l'a déclaré dans la per
sonne du citoyen Laussedat, qui a, ou peu
s'en faut, le physique de l'emploi. Nous au
rons la liberté et l'enseignement comme
sous la Convention. La liberté qu'a donnée
« cette grande Assemblée », chacun la con
naît ; quant à son enseignement, enseigne
ment- supérieur, secondaire et primaire, on
le connaît moins. Si,l'on s'en rapportait au
citoyen Laussedat, - qui a lu cela dans quel
que brochure jacobine, l'instruction aurait
été très florissante sous la.Convention. « Il
ne faut pas oublier, s'est-il écrié, qu'elle a
fondé de grands établissements à tous les
degrés. » Et il a cité l'école polytechnique,
les écoles centrales, l'école normale, l'école
des arts et métiers, etc.. Il est très vrai
que ces écoles ont existé ; mais si le
citoyen Laussedat avait lu autre chose
que des brochures sur ce qu'il appelle
à pleine bouche « la grande Assem
blée »; s'il avait lu non pas des histoires
écrites par des adversaires ou des apolo
gistes, mais l'histoire que la Convention a
écrite elle-même et qui se trouve.au Moni
teur^ il aurait vu que ces établissements
n'ont existé que sur le papier, qu'ils n',eu-
rent ni livres, ni professeurs, ni élèves;
que tout cela n'était, selon l'expression du
citoyen Romme, que «l'étalage d'un vain
charlatanisme », et qu'il n'y avait plus
en France ni enseignement primaire ni
école secondaire quand la Terreur s'é-
ventra de ses propres mains et tomba
noyée dans son sang. Et ce qui est non
moins vrai, c'est que ce fut l'Eglise qui eut
alors, comme elle l'a toujours eue, la plus
large part dans la résurrection de notre en
seignement public en général, et de l'ensei
gnement primaire en particulier.
Après la déclaration du citoyen Lausse
dat, il n'y avait plus rien à dire ; cependant
M. Estignard a eu le courage de monter à
la tribune et de plaider une dernière fois,
devant la majorité républicaine et libérale,
la cause de la liberté ! Il l'a fait avec une
force et une énergie qui ont d'autant plus
irrité les républicains que l'orateur avait
un instant penché de leur cô!é. Plusieurs
■fois, pour mettre fin aux traits mordants et
•incisifs qu'il leur décochait, ils ont tenté de
■ lui faire enlever la parole par M. le prési-
-dent. Mais celui-ci, trouvant sans doute ce
procédé un peu trop jacobin, n'a pas cette
fois obtempéré au désir de ces messieurs.
En sorte que M. Estignard a pu terminer
son discours et lancer cette dernière flèche
-à ses adversaires furieux : « Parmi lés li
bertés dont M. Laussedat parlait tout à
l'heure, on a oublié la liberté des cabarets.
La Chambre la votera bientôt. Mais il est
permis de préférer la liberté qui moralise
•à la liberté qui abrutit. »
En présence de l'attitude de la majorité
républicaine et libérale, en présence des dé
clarations faites au nom de la commission
par M. Barni, déclarations fort injurieuses
pour le conseil supérieur de l'instruction pu-
. gauche ni la droite
ne le voteront, quoique pour des liaisons
différentes.
On lit dans le Constitutionnel :
Le débat sur la pension àaccorderàMme
Ricard sera vif assurément.
Une loi a prévu le cas de telles pensions;
mais elle demande qu'il soit établi que la .
mort du ministre en activité soit le triste
effet d'une maladie contractée au service de
l'Etat, - c'est-à-dire dans l'exercice des fonc
tions publiques. - ■'
C'est à l'aide de cette loi qu'un certain
nombre de fonctionnaires de l'empire ont
obtenu ces pensions fameuses, qui eurent
la vertu d'horripiler si étrangement M.
John Lemoinne.
Pour aujourd'hui, ce que nous tenons à
dire, c'est que les bruits les moins fondés
ont été mis en circulation sur l'état de for
tune de feu M. Ricard.
Un journal a prétendu que la dot da sa
femme s'élevait à 400,000 francs, et que
cette dot était intacte à cette heure.
Nous.tenons; nous, d'une source absolu
ment certaine que la dot de Mme. Ricard a
été de 70,000 fr., sans un centime de plus.
Elle reste avec trois enfants ; et la succes
sion de son'inari est onérée et onéreuse.
Ces détails sont pénibles et délicats à di
vulguer ; mais nous estimons qu'un journal
a l'obligation de communiquer au public
tout ce qui parvient à sa connaissance.
Une fois dans cette voie de révélations
intimes, nous irons plus loin.
Nous attirerons instamment l'attention
des Chambres et du gouvernement sur la
situation de Mme de Goulard.
Elle est digne d'intérêt, pour ne rien dire
de plus.
Ur, M. de Goulard fut trois fois ministre.
Il débuta sous Louis-Philippe, en qualité
de sous-secrétaire d'Etat. Il eut un rôle
actif et éminent dans les pénibles négocia
tions qui amenèrent la paix de 1871 avec
l'Allemegne.
Enfin, il serait temps aussi que les pou
voirs publics portassent un regard d'agis
sante sympathie sur la fille aînée du grand
capitaine e t du grand citoyen qui s'appela la
maréchal Bugeaud.
C'est Mme Gasson ; elle est retirée à
Sarlat. Nous n'en disons .pas davan
tage.
A entrer trop avant dans le secret de ces
douloureuses destinées et de ces cruels
abandons, on s'exposerait à froisser les lé
gitimes fiertés d'une conscience et d'une
résignation héroïques.
Nous tenons volontiers le Constitu
tionnel pour bien informé au sujet de
Mme Ricard, et, comme lui, nous
trouvons ces sortes de discussions
fort pénibles. Cependant, un journal
n'est pas libre de les écarter. Il faut
donc dire que le très court passage
de M. Ricard au ministère de l'inté
rieur ne donne pas à si veuve et à ses
enfants le moindre droit à une pen
sion. Quant à une « récompense natio
nale », il est à la fois impertinent et
ridicule d'en parler.
Le parti républicain veut que Mme
Ricard ait une pension, parce que M.
Ricard, après avoir été un des com
missaires du 4 septembre et l'un des
plus passionnés, puisqu'il a porté la
main s.ur la magistrature, s'est mis,
comme ministre, au service de la ré
volution. Il s'agit donc de récompenser
des opinions et de poser en fait le droit
des républicains, non-seulement à vi
vre du budget, mais à en faire vivre
les leurs.
Si M. Ricard était mort après ses
échecs électoraux, les titres dé sa
veuve à une pension eussent été les
mêmes, c'est-à-dire nuls, et personne,
si modeste que fût sa situation finan
cière, n'aurait songé à la doter aux
FEUILLETON DE L 'UNIVERS
DU 8 juin
BEAUX-ARTS
SALON DE 1876
Cinquième article. — Voir les n"® des 7, 14,
23 et 30 mai.
Il y a tant de jolis petits tableaux à
l'Exposition, qu'en revenant du palais des
Champs-Elysées au logis, nous sommes
toujours .tenté de rendre compte des ta
bleaux de genre ou de» paysages, au lieu
de continuer l'examen des sujets graves
et de traiter de la grande peinture, Mais il
nous faut résister à la tentation, ne vou
lant rien négliger de ce qui peut contribuer
à encourager ceux qui cultivent l'art sér
riéux. Si leurs tentatives plus ou moins
heureuses n'obtiennent pas au Salon un
grand succès, elles ne sont pas moins loua
bles et souvent même fort recommanda-
bles, vu la très grande difficulté que pré
sentent les. sujets qu'ils abordent et qu'ils
surmonté quelquefois. • - -
Nous signalerons d'abord plusieurs artis
tes qui se sont rencontrés en prenant pour
sujet la Pieta. Nous en avons compté cinq;
avec M. Bouguereau, dont nous avons déjà
parlé, cela fait six. C'est un groupe, et,
chose singulière, depuis le temps que l'on
dit : c'est fini ! et en dépit des cuistres rou- j
ges,-l'es anges, les saints, la Pieta, et tout
ce qui touche, comme dit le Siècle, « aux !
idées d'Eglise », reparaît toujours: l'art
moderne ne peut pas se décider à devenir
renégat.
Des quatre artistes en question, M.'Hen-
ner est assurément le plus habile à manier
la couleur et le pinceau. En cela son ta
bleau est de beaucoup supérieur aux au-,
très, mais c'est aussi le moins bien com
posé. M. .Henner a tout sacrifié à un effet
lumineux et au développement d'un torse
et d'un bras, mais c'est à peine si son 1
Christ a dos jambes, et quant à la Vierge
et aux têtes à demi coupées qui se profilent
sur un fond noir, il n'en faut pas parler :
elles ne sont autour dii Christ mort qu'afin
d'accentuer à outrance le contraste des car
nations. Ilyadeux ans, M.Lévy avait exposé
un sujet analogue, mais il y avait dans son
tableau plus de composition, plus de sens
poétique... sans qu'il y eût moins d'effet, et
la couleur brillait surtout par l'absence de
ce blanc et de ce noir intenses dont M.
Henner a abusé.
M. Gabriel de Cool et M. Royer Lionnel
ont aussi fait leur Pista de grandeur natu
relle, mais ils n'ont pas pris leur sujet pour
en faire seulement, un thème de coloriste:
ils ont respecté, autant qu'il leur a'été pos
sible, la tradition et ils ont fait tous leurs
efforts pour peindre un beau Christ mort et
une Mater dolorosa expressive. L'intention,
du moins, est assez marquée pour qu'il n'y
ait pas à s'y méprendre, et c'est déjà beau
coup.
M. de Cool est celui qui semble avoir dé
jà acquis le plus .d'expérience, sans être
toujours d'une correction irréprochable ; son
dessin est plus souple, et son coloris plus
varié et plus harmonieux qu'ils ne sont dans
le tableau de M. Royer-Lionel. Cependant,
malgré la rigidité des.formes et malgré l'u
niformité quelque peu primitive de sa colo
ration, le tableau de M. Royer-Lionel est
celui dont le premier jet est le meilleur. Le
reste viendra avec le temps.
Où en sommes-nous? A la cinquième
Pieta. C'est à faire prendre le mors aux
dents aux croque-morts et aux pleureurs
des citoyens Esquiros et Michelet. Oui,
cinquième Pieta; mais il faut bien l'avouer,
cette fois-ci l'enfantement a été laborieux.
M. Urbain Bourgeois s'est trop appliqué à
ne pas faire comme les autres : il a épar
pillé ce qu'il devait grouper ; il a placé la
Vierge d'un côté, deux anges de l'autre, et
ces anges, dévotement agenouillés.au pied
d'une croix dont le sommet est perdu dans
le cadre, ne songent nullement à se dépla
cer, soit pour se rapprocher du Divin Cru
cifié, Boit pour assister sa mère. Tous les
personnages font bande à part. Le corps
du Christ, étendu et isolé sur le premier
plan, ne semble avoir aucun rapport avec
les autres figures, et, vraiment, il serait à
souhaiter qu'il en fût encore plus séparé et
qu'il ne restât de tout le tableau que la tête
de ce Christ mort, que- nous signalons
comme étant l'un des plus beaux morceaux
de peinture qui ' soient à l'Exposition. —
C'est assez dire pour montrer , que M
Urbain Bourgeois .n'est pas le premier
venu, et pour constater le soin que nous
mettons à ne rien omettre de ce qui
peut être loué. Aussi ne pouvons-nous
nous dispenser de mentionner le ta
bleau de M. Bruno Cherier. La Sainte
Vierge repoussée de l'hôtellerie et. réduite à se
réfugier dans l'étable de Bethléem. C'est là
une composition sagement conçue et ingé
nieusement développée, à cela près qu'au '
lieu de voir une femme sèche et criarde,;
nous dirions presque une furie sur le seuil ;
dé l'hôtellerie, nous aurions préféré y voir
l'hôtelier en personne ou son valet.
Le jeune David , de M. Joseph Ferrier, a
beaucoup de nerf, et le corps de son Go
liath est celui d'un géant taillé et propor
tionné comme il convient pour bien établir:
le contraste. L'agencement des deux figures
est parfait : il semble que le corps de Go-
liath étendu et vu en raccourci contribue à
agrandir les deux personnages tout en con
servant leurs proportions relatives. Le des
sin est souple et vigoureux, l'action est
vive, mais par malheur les têtes sont d'un
caractère outré et vulgaire, et l'expression
du jeune vainqueur de Goliath rappelle
moins David qu'elle ne fait songer à nos
héros dè barricades.
Voici encore un petit Saint' Jean-Baptiste
qui n'est autre qu'un modèle d'atelier très
reconnaissable, encore qu'il soit ici coiffé
d'une auréole d'or, laquelle se découpe
comme un plat de métal sur un fond azuré.
Mais au moins l'étude du petit garçon est
remarquablement dessinée et peinte, et,
bien que M. Perrault soit élève de M. Bou
guereau, M. Perrault prend son temps, voit
bien la forme etla fixe sur sa toile sans abu
ser des reflets ni du blaireau. L'on conçoit
qu'il se soit plu à décorer une si belle étude
d'un beau titre, et c'est pourquoi il a donné
à. celle-ci le titre de Saint Jean précurseur.
Tout près de là nous voyons encore une au
tre figure qui n'est pas moins parfaite et
qui a nom YOracle des Champs. Ce nom est
joli, mais la figure de jeune fille vêtue d'une
robe blanche et dont le profil éclairé par
les reflets de l'aurore se détache sur un
ciel sans nuage est encore plus gracieuse
et plus aimable que son nom. Elle tient
dans sa main et près de sa bouche une tige
surmontée 1 d'une aigrette velue sur la-j
quelle elle souffle, et dont les brins légers
s'échappent au vent. Les enfants donnent à
cette graine un vilain nom, et comme nous
n'en savons pas plus long là-dessus que les
enfants; nous voulons " croire que M. Per- ;
rault connaît mieux ou comprend davan- ;
tage le sens des oracles champêtres. Tou
jours est-il que son idylle est tout ce que
l'on peut voir de plus charmant, de plus -va
poreux, et en même temps de plus saisissa-
ble quant à la forme. Mais quant au fond,
il serait à souhaiter qu'un artiste doué d'un
talent réel s'appliquât à traiter de vrais su
jets et qu'il se délivre des imaginations,
trop vaporeuses.
Maintenant, parlons un peu des peintu
res de M. Puvis de Chavannes, exposées
sur le palier du grand espalier, et devant
lesquelles tout le monde passe, non pas sans
sans les voir, c'est si gros ! mais s'y arrê
ter, car c'est si vite vu ! Pourtant ces pein
tures ont opéré un véritable prodige. Tous
les critiques sont tombés en admiration,
non pas instantanément sur le palier, du
grand escalier, mais seulement en rentrant
chez eux et en se retrouvant la plume à la
main en présence de leur écritoire. Ils ont
tous été ravis en extase ; tous ont célébré
à l'unisson VInvention de Sainte-Geneviève
par saint Germain l'Auxerrois , le bûcheron!
demi-nu, le fagot, l'embarcation, la femme
occupée à traire le pis gonflé d'une vache,
et, surtout, l'attelage des ânes. Ces ânes leur
ont paru simples, les vaches sublimes, le
fagot flamboyant, et alors, l'un d'eux ne
pouvant se contenir, s'est écrié : « Non,
elle n'est pas morte, la sentez-vous, l'âme
ardente et fière dè la France ! elle s'inter
rogo, elle se reconnaît, elle est vivante!
Certes, à Dieu ne plaise que nous osions
contredire des feuilletonistes exaltés à ce
point, nous qui n'avons à la main qu'un
simple bout d'aile trempé -dans l'encre de la
petite vertu, et point d'extase. Mais parlons
raison et laissçns pour l'instant l'âme ar
dente et Gère de la France. Il s'agit de l'ex
position et des peintures de M. Puvis de
Chavannes, ce n'est pas le cas de s'enflam
mer; nous ajouterons même, à tout risque,
qu'il faut se méfier des journalistes en
thousiastes et particulièrement de celui que
nous venons d'entendre et que nous cite
rons encore : il est si glorieux I L'on sait
que M. Puvis de Chavannes n'hésite pas à
mettre des portraits de -journalistes en
vogue dans ses tableaux Nous en avons
vus plusieurs, entre autres Théophile Gau
tier, lequel figurait en pied, en toge et en
cothurpes dans le cloître de Sainte-Rade-
gonde.
Ne pourrait-on supposer que le feuilleto
niste auquel nous venons de faire allusion
est peint quelque part et qu'il se flatte de
passer au Panthéon dans les fresques nou
velles ? h - Ce n'est pas parmi les bûcherons
ni au travers du bétail cornu qu'il faut cher
cher son nez ; non, mais il se pourrait fort
bien que ce nez prodigieux soit sous la mitre"
du saint Germain que M. Puvis a inventé.
Cette mitre entr'ouverte n'èmpêche pas dé
voir très bien que le sommet de la tête est
absolument déprimé; dans ce cas, où est
passée la cervelle ? — La cervelle ? elle a dû
tomber dans les fosses nasales du person
nage, et c'est pourquoi son nez a tant de
proéminence.
N'importe, c'est une gageure soutenue
par tous ces messieurs : il faut que le pu
blic avale toutes ces énormités. Il faut por-
! ■/>".. % c
Jeudi 8 Juin 18136
N° 3174. — E^tioa qttbtlâlêanëJ
Jeudi 8 Juin 18,7G
PARIS
Un an !>8 fr.
Six mois 50
Trois mois... 16
Le numéro, à Paris : 15 cent^--*.
— Départements : 20 /CïyJ'- C\
/ v'\» * ' ~ " . 1 A\ -,
— _ /
Paris, 10, rue des Saints-Père£< | >
O q s'abonne, à Rome, via delle Stimate, S
DÉPARTEMENTS
Un ail....... 88 fr.
Six mois SO
Trois mois............ 16
Édition seiat-qaoUdienne " ""
Un an, 32 fr.—Six mois, 17 fr.—Trois mois; 9 !'?-
L'£/;iii'cr« ne répond pas des manuscrits qui lui sont adressé.,.
FRANCE
PARIS, 1 JUIN 1876
Le rédacteur, en chef de l'Univers a rëçji
à Bordeaux le discours où M. Jules Ferry
a prétendu le citer. Voici sa réponse : '
Bordeaux, 6
M. Jules Ferry a rencontré le succès
à la tribune en m'attribuant une
phrase qui déchire, selon lui, tous les
voiles de la tortuosité catholique ;
« Quand les libéraux sont au pouvoir,
nous leur demandons la liberté parce*
que c'est leur principe, et, quand nous
sommes au pouvoir, nous la leur re
fusons parce que c'est le nôtre. » Le
sincère orateur a été couvert d'applau
dissements par son parti, qui ne ment
jamais.,
Pour le cas où M. Ferry voudrait re
nouveler la fête, je l'avertis .que cette
parole « profonde » n'est pas de moi.
Elle appartient à M. de Montalembert,
lequel a laissé croire qu'il me l'imputait,
malgré son invraisemblance. Monta
lembert devenu libéral ne méprisait
pas autant qu'il l'aurait dû tous les
mauvais petits procédés oratoires. Un
jour, étant de mauvaise humeur, il lui
plut de Tésumer ainsi les sentiments
qu'il lui plaisait de nous, attribuer. > Je
crois pourtant que la tournure était
moins lourde, et je soupçonne M. Ferry
d'y avoir touché. Quoi qu'il en soit, les
catholiques libéraux trouvèrent que
c'était tout à fait cela. Ils firent circu
ler le portrait en le déclarant authenti
que. Désormais c'est une bonne pièce
pour un dossier d'oiage. Si le pauvre
Montalembert avait su qu'il fournis
sait des couperets pour M. Ferry, il en
aurait eu quelque chagrin. Dans ce
temps-là il accusait encore lès catho
liques de vouloir étrangler la liberté en
tre le corps de garde et la sacristie. L'em
pire me tenait alors au violon-et je ne
pouvais dire que j'avais eu d'autres
desseins, de sorte que je. m£ trouvai
convaincu. . .
J'ai écrit quarante ans, et il ne res
tera peut-être d.e moi que cette parole,
que je n'ai pas prononcée et qui me
parait médiocrement française. J'en
serais fâché si j'étais de ceux qui as
pirent à l'Académie; mais je sais m'ac-
commoder des aventures que notre
temps ménage à-mou espèce, et je.
pense que je finirai par mourir tout '
de même, quoique chargé d'une phra
se de Montalembert plombée par M-
Jules Ferry. Je proteste uniquement
pour l'amour de la vérité. "
J'observe en outre que je n'ai pas
demandé là liberté aux libéraux « au
nom de leur principe. » Je l'ai deman
dée et je la demande, parce quë
c'est mon droit. Et ce droit, je ne le
tiens pas d'eux, mais de mon baptême
qui m'a fait digne et capable de la li
berté. En renonçant à Satan, à ses
pompes et '-à 'ges'œuvres,' c'est par la t
non autrement, que je suis devenu
libre; c'eèt par là que la société est
baptisée et qu'elle a donné à mes pè
res, et me doit cette liberté dont je ne
veux user ni contre le prochain ni
contre moi-même. Ceux qui n'ont pas
reçu ce même baptême et pris les mê-i
mes engagements, ou qui ne s'en sou-'
viennent que pour les reniër, né sont
plus dignes de la liberté, ne sont pas
libres et cesseront de le paraître bientôL
Apostats du baptême, ils la sont né
cessairement de la liberté ; je l'ai tou
jours dit. Non-seulement je ne m'ap
puie pas sur leur principe, mais je dis
qu'ils ne l'ont pas, qu'ils n'y croiënt
pas, qu'ils n'y peuvent pas croire,
qu'ils sont même dans l'impossibilité
d'en comprendre la pratique. La dé-:
monstration court les rues, la tribune
en est témoin, et le premier article de
leur syllabus est : Point de liberté. Ils
prennent la coutume de, nous dire que
la monarchie nous a refusé la liberté.
Oui, leur monarchie, la monarchie des
libéraux.
Mais la vérité est aussi qu'ils étaient
parfaitement d'accord avec le monar
que et qu'ils le menaçaient fidèlement
de le renverser, pour "peu qu'il parût
se relâcher là-dessus. Tout ce que nous
avons de liberté, nous l'avons conquis
sous la république, mais alors c'était
la république sans républicains. A
présent, nous avons la république avec
les républicains, et la liberté s'en va
par violence ou escroquerie. Quel était
notre unique argument contre la répu
blique des républicains? Elle tuera la
liberté, élle tuera la religion, elle tue
ra la propriété, elle essayera de tuer
même le baptême ! Gommence-t-on à
voir clair? Les libéraux devènus répu
blicains ne sont bons qu'à tuer tout
cela ; voilà cent ans que leur secte y
travaille, et dès à présent le mal serait
sans remède s'ils n'avaient l'habitude,
à laquelle ils ne manqueront pas, de
se tuer eux-mêmes. Mais par la grâce
de Dieu, sans le savoir, ils donnent
aux catholiques un bon baptême, le
baptême du sang. On leur dit : Je suis
prêt, vous l'êtes, voilà votre guillotiné,
qui empêche que je sois baptisé? Etilis
baptisent bêtement, mais validement.
Car ils ne sont pas forts, mais on ne
peut contester qu'ils ne soient sots et
un peu au-dessous de l'ordinaire hu
main; Qu'on veuille être baptisé par
eux, on le sera toujours, et c'est assez
pour vivre;
Une autre preuve que ce n'est pas
moi qui ai fourni à M. de Montalem
bert, et par suite à M. Jules Ferry, la
matière de ce résumé, c'est. qu'après
m'avoir fait parler du principe des. li
béraux, on me fait supposer la ma
nière dont les catholiques doivent se
conduire lorsqu'ils sont au pouvoir.
Les rédacteurs de l'Univers^ n'ont ja
mais eu beaucoup à réfléchir sur cette
éventualité; le temps de notre pouvoir
ne nous a jamais paru prochain. En
quarante ans, personne du petit groupe
au milieu duquel on a pu nous^ attri
buer quelque action, n'a eu un instant
de popularité, ni d'aspiration à rien
qui puisse y ressembler. Nous sommes
restés dans notre médiocre et miséra
ble condition de fidèles catholiques, et
nous espérons n'avoir rien fait ni rien
dit qui pût montrer en nous la moin
dre tentation d'en sortir, par quelque
porte que ce fût. Dans .notre parti,
c'est une habitude prise, et comme un
double sceau d'origine et de destinée.
On le sait si bien, qu'un homme qui
veut être aux affaires, si peu que ce
soit, cesse d'abord un peu d'être de
nos amis. Que de sous-préfets et de
substituts dont nous avons perdu les
complaisances, avant même de leur
donner congé ! U y a presque une ini
mitié naturelle entre l'Univers et les bu
reaux de tabac. Si on a pu voir quel-:
ques idées contraires chez quelques
catholiques, ils étaient libéraux; ils
flattaient les libéraux, ils tournaient à
la liberté des libéraux, ét ne refu
saient pas de lui donner des arrhes.
Chez nous, rien qui témoigne d'un dé
sir quelconque de parvenir aux gran
des destinées d'un Spuller ou d'uij
Jules Ferry.
Quand M. da Montalembert, séduit
par ses idées plus que par son carac
tère,. s'annonça libéral et rêva la po
pularité, ce nè fut pas son meilleur
moment; mais il eut beau faire, la
force de. ses convictions et la hauteur
de son âme le retinrent encore parmi
ceux qu'il abjurait. Il ne put, grâces a
Dieu, franchir les derniers échelons
qui devaient le séparer de nous ; ce
qu'il avait à faire pour parvenir au
pouvoir, il ne l'aurait jamais fait. Il
n'arriva qu'à l'Académie, ce qui est
beaucoup sans doute, mais ce qui est
encore innocent.
Quant à moi, protégé par l'humilité
de ma condition ét par, la bassesse de
que je ne în'y : tiendrais pas, et que
n'ayant point l'ambition de gouverner
le monde, je ne saurais pas mentir. Je
me suis borné toute ma vie à essayer
dé donner à quelques-uns de mes con
temporains l'amour de la liberté et à
leur en faire comprendre lés condi
tions. Je ne mé suis jamais occupé de;
ce que je saurais faire de moi-même '
lorsque je serais au pouvoir, ou lors
que mes amis s'y verraient. II y a une
loi de Dieu qui dicte cela aux plus pe-"
tits comme aux plus grands, et des
conseils de l'Eglise qui en règlent la
pratique. M. Ferry voudra bien remar
quer que je n'ai jamais eu l'imperti
nence dè m'offrir au suffrage univer
sel, ni de lui soumettre une profession
de foi quelconque, ni permis à l'im
pertinence d'aucun suffrage de s'oc
cuper de moi. J'ai simplement dé
fendu la vérité, sans forcer ni flatter
personne.
Gela dit, je cherche très sincèrement
ce que M. de Montalembert et ses amis
d'abord, et ensuite M. Ferry et les
siens, peuvent trouver de si extraor
dinaire et de si effronté au fond de
l'opinion qu'ils m'attribuent dans des
formes si brutales. Ce, n'est, en défi
nitive, que l'opinion de tout le monde.
Tout le monde, — du moins tous les
honnêtes gens, -r- réclame avec les li
béraux la liberté de tout le monde, qui
est d'aller, de venir et de parler comme
tout le monde; et tout le monde aussi
condamne et refuse avec les catholi
ques la liberté de mentir, de voler et
d'assassiner tout le monde. C'est vieux
et admis comme le bon sens.
Je vous demande pardon d'en dire si
long sur une billevesée catholique-li
bérale ramassée par M. Jules Ferry,
qui en a fait la partie brillante et pro
bante de son discours contre, la liberté
d'enseignement.
Louis Veuillot.
• ; . . — ^ ■
loi existante, dont M. le maire, lui-mê
me, en sa qualité, doit être le'jjremieri
à faire respecter le caractère tant
qu'elle ne sera pas abrogée. Mais à
quoi bon discuter avec M. le maire de
Rousset? .11 s'en réfère à ce que lui
diront les '«autorités supérieures.»
Nous ne-sommes pas moins curieux
de l'apprendre, et il devrait bien,
quand il aura leur réponse, nous faire
savoir .si les. autorités supérieures
ayant examiné la protestation lui don
neront enfin licence de légaliser les
signatures « y apposées dessus. »
Auguste Rousskl.
Nous faisons parvenir aujourd'hui
au Sénat une nouvelle série de 18,285
signatures, preuve nouvelle que le
mouvement, comme nous l'espérions,
s'accentue au lieu de se ralentir. Ce
matin même nous avons reçu d'autres
pétitions en grand nombre, que nous
ferons déposer demain et les jours sui
vants. En même temps nous prions
les signataires de joindre à leurs pé
titions toutes : les pièces destinées à
faire constater le mauvais vouloir ou
le refus des maires en ce qui concerne
la légalisation des signatures. L'une
des plus curieuses en ce genre, c'est
certainement celle qui nous est adres-r
sée des Bouches-du-Rhône. Le maire
de Rousset écrit à un pétitionnaire ;
Monsieur,
Après avoir lu attentivement votre pro
testation pour envoyer au Sénat et à l'As
semblée nationale, il m'est impossible de
pouvoir môme légaliser les êignatures y
apposées dessus, avant de m'ôtre adressé
aux autorités supérieures, vu que cette pro
testation est contre le projet du ministère ac
tuel.
Recevez, etc.
On voit qu'en fait de droit de péti
tion M. le maire de Rousset a des
théories étranges. Ainsi, le seul fait
que la protestation vise un projet mi
nistériel suffirait, à ses yeux, pour
motiver un refus de légaliser les signa-
: tures? M. le maire, si attentivement
qu'il ait lu la protestation, n'a oublié
qu'une chose, c'est que si elle vise un
projet ministériel, elle demande d'au
tre part le respect et le maintien d'une
amendement tendant à la création d'un jury
professionnel désigné par le conseil supé
rieur de l'instruction publique, et devant le
quel les aspirants auraient à subir un exa
men professionnel.
L'orateur a développé son amendement
en termes excellents et souvent éloquents ;
blique, M: Boyer et ses amis, voyant qu'il
|.n'y avait rien à espérer de l'armée révolu
tionnaire, conduite et excitée par M. Wad-
diogton, ont retiré leur amendement, et mis
fin à la discussion et à la séance.
Il ne reste plus qu'un amendement à dis
cuter, celui dé M. Raoul Duval. Il le sera
mais il avait trop raison pour qu'on l'enten-1 demain ; mais âl aura le même sort que
dît. Aussi ne l'a t-on point écouté. II y a eu | celui de M. Boyer. La £
On lit dans le Journal officiel :
M. Plichon, député du Nord, a déposé une pé
tition de plusieurs habitants de Maubeuge
(Nord).
M. le comté Le Gonidec de Traissau, député
d'Ille-et-Vilaine, a déposé sept pétitions signées
par un grand nopibre d'habitants des départe
ments d'Ille-et-Vilaine et d8 lîÀude.
M. de Largentave, député des Çôtes-du-Nprd,
à déposé trois pétitions signées par un grand
nombre d'habitants de Saint-Jouan,'Lihon et La
Vicomté (Côtes-du-Nord). • .
M. le vicomte de Ghambrun, député de la Lo
zère, a déposé une pétition signée par un grand
nombre d'habitants de la commune de Luc (Lo
zère). ,
M. le marquis de Partz, député du Pas-de-Ca
lais, a déposé :
1° Une pétition signée par 43 habitants de la
commune de Pierremont (Pas-de-Calais);
. 2° Des pétitions signées par 719 habitants des
départements du Nord et du Pas-de-Calais.
M. Cazeaux, dépuié des Hautes-Pyrénées, a
déposé une. pétition de plusieurs habitants de:
Recurt (Hsuies-Pyrénées). ■ • .
MM. de La Rochette et H. de La Billiais, dé
putés de la Leire-Inférieure, ont déposé 10 péti
tions revêtues de 891 signatures, toutes légali
sées, d'habitants des communes de Bouquenais,
Assefz, Saint-Léger, la Chapelle-Launay, Gros-
sac, Plessé, Plessé-Coudray, Maisdon, et Sion
(Loire-Inférieure).
M. Relier, député du Haut-Rhin, a déposé des
pétitions signées par 276 habitants du départe
ment de là Lozère.
Ces pétitions sont relatives à l'ensei
gnement supérieur.
On lit dans le Temps :
Il n'y a pas eu Mer (à proprement parler)
de conseil dès ministres, mais une" simple!
réunion de ministres dans laquelle M. de
Marcère, ministre de l'intérieur, a exprimé
à ses collègues le regret de voir que les par
tis dits conservateurs n'avaient tenu aucun
compte de la modération et des idées conci
liantes qu'il avait apportées dans le choix;
des fonctionnaires lors du mouvement ad
ministratif.
En conséquence, M. le ministre de l'inté
rieur a demandé à ses collègues, qui étaient
tous présents, d'avoir à l'avenir la plus en
tière liberté pour choisir le personnel admi
nistratif parmi les citoyens ouvertement
ralliés J&. la forme actuelle du gouverne
ment. , :
M. le garde des sceaux et tous les mi
nistres ont approuvé la iigne de conduite
qu'entend tenir à l'avenir M. de Marcère.
Si le Temps est bien informé, voilà
M. le président du conseil réduit au
rôle de sous-Marcère; nous l'aurions
cru plus fier.
La Presse confirme les informations
du Temps , dont Y Echo universel , autre
officieux, reproduit la note sans en in
diquer la provenance.
On nous écrit de Versailles, le
6 juin :
Après le vote de samedi prononçant la
clôture de la discussion générale, il était
aisé de voir que la majorité républicaine
attendait avec impatience l'héiire. où elle
pourrait enfin décapiter la loi sur l'ensei
gnement supérieur.. Néanmoins, M. Ferdi
nand Boyer est venu tenter un dernier ef
fort pour la sauver. Répondant à l'argu
ment de ceux qui pensent que l'Etat doit
exiger des garanties des jeunes gens qui
voudront se livrer à une profession libérale
privilégiée pour laquelle les grades sont
' m * t * 1 - 1 ' n «tinrirtoi nn
exigés, M. Ferdinand Boyer a proposé un
un moment cependant où sa voix, prenant
subitement de la force et.de l'étendue, a
adjuré la Chambre de ne point condamner
une loi qui n'a pas encore vécu. En tout au
tre lieu, l'argument du député de Nîmes
eût eu quelque chance de succès; mais ici
il n'en avait aucune. Sous la Convention,
dont on nous a fait encore aujourd'hui l'é
loge, la révolution émancipait les jeunes
tilles, — des enfants! — pour pouvoir les
guillotiner. Aujourd'hui, sous la Législa
tive, dont le suffrage dit universel nous a
dotés, elle émancipe les lois pour les décapi
ter. ; Celle de 4875 sur la liberté d'enseigne
ment n'a pas encore vécu, n'a fait aucun
acte bon ou mauvais,n'importe:elle trouble
l'eau de messire loup, elle est condamnée
à être dévorée. :
Messire loup no nous l'a point laissé
ignorer. Il nous l'a déclaré dans la per
sonne du citoyen Laussedat, qui a, ou peu
s'en faut, le physique de l'emploi. Nous au
rons la liberté et l'enseignement comme
sous la Convention. La liberté qu'a donnée
« cette grande Assemblée », chacun la con
naît ; quant à son enseignement, enseigne
ment- supérieur, secondaire et primaire, on
le connaît moins. Si,l'on s'en rapportait au
citoyen Laussedat, - qui a lu cela dans quel
que brochure jacobine, l'instruction aurait
été très florissante sous la.Convention. « Il
ne faut pas oublier, s'est-il écrié, qu'elle a
fondé de grands établissements à tous les
degrés. » Et il a cité l'école polytechnique,
les écoles centrales, l'école normale, l'école
des arts et métiers, etc.. Il est très vrai
que ces écoles ont existé ; mais si le
citoyen Laussedat avait lu autre chose
que des brochures sur ce qu'il appelle
à pleine bouche « la grande Assem
blée »; s'il avait lu non pas des histoires
écrites par des adversaires ou des apolo
gistes, mais l'histoire que la Convention a
écrite elle-même et qui se trouve.au Moni
teur^ il aurait vu que ces établissements
n'ont existé que sur le papier, qu'ils n',eu-
rent ni livres, ni professeurs, ni élèves;
que tout cela n'était, selon l'expression du
citoyen Romme, que «l'étalage d'un vain
charlatanisme », et qu'il n'y avait plus
en France ni enseignement primaire ni
école secondaire quand la Terreur s'é-
ventra de ses propres mains et tomba
noyée dans son sang. Et ce qui est non
moins vrai, c'est que ce fut l'Eglise qui eut
alors, comme elle l'a toujours eue, la plus
large part dans la résurrection de notre en
seignement public en général, et de l'ensei
gnement primaire en particulier.
Après la déclaration du citoyen Lausse
dat, il n'y avait plus rien à dire ; cependant
M. Estignard a eu le courage de monter à
la tribune et de plaider une dernière fois,
devant la majorité républicaine et libérale,
la cause de la liberté ! Il l'a fait avec une
force et une énergie qui ont d'autant plus
irrité les républicains que l'orateur avait
un instant penché de leur cô!é. Plusieurs
■fois, pour mettre fin aux traits mordants et
•incisifs qu'il leur décochait, ils ont tenté de
■ lui faire enlever la parole par M. le prési-
-dent. Mais celui-ci, trouvant sans doute ce
procédé un peu trop jacobin, n'a pas cette
fois obtempéré au désir de ces messieurs.
En sorte que M. Estignard a pu terminer
son discours et lancer cette dernière flèche
-à ses adversaires furieux : « Parmi lés li
bertés dont M. Laussedat parlait tout à
l'heure, on a oublié la liberté des cabarets.
La Chambre la votera bientôt. Mais il est
permis de préférer la liberté qui moralise
•à la liberté qui abrutit. »
En présence de l'attitude de la majorité
républicaine et libérale, en présence des dé
clarations faites au nom de la commission
par M. Barni, déclarations fort injurieuses
pour le conseil supérieur de l'instruction pu-
. gauche ni la droite
ne le voteront, quoique pour des liaisons
différentes.
On lit dans le Constitutionnel :
Le débat sur la pension àaccorderàMme
Ricard sera vif assurément.
Une loi a prévu le cas de telles pensions;
mais elle demande qu'il soit établi que la .
mort du ministre en activité soit le triste
effet d'une maladie contractée au service de
l'Etat, - c'est-à-dire dans l'exercice des fonc
tions publiques. - ■'
C'est à l'aide de cette loi qu'un certain
nombre de fonctionnaires de l'empire ont
obtenu ces pensions fameuses, qui eurent
la vertu d'horripiler si étrangement M.
John Lemoinne.
Pour aujourd'hui, ce que nous tenons à
dire, c'est que les bruits les moins fondés
ont été mis en circulation sur l'état de for
tune de feu M. Ricard.
Un journal a prétendu que la dot da sa
femme s'élevait à 400,000 francs, et que
cette dot était intacte à cette heure.
Nous.tenons; nous, d'une source absolu
ment certaine que la dot de Mme. Ricard a
été de 70,000 fr., sans un centime de plus.
Elle reste avec trois enfants ; et la succes
sion de son'inari est onérée et onéreuse.
Ces détails sont pénibles et délicats à di
vulguer ; mais nous estimons qu'un journal
a l'obligation de communiquer au public
tout ce qui parvient à sa connaissance.
Une fois dans cette voie de révélations
intimes, nous irons plus loin.
Nous attirerons instamment l'attention
des Chambres et du gouvernement sur la
situation de Mme de Goulard.
Elle est digne d'intérêt, pour ne rien dire
de plus.
Ur, M. de Goulard fut trois fois ministre.
Il débuta sous Louis-Philippe, en qualité
de sous-secrétaire d'Etat. Il eut un rôle
actif et éminent dans les pénibles négocia
tions qui amenèrent la paix de 1871 avec
l'Allemegne.
Enfin, il serait temps aussi que les pou
voirs publics portassent un regard d'agis
sante sympathie sur la fille aînée du grand
capitaine e t du grand citoyen qui s'appela la
maréchal Bugeaud.
C'est Mme Gasson ; elle est retirée à
Sarlat. Nous n'en disons .pas davan
tage.
A entrer trop avant dans le secret de ces
douloureuses destinées et de ces cruels
abandons, on s'exposerait à froisser les lé
gitimes fiertés d'une conscience et d'une
résignation héroïques.
Nous tenons volontiers le Constitu
tionnel pour bien informé au sujet de
Mme Ricard, et, comme lui, nous
trouvons ces sortes de discussions
fort pénibles. Cependant, un journal
n'est pas libre de les écarter. Il faut
donc dire que le très court passage
de M. Ricard au ministère de l'inté
rieur ne donne pas à si veuve et à ses
enfants le moindre droit à une pen
sion. Quant à une « récompense natio
nale », il est à la fois impertinent et
ridicule d'en parler.
Le parti républicain veut que Mme
Ricard ait une pension, parce que M.
Ricard, après avoir été un des com
missaires du 4 septembre et l'un des
plus passionnés, puisqu'il a porté la
main s.ur la magistrature, s'est mis,
comme ministre, au service de la ré
volution. Il s'agit donc de récompenser
des opinions et de poser en fait le droit
des républicains, non-seulement à vi
vre du budget, mais à en faire vivre
les leurs.
Si M. Ricard était mort après ses
échecs électoraux, les titres dé sa
veuve à une pension eussent été les
mêmes, c'est-à-dire nuls, et personne,
si modeste que fût sa situation finan
cière, n'aurait songé à la doter aux
FEUILLETON DE L 'UNIVERS
DU 8 juin
BEAUX-ARTS
SALON DE 1876
Cinquième article. — Voir les n"® des 7, 14,
23 et 30 mai.
Il y a tant de jolis petits tableaux à
l'Exposition, qu'en revenant du palais des
Champs-Elysées au logis, nous sommes
toujours .tenté de rendre compte des ta
bleaux de genre ou de» paysages, au lieu
de continuer l'examen des sujets graves
et de traiter de la grande peinture, Mais il
nous faut résister à la tentation, ne vou
lant rien négliger de ce qui peut contribuer
à encourager ceux qui cultivent l'art sér
riéux. Si leurs tentatives plus ou moins
heureuses n'obtiennent pas au Salon un
grand succès, elles ne sont pas moins loua
bles et souvent même fort recommanda-
bles, vu la très grande difficulté que pré
sentent les. sujets qu'ils abordent et qu'ils
surmonté quelquefois. • - -
Nous signalerons d'abord plusieurs artis
tes qui se sont rencontrés en prenant pour
sujet la Pieta. Nous en avons compté cinq;
avec M. Bouguereau, dont nous avons déjà
parlé, cela fait six. C'est un groupe, et,
chose singulière, depuis le temps que l'on
dit : c'est fini ! et en dépit des cuistres rou- j
ges,-l'es anges, les saints, la Pieta, et tout
ce qui touche, comme dit le Siècle, « aux !
idées d'Eglise », reparaît toujours: l'art
moderne ne peut pas se décider à devenir
renégat.
Des quatre artistes en question, M.'Hen-
ner est assurément le plus habile à manier
la couleur et le pinceau. En cela son ta
bleau est de beaucoup supérieur aux au-,
très, mais c'est aussi le moins bien com
posé. M. .Henner a tout sacrifié à un effet
lumineux et au développement d'un torse
et d'un bras, mais c'est à peine si son 1
Christ a dos jambes, et quant à la Vierge
et aux têtes à demi coupées qui se profilent
sur un fond noir, il n'en faut pas parler :
elles ne sont autour dii Christ mort qu'afin
d'accentuer à outrance le contraste des car
nations. Ilyadeux ans, M.Lévy avait exposé
un sujet analogue, mais il y avait dans son
tableau plus de composition, plus de sens
poétique... sans qu'il y eût moins d'effet, et
la couleur brillait surtout par l'absence de
ce blanc et de ce noir intenses dont M.
Henner a abusé.
M. Gabriel de Cool et M. Royer Lionnel
ont aussi fait leur Pista de grandeur natu
relle, mais ils n'ont pas pris leur sujet pour
en faire seulement, un thème de coloriste:
ils ont respecté, autant qu'il leur a'été pos
sible, la tradition et ils ont fait tous leurs
efforts pour peindre un beau Christ mort et
une Mater dolorosa expressive. L'intention,
du moins, est assez marquée pour qu'il n'y
ait pas à s'y méprendre, et c'est déjà beau
coup.
M. de Cool est celui qui semble avoir dé
jà acquis le plus .d'expérience, sans être
toujours d'une correction irréprochable ; son
dessin est plus souple, et son coloris plus
varié et plus harmonieux qu'ils ne sont dans
le tableau de M. Royer-Lionel. Cependant,
malgré la rigidité des.formes et malgré l'u
niformité quelque peu primitive de sa colo
ration, le tableau de M. Royer-Lionel est
celui dont le premier jet est le meilleur. Le
reste viendra avec le temps.
Où en sommes-nous? A la cinquième
Pieta. C'est à faire prendre le mors aux
dents aux croque-morts et aux pleureurs
des citoyens Esquiros et Michelet. Oui,
cinquième Pieta; mais il faut bien l'avouer,
cette fois-ci l'enfantement a été laborieux.
M. Urbain Bourgeois s'est trop appliqué à
ne pas faire comme les autres : il a épar
pillé ce qu'il devait grouper ; il a placé la
Vierge d'un côté, deux anges de l'autre, et
ces anges, dévotement agenouillés.au pied
d'une croix dont le sommet est perdu dans
le cadre, ne songent nullement à se dépla
cer, soit pour se rapprocher du Divin Cru
cifié, Boit pour assister sa mère. Tous les
personnages font bande à part. Le corps
du Christ, étendu et isolé sur le premier
plan, ne semble avoir aucun rapport avec
les autres figures, et, vraiment, il serait à
souhaiter qu'il en fût encore plus séparé et
qu'il ne restât de tout le tableau que la tête
de ce Christ mort, que- nous signalons
comme étant l'un des plus beaux morceaux
de peinture qui ' soient à l'Exposition. —
C'est assez dire pour montrer , que M
Urbain Bourgeois .n'est pas le premier
venu, et pour constater le soin que nous
mettons à ne rien omettre de ce qui
peut être loué. Aussi ne pouvons-nous
nous dispenser de mentionner le ta
bleau de M. Bruno Cherier. La Sainte
Vierge repoussée de l'hôtellerie et. réduite à se
réfugier dans l'étable de Bethléem. C'est là
une composition sagement conçue et ingé
nieusement développée, à cela près qu'au '
lieu de voir une femme sèche et criarde,;
nous dirions presque une furie sur le seuil ;
dé l'hôtellerie, nous aurions préféré y voir
l'hôtelier en personne ou son valet.
Le jeune David , de M. Joseph Ferrier, a
beaucoup de nerf, et le corps de son Go
liath est celui d'un géant taillé et propor
tionné comme il convient pour bien établir:
le contraste. L'agencement des deux figures
est parfait : il semble que le corps de Go-
liath étendu et vu en raccourci contribue à
agrandir les deux personnages tout en con
servant leurs proportions relatives. Le des
sin est souple et vigoureux, l'action est
vive, mais par malheur les têtes sont d'un
caractère outré et vulgaire, et l'expression
du jeune vainqueur de Goliath rappelle
moins David qu'elle ne fait songer à nos
héros dè barricades.
Voici encore un petit Saint' Jean-Baptiste
qui n'est autre qu'un modèle d'atelier très
reconnaissable, encore qu'il soit ici coiffé
d'une auréole d'or, laquelle se découpe
comme un plat de métal sur un fond azuré.
Mais au moins l'étude du petit garçon est
remarquablement dessinée et peinte, et,
bien que M. Perrault soit élève de M. Bou
guereau, M. Perrault prend son temps, voit
bien la forme etla fixe sur sa toile sans abu
ser des reflets ni du blaireau. L'on conçoit
qu'il se soit plu à décorer une si belle étude
d'un beau titre, et c'est pourquoi il a donné
à. celle-ci le titre de Saint Jean précurseur.
Tout près de là nous voyons encore une au
tre figure qui n'est pas moins parfaite et
qui a nom YOracle des Champs. Ce nom est
joli, mais la figure de jeune fille vêtue d'une
robe blanche et dont le profil éclairé par
les reflets de l'aurore se détache sur un
ciel sans nuage est encore plus gracieuse
et plus aimable que son nom. Elle tient
dans sa main et près de sa bouche une tige
surmontée 1 d'une aigrette velue sur la-j
quelle elle souffle, et dont les brins légers
s'échappent au vent. Les enfants donnent à
cette graine un vilain nom, et comme nous
n'en savons pas plus long là-dessus que les
enfants; nous voulons " croire que M. Per- ;
rault connaît mieux ou comprend davan- ;
tage le sens des oracles champêtres. Tou
jours est-il que son idylle est tout ce que
l'on peut voir de plus charmant, de plus -va
poreux, et en même temps de plus saisissa-
ble quant à la forme. Mais quant au fond,
il serait à souhaiter qu'un artiste doué d'un
talent réel s'appliquât à traiter de vrais su
jets et qu'il se délivre des imaginations,
trop vaporeuses.
Maintenant, parlons un peu des peintu
res de M. Puvis de Chavannes, exposées
sur le palier du grand espalier, et devant
lesquelles tout le monde passe, non pas sans
sans les voir, c'est si gros ! mais s'y arrê
ter, car c'est si vite vu ! Pourtant ces pein
tures ont opéré un véritable prodige. Tous
les critiques sont tombés en admiration,
non pas instantanément sur le palier, du
grand escalier, mais seulement en rentrant
chez eux et en se retrouvant la plume à la
main en présence de leur écritoire. Ils ont
tous été ravis en extase ; tous ont célébré
à l'unisson VInvention de Sainte-Geneviève
par saint Germain l'Auxerrois , le bûcheron!
demi-nu, le fagot, l'embarcation, la femme
occupée à traire le pis gonflé d'une vache,
et, surtout, l'attelage des ânes. Ces ânes leur
ont paru simples, les vaches sublimes, le
fagot flamboyant, et alors, l'un d'eux ne
pouvant se contenir, s'est écrié : « Non,
elle n'est pas morte, la sentez-vous, l'âme
ardente et fière dè la France ! elle s'inter
rogo, elle se reconnaît, elle est vivante!
Certes, à Dieu ne plaise que nous osions
contredire des feuilletonistes exaltés à ce
point, nous qui n'avons à la main qu'un
simple bout d'aile trempé -dans l'encre de la
petite vertu, et point d'extase. Mais parlons
raison et laissçns pour l'instant l'âme ar
dente et Gère de la France. Il s'agit de l'ex
position et des peintures de M. Puvis de
Chavannes, ce n'est pas le cas de s'enflam
mer; nous ajouterons même, à tout risque,
qu'il faut se méfier des journalistes en
thousiastes et particulièrement de celui que
nous venons d'entendre et que nous cite
rons encore : il est si glorieux I L'on sait
que M. Puvis de Chavannes n'hésite pas à
mettre des portraits de -journalistes en
vogue dans ses tableaux Nous en avons
vus plusieurs, entre autres Théophile Gau
tier, lequel figurait en pied, en toge et en
cothurpes dans le cloître de Sainte-Rade-
gonde.
Ne pourrait-on supposer que le feuilleto
niste auquel nous venons de faire allusion
est peint quelque part et qu'il se flatte de
passer au Panthéon dans les fresques nou
velles ? h - Ce n'est pas parmi les bûcherons
ni au travers du bétail cornu qu'il faut cher
cher son nez ; non, mais il se pourrait fort
bien que ce nez prodigieux soit sous la mitre"
du saint Germain que M. Puvis a inventé.
Cette mitre entr'ouverte n'èmpêche pas dé
voir très bien que le sommet de la tête est
absolument déprimé; dans ce cas, où est
passée la cervelle ? — La cervelle ? elle a dû
tomber dans les fosses nasales du person
nage, et c'est pourquoi son nez a tant de
proéminence.
N'importe, c'est une gageure soutenue
par tous ces messieurs : il faut que le pu
blic avale toutes ces énormités. Il faut por-
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 80.19%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 80.19%.
- Collections numériques similaires Hugo Victor Hugo Victor /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Hugo Victor" or dc.contributor adj "Hugo Victor")La Esmeralda : opéra en 4 actes / musique de Mlle Louise Bertin ; paroles de M. Victor Hugo... ; représenté pour la première fois sur le théâtre de l'Académie royale de musique, le 14 novembre 1836 /ark:/12148/bpt6k1912403v.highres Théâtre de Victor Hugo,.... Première série /ark:/12148/bd6t5773929t.highres
- Auteurs similaires Hugo Victor Hugo Victor /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Hugo Victor" or dc.contributor adj "Hugo Victor")La Esmeralda : opéra en 4 actes / musique de Mlle Louise Bertin ; paroles de M. Victor Hugo... ; représenté pour la première fois sur le théâtre de l'Académie royale de musique, le 14 novembre 1836 /ark:/12148/bpt6k1912403v.highres Théâtre de Victor Hugo,.... Première série /ark:/12148/bd6t5773929t.highres
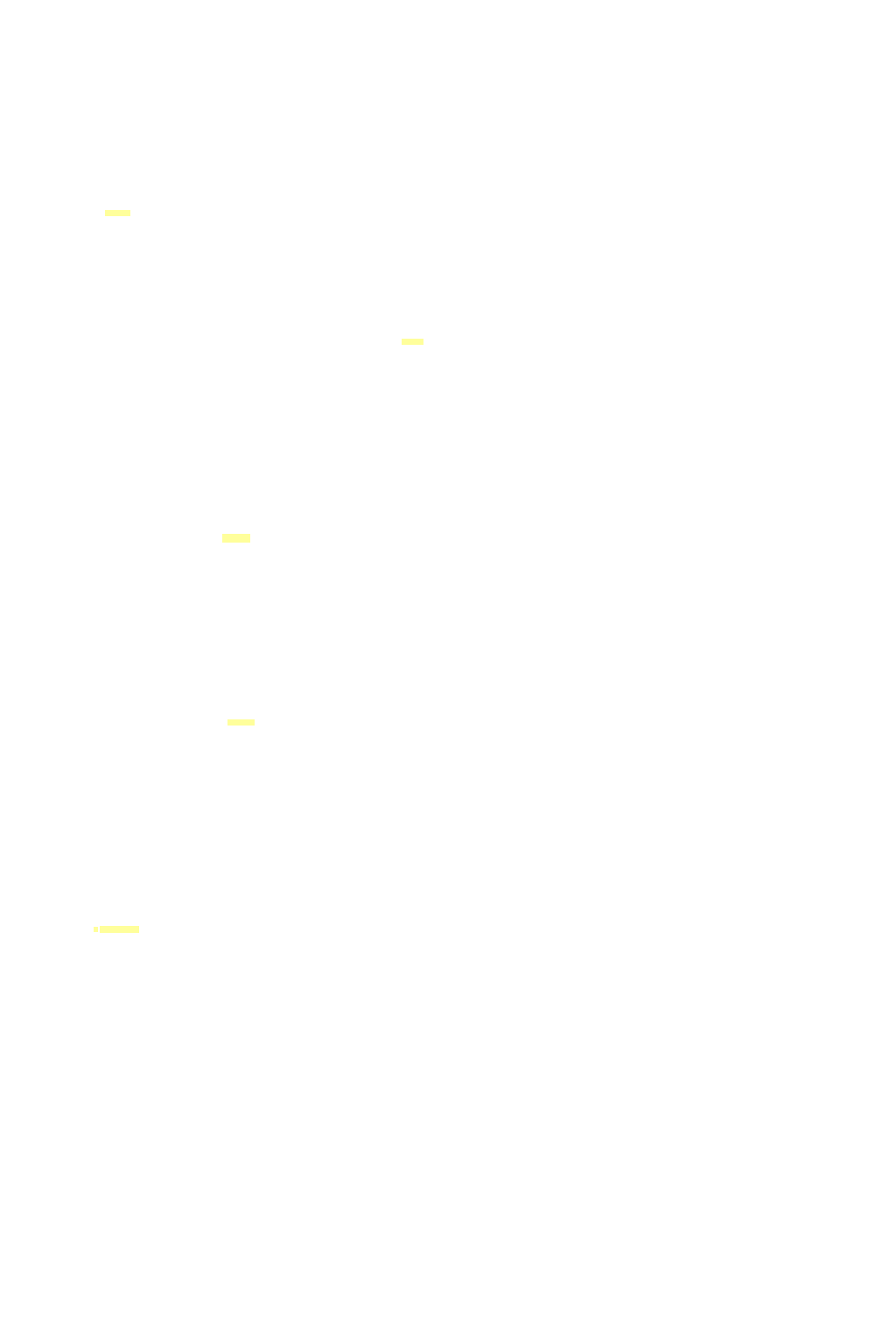
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k700447p/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k700447p/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k700447p/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k700447p/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k700447p
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k700447p
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k700447p/f1.image × Aide




Facebook
Twitter
Pinterest