SAFRE -*■ SAIETTERIE
872
doré avec des jacinthes, de pétis safis, des perles, etc. »
(Irivmit. de GabrkUe ctEstrées, 1599.) Enfin, Loret écrivait
encore, à la date du 28 avril 1658 (voir Muze historique,
t. II, liv. IX, lettre 16), qu'il avait gagné à la loterie :
TJn salir d'importance,
Non des plus beaux qui soient en Erance,
Mais par quelques-uns estimé
A trente escus...-
Safre, s. m. — Oxyde de cobalt noirâtre pulvérulent
qui, mêlé à des cailloux rougis au feu et broyés, sert à faire
du verre bleu et à contrefaire le saphir. Par extension,
nom donné au verre coloré avec du safre. ce 24 décembre
1755 — Mme de Pompadour : Un gobelet couvert, [de]
safre camayeux, 54 livres. » (Livre journal de Lazare
Duvaux, t. Il, p.v266.) Le safre devint, à la fin du siècle
dernier, l'objet d'un important commerce en France, quand
on fabriqua ces jolies salières et ces moutardiers en cristal
bien, qui furent alors si fort à la mode ; aussi, s'en éta-
blit-il des manufactures, et l'on commença de fabriquer
chez nous cette substance que, jusque-là, on avait tirée
d'Allemagne.
On lit, à ce propos, dans les Annonces, affiches et avis
divers du 17 avril 1787 : ce La manufacture royale de
safre et d'azur des Pyrénées françoises vient d'établir,
en vertu d'un arrêt du Conseil du 5 décembre 1786,
un dépôt général chez le sieur Roëmich, contrôleur de
ladite manufacture, rue de Provence, au coin de la rue
Montmartre. Les négocians qui voudront de ces couleurs,
ajoute cette réolame, .en trouveront depuis un feu jusqu'à
cinq, à des prix inférieurs à ceux que l'étranger met aux
"siennes... »
Sagatis, s. m.pi. — Tissu croisé uni, fait de laine pei-
gnée, avec chaîne blanche et trame de couleur, et glacé par
le calandrage. L'armure est le sergé de quatre par moitié.
La largeur est de 75 centimètres. C'est une imitation
d'une étoffe anglaise qui a eu une grande vogue, il y a
cent ans, et que l'on a beaucoup exportée pour l'Espagne.
Elle est abandonnée aujourd'hui. Cette fabrication a
toujours été localisée à Amiens. Les sagatis étaient em-
ployés pour les rideaux. Le Journal général de France du
18 mai 1787 mentionne une ce Arente d'étoffes à la pointe
Saint-Eustachc » où figuraient des ce sagatis anglois, éter-
nelles, etc. » C'est la première mention que nous ayons
rencontrée de cette étoffe.
Saget, s. m. — Locution bordelaise. Sceau, cachet.
« En una petita brustra (coffret) lo son saget d'argent. »
(Invent, de Ramona de Cussac, chanoine de Saint-André;
Bordeaux, 1442.)
Sague, s. m.; Saguin, s. m.; Saigue, s. m.; Soigue, s. m.
— Locution bordelaise et provençale. Cuir préparé et
gaufré,-qui servait surtout à couvrir les sièges, ce Plus
huiet chères garnies de sague. » (Invent, du docteur Nicolas
Lallemagnc; Bollène, 1668.) ce Quatre chaises garnies de
saigne. — Onze chaises à la capucine, bois peint en rouge,
garnies de saigùe. » (Invent, du cardinal de Bélzunce;
Marseille, 1745.) ce Une chaise demi-commodité bois blanc,
garnie de soigue usée. — Une inquiétude bois de saule,
garnie de soigue. » (Apposition des scelles chez J.-B. Au-
dier, courtier royal'; Marseille, 1755.) ce Quatre chaises de
saules, garnies de soigue. » (Invent, de Catherine Powjard;
Marseille, 1760.) ce Deux chaises à la capucine, vieilles,
garnies de soigue. » (Invent, d!Andrè-BartMlemy Salade;
Marseille, 1779.) Dans le Bordelais, on disait saguin.
Saie, s. /. — Orthographe ancienne de SOIE. On lit
dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau, au titre xm
ce des cordiers de Paris » : « Nus-cordier ne puet ne ne
doit nule corde faire de quelque manière que ele soit, que
ele ne soit faite toute de 1 étoffe, c'est assavoir : ou toute
de teil, ou toute de chanvre, ou tonte de lin, ou toute de
saie... » Dans les Comptes relatifs au couronnement de la
reine Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Lon»
(Reims, ]316), nous relevons la mention suivante : ce Pour
VICLXI papeillon, faiz de broudeure, les belles (ailes) des
armes le comte de Bourgongne, pour l'or de quoy ils furent
brodez pour saie et pour façon, vi sols vi deniers pour
pièce, valent n°xiv livres xvi sols vi deniers. » C'est
aussi le nom qu'on donnait, en Picardie, à une sorte de
taffetas ou de serge de soie, qu'on a, depuis, appelé SAYE
ou SAIBTTE.
SAIE est encore le nom d'une petite brosse de poils de
porc, dont les orfèvres font usage pour nettoyer les pièces
d'argenterie.
Saiette, s.f; Sayette, s. f. — Dans le principe, tissu
de soie léger qu'on tirait d'Italie. Plus tard, on donna ce
nom à une petite étoffe de laine, mêlée' quelquefois d'un
peu de soie, qu'on fabriquait à Amiens, et qui faisait l'objet
d'un grand commerce. On on-confectionnait des tentures
de chambre et des rideaux. Cette industrie portait elle-
même le nom de saictteric. Au xv° et. an xvic siècle, on
écrivait sayette. ce Façon et estoffe de- brodurode deux
chambres de sayette, l'une rouge et l'autre verde. » (Compte
de Simon Longin, receveur général des'jinanccs de Maximi-
lien et de Varchiduc Philippe, 1494.) ce Pour quatre rid-
deaulx de lict.de sayette rouge et vert... » (Comptes de
l'argenterie d'Anne de Bretagne, 1496.)
Saietterie, s.f.; Sayetterie, s.f. — Nom sous lequel
on désignait autrefois la fabrication des étoffes de laine
mêlée de soie ou de poil de chèvre, établie en Flandre et
en Picardie. Piganiol de la Force (Nouvelle description de
la France, t, III, p. 183), parlant de cette dernière pro-
vince, écrit : ce Les manufactures et fabriques occupent et
font subsister un grand nombre de personnes de tout sexe
et de tout lige, à la ville et à la campagne. La principale
fabrique est appollée sayeterie; parce que le fil fait de sayette
ou de laine peignée et filée au petit rouet fait seule la chaîne
de ces étoffes qu'on appelle serge de Crève-coeur, d'Aumale,
bouracans, camelots, raz de Cônes, raz façon de Cliâlons,
serges façon de Nismes, serges façon de Seigneur, qui sont
toutes de pure laine. On en fait encore plusieurs autres ou
la laine est employée avec la soye, le fil de lin et le poil de
chèvre, telles sont les camelots façon de Bruxelles, les
pluches, raz de Gênes avec un fil de soye tord autour de la
chaîne, étamines façons du Mans et du Lude. Ces dernières
ne sont façonnées que dans les villes d'Amiens et d'Abhe-
ville, an lieu que le travail de la sayeterie est répandu
dans un grand nombre de bourgs et villages. » Avant
d'être localisée en Picardie, la saietterie avait été très flo-
rissante dans les Flandres. Une Lettre des Archiducs du
14 octobre 1606 (Arch. du Nord, série B, n° 1836) porte
qu'à l'avenir les « stils de saieterie, bourgeterie, etc. », ne
pourront être exercés que dans les villes de Tournai et de
Lille, parce que ces deux villes ce sont fondées sur les dicts
stilz, tellement que iceulx cessans elles se réduyroient
quasi désertes ». Cependant, en 1609, une Sentence des
Archiducs permit que certains ouvrages de saietterie
fussent fabriqués ce dans les bourgs et villaiges de Roubaix,
Tourcoing, "Watrelos, Neuville en Ferrain, Linselles,
Marcq, Wasquehal, etc. » C'est vers ce même temps que,
passant la frontière, l'industrie de la saietterie s'établit en
Picardie. Elle y prit, nous l'avons vu, un très rapide déve-
loppement et créa un mouvement d'affaires considérable
872
doré avec des jacinthes, de pétis safis, des perles, etc. »
(Irivmit. de GabrkUe ctEstrées, 1599.) Enfin, Loret écrivait
encore, à la date du 28 avril 1658 (voir Muze historique,
t. II, liv. IX, lettre 16), qu'il avait gagné à la loterie :
TJn salir d'importance,
Non des plus beaux qui soient en Erance,
Mais par quelques-uns estimé
A trente escus...-
Safre, s. m. — Oxyde de cobalt noirâtre pulvérulent
qui, mêlé à des cailloux rougis au feu et broyés, sert à faire
du verre bleu et à contrefaire le saphir. Par extension,
nom donné au verre coloré avec du safre. ce 24 décembre
1755 — Mme de Pompadour : Un gobelet couvert, [de]
safre camayeux, 54 livres. » (Livre journal de Lazare
Duvaux, t. Il, p.v266.) Le safre devint, à la fin du siècle
dernier, l'objet d'un important commerce en France, quand
on fabriqua ces jolies salières et ces moutardiers en cristal
bien, qui furent alors si fort à la mode ; aussi, s'en éta-
blit-il des manufactures, et l'on commença de fabriquer
chez nous cette substance que, jusque-là, on avait tirée
d'Allemagne.
On lit, à ce propos, dans les Annonces, affiches et avis
divers du 17 avril 1787 : ce La manufacture royale de
safre et d'azur des Pyrénées françoises vient d'établir,
en vertu d'un arrêt du Conseil du 5 décembre 1786,
un dépôt général chez le sieur Roëmich, contrôleur de
ladite manufacture, rue de Provence, au coin de la rue
Montmartre. Les négocians qui voudront de ces couleurs,
ajoute cette réolame, .en trouveront depuis un feu jusqu'à
cinq, à des prix inférieurs à ceux que l'étranger met aux
"siennes... »
Sagatis, s. m.pi. — Tissu croisé uni, fait de laine pei-
gnée, avec chaîne blanche et trame de couleur, et glacé par
le calandrage. L'armure est le sergé de quatre par moitié.
La largeur est de 75 centimètres. C'est une imitation
d'une étoffe anglaise qui a eu une grande vogue, il y a
cent ans, et que l'on a beaucoup exportée pour l'Espagne.
Elle est abandonnée aujourd'hui. Cette fabrication a
toujours été localisée à Amiens. Les sagatis étaient em-
ployés pour les rideaux. Le Journal général de France du
18 mai 1787 mentionne une ce Arente d'étoffes à la pointe
Saint-Eustachc » où figuraient des ce sagatis anglois, éter-
nelles, etc. » C'est la première mention que nous ayons
rencontrée de cette étoffe.
Saget, s. m. — Locution bordelaise. Sceau, cachet.
« En una petita brustra (coffret) lo son saget d'argent. »
(Invent, de Ramona de Cussac, chanoine de Saint-André;
Bordeaux, 1442.)
Sague, s. m.; Saguin, s. m.; Saigue, s. m.; Soigue, s. m.
— Locution bordelaise et provençale. Cuir préparé et
gaufré,-qui servait surtout à couvrir les sièges, ce Plus
huiet chères garnies de sague. » (Invent, du docteur Nicolas
Lallemagnc; Bollène, 1668.) ce Quatre chaises garnies de
saigne. — Onze chaises à la capucine, bois peint en rouge,
garnies de saigùe. » (Invent, du cardinal de Bélzunce;
Marseille, 1745.) ce Une chaise demi-commodité bois blanc,
garnie de soigue usée. — Une inquiétude bois de saule,
garnie de soigue. » (Apposition des scelles chez J.-B. Au-
dier, courtier royal'; Marseille, 1755.) ce Quatre chaises de
saules, garnies de soigue. » (Invent, de Catherine Powjard;
Marseille, 1760.) ce Deux chaises à la capucine, vieilles,
garnies de soigue. » (Invent, d!Andrè-BartMlemy Salade;
Marseille, 1779.) Dans le Bordelais, on disait saguin.
Saie, s. /. — Orthographe ancienne de SOIE. On lit
dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau, au titre xm
ce des cordiers de Paris » : « Nus-cordier ne puet ne ne
doit nule corde faire de quelque manière que ele soit, que
ele ne soit faite toute de 1 étoffe, c'est assavoir : ou toute
de teil, ou toute de chanvre, ou tonte de lin, ou toute de
saie... » Dans les Comptes relatifs au couronnement de la
reine Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Lon»
(Reims, ]316), nous relevons la mention suivante : ce Pour
VICLXI papeillon, faiz de broudeure, les belles (ailes) des
armes le comte de Bourgongne, pour l'or de quoy ils furent
brodez pour saie et pour façon, vi sols vi deniers pour
pièce, valent n°xiv livres xvi sols vi deniers. » C'est
aussi le nom qu'on donnait, en Picardie, à une sorte de
taffetas ou de serge de soie, qu'on a, depuis, appelé SAYE
ou SAIBTTE.
SAIE est encore le nom d'une petite brosse de poils de
porc, dont les orfèvres font usage pour nettoyer les pièces
d'argenterie.
Saiette, s.f; Sayette, s. f. — Dans le principe, tissu
de soie léger qu'on tirait d'Italie. Plus tard, on donna ce
nom à une petite étoffe de laine, mêlée' quelquefois d'un
peu de soie, qu'on fabriquait à Amiens, et qui faisait l'objet
d'un grand commerce. On on-confectionnait des tentures
de chambre et des rideaux. Cette industrie portait elle-
même le nom de saictteric. Au xv° et. an xvic siècle, on
écrivait sayette. ce Façon et estoffe de- brodurode deux
chambres de sayette, l'une rouge et l'autre verde. » (Compte
de Simon Longin, receveur général des'jinanccs de Maximi-
lien et de Varchiduc Philippe, 1494.) ce Pour quatre rid-
deaulx de lict.de sayette rouge et vert... » (Comptes de
l'argenterie d'Anne de Bretagne, 1496.)
Saietterie, s.f.; Sayetterie, s.f. — Nom sous lequel
on désignait autrefois la fabrication des étoffes de laine
mêlée de soie ou de poil de chèvre, établie en Flandre et
en Picardie. Piganiol de la Force (Nouvelle description de
la France, t, III, p. 183), parlant de cette dernière pro-
vince, écrit : ce Les manufactures et fabriques occupent et
font subsister un grand nombre de personnes de tout sexe
et de tout lige, à la ville et à la campagne. La principale
fabrique est appollée sayeterie; parce que le fil fait de sayette
ou de laine peignée et filée au petit rouet fait seule la chaîne
de ces étoffes qu'on appelle serge de Crève-coeur, d'Aumale,
bouracans, camelots, raz de Cônes, raz façon de Cliâlons,
serges façon de Nismes, serges façon de Seigneur, qui sont
toutes de pure laine. On en fait encore plusieurs autres ou
la laine est employée avec la soye, le fil de lin et le poil de
chèvre, telles sont les camelots façon de Bruxelles, les
pluches, raz de Gênes avec un fil de soye tord autour de la
chaîne, étamines façons du Mans et du Lude. Ces dernières
ne sont façonnées que dans les villes d'Amiens et d'Abhe-
ville, an lieu que le travail de la sayeterie est répandu
dans un grand nombre de bourgs et villages. » Avant
d'être localisée en Picardie, la saietterie avait été très flo-
rissante dans les Flandres. Une Lettre des Archiducs du
14 octobre 1606 (Arch. du Nord, série B, n° 1836) porte
qu'à l'avenir les « stils de saieterie, bourgeterie, etc. », ne
pourront être exercés que dans les villes de Tournai et de
Lille, parce que ces deux villes ce sont fondées sur les dicts
stilz, tellement que iceulx cessans elles se réduyroient
quasi désertes ». Cependant, en 1609, une Sentence des
Archiducs permit que certains ouvrages de saietterie
fussent fabriqués ce dans les bourgs et villaiges de Roubaix,
Tourcoing, "Watrelos, Neuville en Ferrain, Linselles,
Marcq, Wasquehal, etc. » C'est vers ce même temps que,
passant la frontière, l'industrie de la saietterie s'établit en
Picardie. Elle y prit, nous l'avons vu, un très rapide déve-
loppement et créa un mouvement d'affaires considérable
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 93.71%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 93.71%.
- Sujets similaires Bavoux Évariste Bavoux Évariste /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Bavoux Évariste" or dc.contributor adj "Bavoux Évariste")Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (9e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k11732214.highres Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (7e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k1173220q.highres
- Collections numériques similaires Bavoux Évariste Bavoux Évariste /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Bavoux Évariste" or dc.contributor adj "Bavoux Évariste")Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (9e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k11732214.highres Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (7e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k1173220q.highres
- Auteurs similaires Bavoux Évariste Bavoux Évariste /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Bavoux Évariste" or dc.contributor adj "Bavoux Évariste")Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (9e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k11732214.highres Guide théorique et pratique du contribuable en matière de contributions directes... : précédé d'une lettre de M. Évariste Bavoux,... (7e édition revue...) / par J.-E. Isoard,... /ark:/12148/bpt6k1173220q.highres
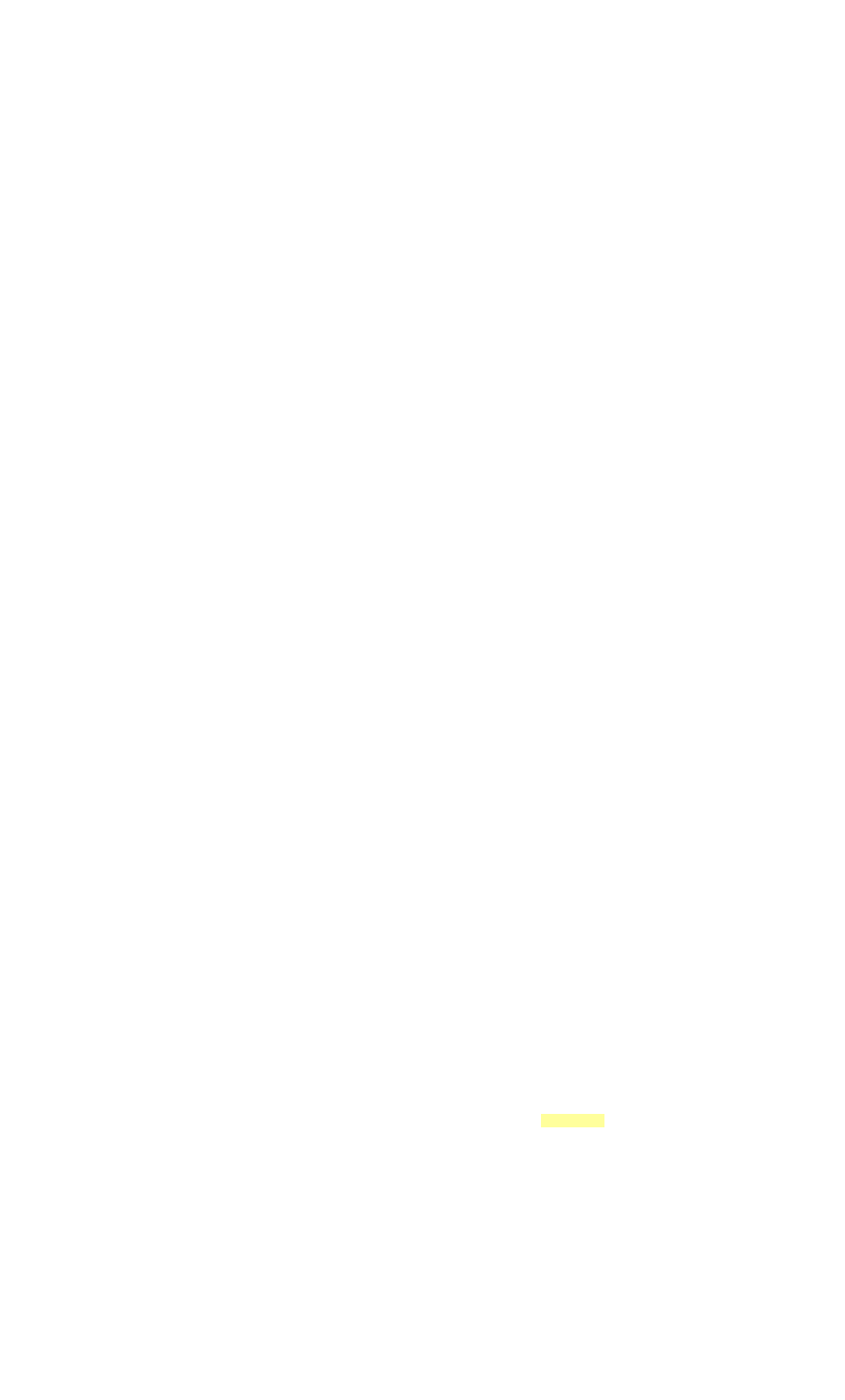
-
-
Page
chiffre de pagination vue 509/1011
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6154896q/f509.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6154896q/f509.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6154896q/f509.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6154896q/f509.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6154896q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6154896q
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6154896q/f509.image × Aide



