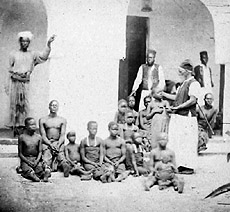 L'Esclavage
L'Esclavage
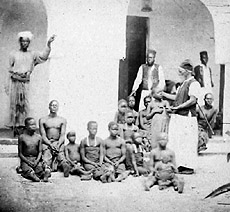 L'Esclavage
L'Esclavage
Après l'expansion arabe du VIIe siècle,
la traite augmente en Afrique. Les grands courants approvisionnent principalement
le monde arabe. Outre les routes transsahariennes, les mouvements vont de l'est
de l'Afrique vers l'Arabie et de la Corne de l'Afrique vers l'Abyssinie. La
présence d'esclaves africains est aussi attestée en Asie, notamment
en Inde. L'esclavage des autochtones a pratiquement disparu en Europe au XIIIe siècle,
quand la reconquista de l'Espagne amène des captifs "sarrasins".
Des ventes d'esclaves africains ont lieu dans la France du sud aux XIVe
et XVe siècle, à partir de
l'Espagne mais aussi venant directement de Tunis et de Tripoli.
La traite atlantique
Les Occidentaux détournent et amplifient à partir du XVe siècle
le commerce des esclaves en ouvrant de nouvelles routes ; le premier transport
direct d'Afrique vers les Antilles a lieu en 1518 et très vite la traite
à destination de l'Europe devient marginale. Les esclaves servent à
mettre en valeur l'Amérique. Des bateaux appartenant à toutes
les puissances maritimes sont présents sur la côte de Guinée,
bientôt appelée côte
des esclaves pour participer à ce trafic très lucratif. Pour
la France, la traite est autorisée par Louis XIII en 1642 et l'esclavage
dans les colonies est réglementé par le Code
Noir. Le XVIIIe siècle est l'apogée
de ce commerce triangulaire.
Les mouvements abolitionnistes et la fin de la traite atlantique
Les philosophes de la France
des Lumières réprouvent en majorité l'esclavage, mais
connaissent mal la situation des esclaves dans les îles lointaines même
si certains auteurs, comme P.
Poivre, administrateur de l'Ile de France (Ile Maurice), essaient de donner
des informations concrètes et de rattacher la cause des noirs aux aspirations
de la bourgeoisie. C'est en Angleterre
que le mouvement abolitionniste, d'inspiration plus religieuse, trouve un écho
populaire, relayé par les économistes qui comme Adam
Smith, dénoncent son manque de rentabilité. Sous la pression
de la Société
des Amis des Noirs, la Révolution française qui a exclu les
colonies
de l'application de la déclaration des droits de l'homme, abolit
cependant l'esclavage en 1794 avant que Bonaparte ne le rétablisse
en 1803.
Le XIXe siècle essaie de concilier
les principes moraux, défendus par Morénas
ou Sismondi avec les nécessités
d'une économie où, comme le rappelle Lecointe-Marsillac,
les matières premières coloniales jouent un rôle de plus
en plus important. L'Angleterre,
principale puissance maritime après Trafalgar, fait admettre au congrès
de Vienne (1814-1815) le principe du droit de visite, étendu au sud de
l'équateur seulement en 1842.
La France, qui possède des îles
sucrières dans les Antilles et les Mascareignes, interdit la traite
en 1818 mais n'accepte le droit de visite qu'en 1831 et n'abolit
l'esclavage dans ses colonies qu'en 1848, grâce au combat de V. Schoelcher
et de son entourage.
L'esclavage en Afrique au XIXe siècle
Si la traite atlantique disparaît progressivement au cours du XIXe siècle,
le nombre d'esclaves
sur le continent africain augmente à la même période.
Le commerce d'esclaves par les caravanes qui traversent le Sahara
ne disparaît qu'avec l'augmentation de la présence occidentale
au Maghreb et en Egypte.
L'exportation d'esclaves à partir de la
côte est de l'Afrique augmente à la fin du siècle, quand
des routes s'ouvrent en
Afrique de l'est et quand Zanzibar est mise en valeur. Les
églises protestantes et catholiques s'engagent dans la lutte contre
l'esclavage et encouragent les expériences de retour en Afrique des esclaves
libérés, mais l'économie coloniale de plantation s'appuie
souvent sur le travail forcé, qui ne disparaît qu'avec l'accès
à l'indépendance des pays d'Afrique. L'esclavage domestique reste
cependant présent jusqu'à la fin du XXe siècle
dans l'ensemble du continent.