Titre : Les Hommes du jour / dessins de A. Delannoy ; texte de Flax
Auteur : Flax (1876-1933). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1911-11-18
Contributeur : Delannoy, Aristide (1874-1911). Illustrateur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32787229g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5083 Nombre total de vues : 5083
Description : 18 novembre 1911 18 novembre 1911
Description : 1911/11/18 (N200). 1911/11/18 (N200).
Description : Note : La Poudre B. Note : La Poudre B.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k442436v
Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/10/2007
Le 12 mars de l'année 1907, le cuirassé Iéna se trouvait
dans le bassin de Missiessy à Toulon. Vers une heure
du soir, soudainement, une flamme jaillit à tribord; deux
détonations se produisirent. En un instant le navire était
en feu; une série d'explosions se succédèrent. Bientôt le
cuirassé, disloqué, chambardé, réduit en miettes, sombrait,
entraînant 117 cadavres et laissant 33 blessés.
A l'annonce de cette catastrophe une vive émotion
comme toujours s'empara du public. La Chambre des
députés fut secouée tout comme si elle s'était trouvée sur
le pont du navire. On rechercha les responsabilités. On
nomma une Commission d'enquête. Comme la mode n'était
pas encore aux saboteurs on n'osa pas risquer l'hypothèse
ordinaire. On s'ingénia à expliquer autrement les causes
de l'accident. Mais peu à peu, grâce aux efforts de quel-
ques hommes de bonne volonté, on fut sur les traces du
coupable. C'était une certaine poubre B, récemment imagi-
née par un nommé Vielle. Il fut établi que cette sacrée
poudre craignait l'humidité, ou la chaleur, on ne savait
trop au juste. Le froid l'enrhumait. Le chaud l'énervait.
Et pour prouver son mécontentement la méchante per-
sonne cassait la vaisselle.
On étudia alors la fameuse poudre. On lui découvrit des
tares, des imperfections. On établit aisément que l'explo-
sion venait uniquement de ce fait que la poudre avait
passé l'âge heureux de la jeunesse. Alors, pour parer à
de nouveaux désastres, on fit un effort colossal, on laissa
les poudres suspectes dans les soutes, mais on changea
les étiquettes.
En ce temps-là le ministre de la marine responsable
s'appelait Thomson et le président de la Commission d'en-
quête nommé par la Chambre s'appelait Delcassé.
Des années coulèrent. On avait oublié. Les morts vont
vite en France. Brusquement l'explosion de la Liberté se
produisit Nouvel effarement dans le public. Les choses
s'étaient passées dans les mêmes conditions que pour
Yléna. Jet de flammes, détonations, cadavres, blessés.
Comme la mode était aux saboteurs on risqua l'hypothèse
facile de malveillance; on accusa même le commandant
du navire qui avait eu le tort de partir en congé régulier.
Puis peu à peu on se souvint. La poudre B faisait sa
réapparition. On enquêta, on interrogea. Deux ingénieurs
des poudres, les sublimes Maissin et Louppe, se dévouè-
rent et vinrent se dénoncer réciproquement sur l'autel
de la Patrie endeuillée.
Ce fut un beau mouvement spontané d'indignation.
Tous nos parlementaires, debout, réclamèrent des sanc-
tions. On confia au général Gaudin qui déjà au moment
de Vléna avait poussé des cris d'alarme le soin d'éclairer
l'opinion. Et l'on en vint une fois de plus à incriminer la
malfaisante poudre. C'était encore elle en effet qui avait
fait des siennes.
Les débats à la Chambre se prolongèrent. Des députés
attaquèrent le gouvernement, lequel assura le pays qu'il
avait pris ses mesures pour éviter à l'avenir de semblables
boucheries. Et, en effet, pour empêcher le retour de pa-
reilles mésaventures on laissa les poudres dans les soutes et
on changea les étiquettes.
En ce temps-là le ministre de la marine responsable
s'appelait Delcassé et le président de la Commission de la
marine s'appelait Thomson.
La Poudre B
-5«
Qu'est-ce donc que cette poudre malencontreuse qui
cause tant de ravages, que tout le monde dénonce et que
personne ne touche ?
Sans vouloir jouer ici au pédant, qu'on nous permette
d'entrer dans quelques détails techniques, ennuyeux peut-
être, mais indispensables.
La poudre blanche, dite poudre B, est ainsi appelée de
la première lettre du nom du général Boulanger qui en
prescrivit l'adoption et l'application, a été découverte en
1884 par l'ingénieur des Poudres et Salpêtres, Vielle,
membre de l'Institut. Le but poursuivi par ce savant était
d'augmenter la puissance balistique de nos armes à feu et
notamment d'obtenir dans le fusil de 8 millimètres une
vitesse initiale supérieure à 600 mètres. On s'aperçut par
surcroit que cette poudre, en déflagrant, ne produisait
qu'une sorte de vapeur grise à peine visible. D'où le nom
de poudre sans fumée.
Elle fut adoptée officiellement eu 1886 pour les fusils
nouveau modèle et en 1888 pour l'artllerie de terre, puis
en 1889 pour la marine. Elle contribua dans les premiers
temps à donner une avance formidable à la France mais
depuis cette avance s'est perdue. Les autres nations ont
des poudres similaires baptisées lyddite, balistite, cordite,
etc., qui sont supérieures an point de vue double de la
stabilité chimique et de la régularité balistique.
La poudre B est à base de coton-poudre ou fulmi-cototi,'
ou encore pyroxyle.
Le coton-poudre est un corps détonant qu'on obtient en
traitant du coton cardé par un mélange d'acide sulfurique
et nitrique. C'est de la nitro-cellulose, corps éminemment
explosible, surtout à l'état sec.
Les deux points importants dans la fabrication sont
un dégraissage complet du coton et l'enlèvement parfait,
total, des acides. Si ces précautions ne sont pas rigou-
reusement suivies on obtient du fulmi-coton mal préparé
qui se décompose plus ou moins vite et dont la décomposi-
tion développe assez de chaleur pour le faire détonner, s'il
est enveloppé dans des enveloppes résistantes.
La méthode imaginée par M. Vielle est de transformer
le coton-poudre en colloide (sorte de matière comparable
à de la colle à bouche). Pour la fabrication de la poudre B
on prend le coton-poudre à l'état de poussière fine, assez
semblable à de la farine, et on l'additionne avec un dissol--
vant on plutôt un gélatinisant qui, en France, se compose
d'un mélange d'éther et d'alcool. Par des procédés qui res-
semblent à ceux en usage pour les pâtes alimentaires, on
obtient une pâte que l'on découpe en brins, sous la forme
dite « en lanelles ». Avec ces brins enroulés les uns sur les
autres on confectionne des fagots et avec un certain nom-
bre de ces fagots on constitue les gargousses ou les douilles.
En Allemagne on donne aux brins la forme de tubes.
En Amérique on en fait de petits cylindres. En Angleterre
on leur donne la forme de cordelettes, d'où le nom de
cordite. Toutes ces poudres sont à base de nitro-cellulose.
En France on emploie la nitro-cellulose pure; à l'étranger
on la mélange plus ou moins avec de la nitro-glycérine.
Pour terminer ces explications fastidieuses indiquons
qu'une fois la poudre découpée, pour la mettre à son état
définitif et livrable aux services il faut lui enlever tout le
dissolvant qui est en excès et, pour cela, on lui fait encore
subir une série d'opérations, de lavages et séchages. Puis
enfin on la soumet à des épreuves de stabilité.
Maintenant que nous avons suffisamment fait notre
dans le bassin de Missiessy à Toulon. Vers une heure
du soir, soudainement, une flamme jaillit à tribord; deux
détonations se produisirent. En un instant le navire était
en feu; une série d'explosions se succédèrent. Bientôt le
cuirassé, disloqué, chambardé, réduit en miettes, sombrait,
entraînant 117 cadavres et laissant 33 blessés.
A l'annonce de cette catastrophe une vive émotion
comme toujours s'empara du public. La Chambre des
députés fut secouée tout comme si elle s'était trouvée sur
le pont du navire. On rechercha les responsabilités. On
nomma une Commission d'enquête. Comme la mode n'était
pas encore aux saboteurs on n'osa pas risquer l'hypothèse
ordinaire. On s'ingénia à expliquer autrement les causes
de l'accident. Mais peu à peu, grâce aux efforts de quel-
ques hommes de bonne volonté, on fut sur les traces du
coupable. C'était une certaine poubre B, récemment imagi-
née par un nommé Vielle. Il fut établi que cette sacrée
poudre craignait l'humidité, ou la chaleur, on ne savait
trop au juste. Le froid l'enrhumait. Le chaud l'énervait.
Et pour prouver son mécontentement la méchante per-
sonne cassait la vaisselle.
On étudia alors la fameuse poudre. On lui découvrit des
tares, des imperfections. On établit aisément que l'explo-
sion venait uniquement de ce fait que la poudre avait
passé l'âge heureux de la jeunesse. Alors, pour parer à
de nouveaux désastres, on fit un effort colossal, on laissa
les poudres suspectes dans les soutes, mais on changea
les étiquettes.
En ce temps-là le ministre de la marine responsable
s'appelait Thomson et le président de la Commission d'en-
quête nommé par la Chambre s'appelait Delcassé.
Des années coulèrent. On avait oublié. Les morts vont
vite en France. Brusquement l'explosion de la Liberté se
produisit Nouvel effarement dans le public. Les choses
s'étaient passées dans les mêmes conditions que pour
Yléna. Jet de flammes, détonations, cadavres, blessés.
Comme la mode était aux saboteurs on risqua l'hypothèse
facile de malveillance; on accusa même le commandant
du navire qui avait eu le tort de partir en congé régulier.
Puis peu à peu on se souvint. La poudre B faisait sa
réapparition. On enquêta, on interrogea. Deux ingénieurs
des poudres, les sublimes Maissin et Louppe, se dévouè-
rent et vinrent se dénoncer réciproquement sur l'autel
de la Patrie endeuillée.
Ce fut un beau mouvement spontané d'indignation.
Tous nos parlementaires, debout, réclamèrent des sanc-
tions. On confia au général Gaudin qui déjà au moment
de Vléna avait poussé des cris d'alarme le soin d'éclairer
l'opinion. Et l'on en vint une fois de plus à incriminer la
malfaisante poudre. C'était encore elle en effet qui avait
fait des siennes.
Les débats à la Chambre se prolongèrent. Des députés
attaquèrent le gouvernement, lequel assura le pays qu'il
avait pris ses mesures pour éviter à l'avenir de semblables
boucheries. Et, en effet, pour empêcher le retour de pa-
reilles mésaventures on laissa les poudres dans les soutes et
on changea les étiquettes.
En ce temps-là le ministre de la marine responsable
s'appelait Delcassé et le président de la Commission de la
marine s'appelait Thomson.
La Poudre B
-5«
Qu'est-ce donc que cette poudre malencontreuse qui
cause tant de ravages, que tout le monde dénonce et que
personne ne touche ?
Sans vouloir jouer ici au pédant, qu'on nous permette
d'entrer dans quelques détails techniques, ennuyeux peut-
être, mais indispensables.
La poudre blanche, dite poudre B, est ainsi appelée de
la première lettre du nom du général Boulanger qui en
prescrivit l'adoption et l'application, a été découverte en
1884 par l'ingénieur des Poudres et Salpêtres, Vielle,
membre de l'Institut. Le but poursuivi par ce savant était
d'augmenter la puissance balistique de nos armes à feu et
notamment d'obtenir dans le fusil de 8 millimètres une
vitesse initiale supérieure à 600 mètres. On s'aperçut par
surcroit que cette poudre, en déflagrant, ne produisait
qu'une sorte de vapeur grise à peine visible. D'où le nom
de poudre sans fumée.
Elle fut adoptée officiellement eu 1886 pour les fusils
nouveau modèle et en 1888 pour l'artllerie de terre, puis
en 1889 pour la marine. Elle contribua dans les premiers
temps à donner une avance formidable à la France mais
depuis cette avance s'est perdue. Les autres nations ont
des poudres similaires baptisées lyddite, balistite, cordite,
etc., qui sont supérieures an point de vue double de la
stabilité chimique et de la régularité balistique.
La poudre B est à base de coton-poudre ou fulmi-cototi,'
ou encore pyroxyle.
Le coton-poudre est un corps détonant qu'on obtient en
traitant du coton cardé par un mélange d'acide sulfurique
et nitrique. C'est de la nitro-cellulose, corps éminemment
explosible, surtout à l'état sec.
Les deux points importants dans la fabrication sont
un dégraissage complet du coton et l'enlèvement parfait,
total, des acides. Si ces précautions ne sont pas rigou-
reusement suivies on obtient du fulmi-coton mal préparé
qui se décompose plus ou moins vite et dont la décomposi-
tion développe assez de chaleur pour le faire détonner, s'il
est enveloppé dans des enveloppes résistantes.
La méthode imaginée par M. Vielle est de transformer
le coton-poudre en colloide (sorte de matière comparable
à de la colle à bouche). Pour la fabrication de la poudre B
on prend le coton-poudre à l'état de poussière fine, assez
semblable à de la farine, et on l'additionne avec un dissol--
vant on plutôt un gélatinisant qui, en France, se compose
d'un mélange d'éther et d'alcool. Par des procédés qui res-
semblent à ceux en usage pour les pâtes alimentaires, on
obtient une pâte que l'on découpe en brins, sous la forme
dite « en lanelles ». Avec ces brins enroulés les uns sur les
autres on confectionne des fagots et avec un certain nom-
bre de ces fagots on constitue les gargousses ou les douilles.
En Allemagne on donne aux brins la forme de tubes.
En Amérique on en fait de petits cylindres. En Angleterre
on leur donne la forme de cordelettes, d'où le nom de
cordite. Toutes ces poudres sont à base de nitro-cellulose.
En France on emploie la nitro-cellulose pure; à l'étranger
on la mélange plus ou moins avec de la nitro-glycérine.
Pour terminer ces explications fastidieuses indiquons
qu'une fois la poudre découpée, pour la mettre à son état
définitif et livrable aux services il faut lui enlever tout le
dissolvant qui est en excès et, pour cela, on lui fait encore
subir une série d'opérations, de lavages et séchages. Puis
enfin on la soumet à des épreuves de stabilité.
Maintenant que nous avons suffisamment fait notre
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.98%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.98%.
- Auteurs similaires Dayot Armand Dayot Armand /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Dayot Armand" or dc.contributor adj "Dayot Armand")
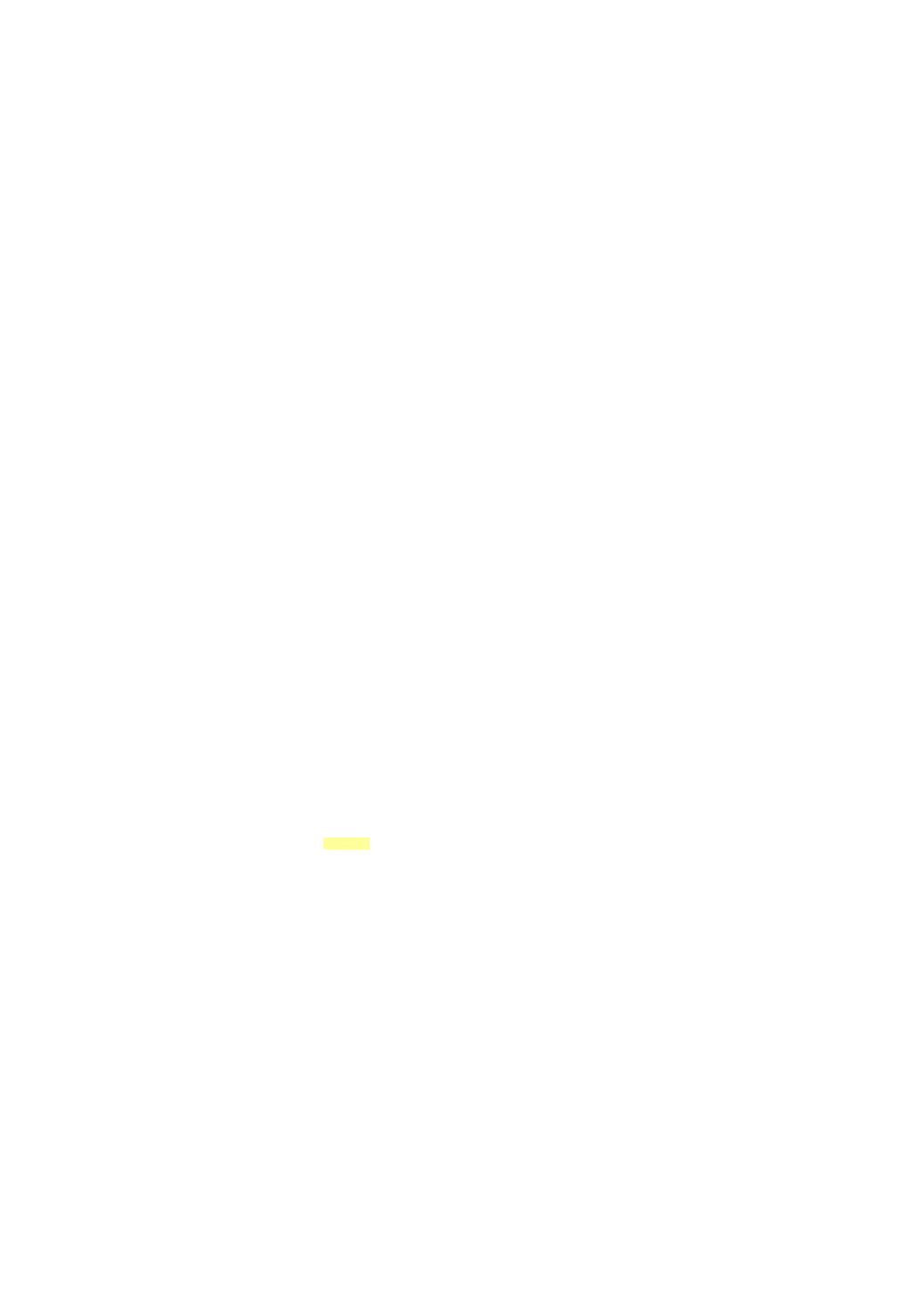
-
-
Page
chiffre de pagination vue 2/12
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k442436v/f2.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k442436v/f2.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k442436v/f2.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k442436v/f2.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k442436v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k442436v
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k442436v/f2.image × Aide




Facebook
Twitter
Pinterest